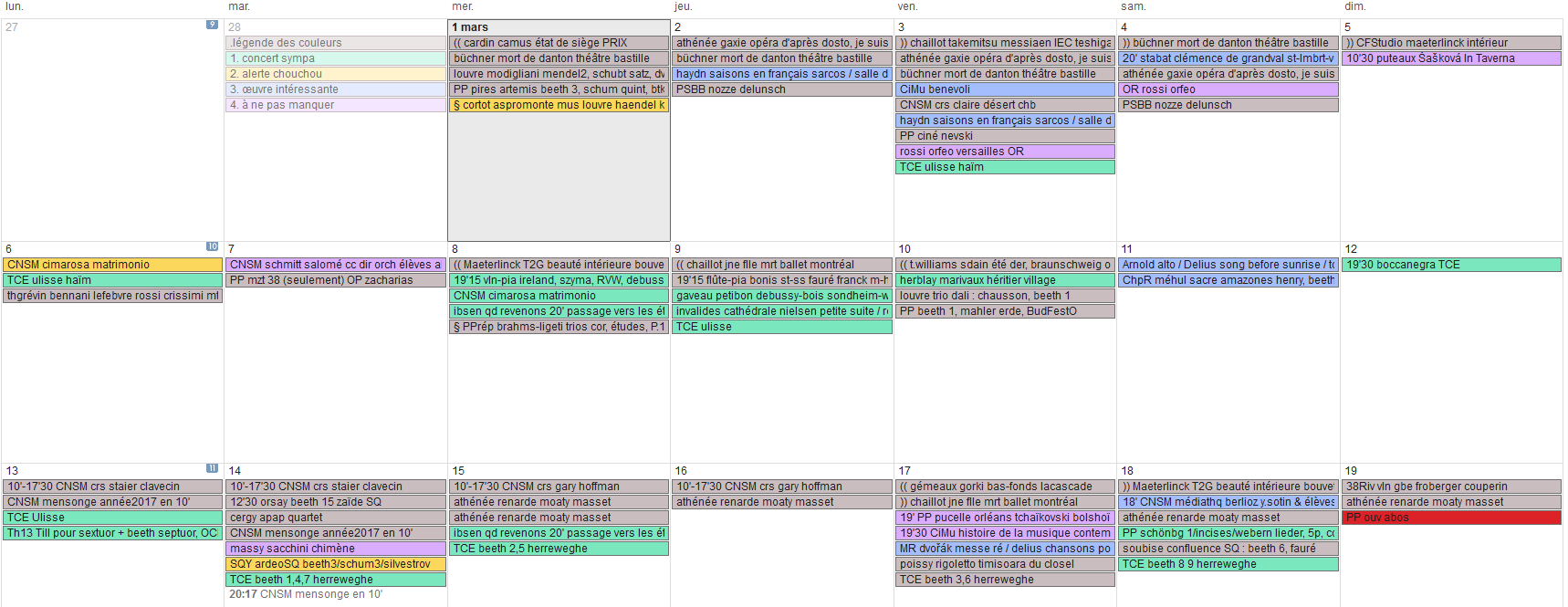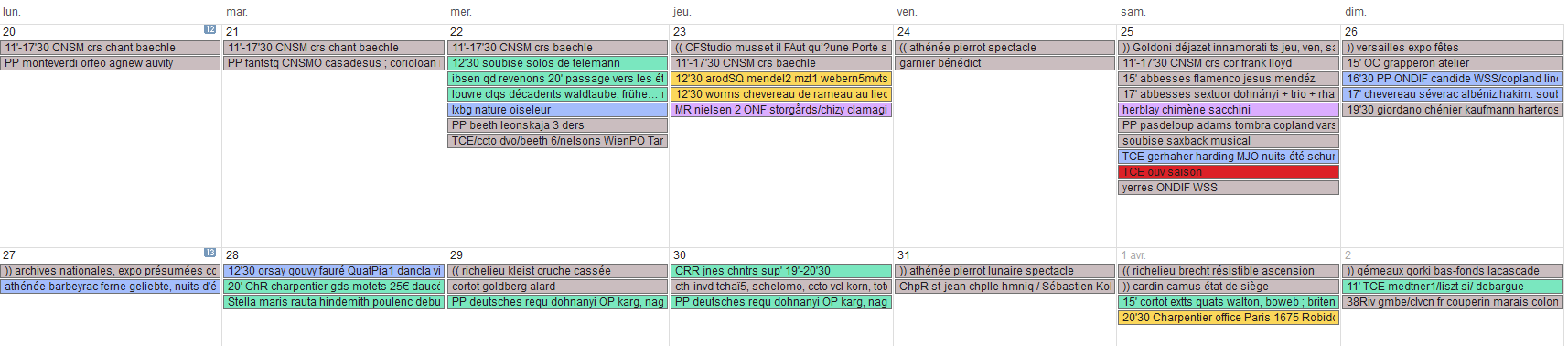Je suppose peu de nouveautés le jour même de Noël, et elles sont
donc pour cette dernière bordée, vendredi dernier, quasiment à l'arrêt hors quelques millièmes réenregistrements beethoveniens.
Du fait de l'enfermement et du délai un peu plus long de publication, la liste est
devenue un peu épaisse. J'essaie de la subdiviser mais espère qu'elle
demeurera lisible (suivez le rouge pour les nouveautés, les 2 ou 3
cœurs pour les albums exceptionnels).
Du vert au violet, mes recommandations… en ce moment remplacées par des
♥
.
♦ Vert : réussi !
♥
♦ Bleu : jalon considérable.
♥
♥
♦ Violet : écoute capitale.
♥
♥
♥
♦ Gris : pas convaincu. ♠
(Les disques sans indication particulière sont à mon sens de très bons
disques, simplement pas nécessairement prioritaires au sein de la
profusion de l'offre.)
En rouge,
les nouveautés
2020 (et plus spécifiquement de l'automne).
Je laisse
en noir les
autres disques découverts.
En gris,
les réécoutes
de disques.
1.
OPÉRA
OPÉRA ITALIEN
♥♥
Monteverdi – Orfeo – Boden,
Pass à Amsterdam (YT)
♥♥
Monteverdi – Orfeo –
Auvity, Wilder, Arts Flo, Agnew (YT)
♥♥♥
Rossi – Orfeo, acte I – Pichon
→ Tellement étonnant qu'en salle, Bridelli marque plus
qu'Aspromonte !
♥
Vivaldi – Farnace
« Gelido in ogni vena » – Maggio Musicale, Sardelli (Dynamic)
♥♥
Graun – Cleopatra e Cesare
(acte I) – Jacobs
Salieri
– Armida (air) – Rousset (Aparté 2021)
→ En avant-première en flux… Juste deux pistes, l'Ouverture et un air.
Jolie écriture dramatique. Évidemment loin du ravissement de ses opéras
français… ou même de ses délicieux bouffes – mais pour du
seria,
on sent tout de même l'empreinte de Gluck et du goût français, ce qui
est un avantage pour garantir un peu de ma patience. Exécution pleine
d'ardeur des Talens Lyriques, tout de même bien hâte de découvrir cela
(à défaut d'avoir entendu le concert de mai).
Mozart
– Il Sogno di Scipione – Boncompagni, Fenice, Sardelli (Operavision
2020)
→ Mozart seria de jeunesse : statique et ennuyeux. Sardelli
apporte un peu de tranchant à l'orchestre de la Fenice, qui reste
toujours assez terne et à la peine, depuis tant d'années… (je ne l'ai
jamais entendu vraiment bon, je crois)
♥
Mozart – Le Nozze di Figaro
– McLaughlin, Mattila, Gallo, Pertusi ; Mehta (Sony)
→ Tradi un peu lisse, mais duo comtal chouette.
♥
Mozart – DG – Fuchs,
Leonard, Sly, Nahuel Di Pierro ; Rhorer (YT)
♥♥
Mozart – Così – Behle,
Priante, Lhote, Lyon, Montanari (YT)
♥
Verdi – La Traviata,
« Fragment » (acte III jusqu'à Addio del passato) –
MusicAeterna, Currentzis
→ Tout à fait lunaire : récitatifs totalement étirés comme s'ils
étaient des airs en largo, voix artificiellement réverbérées et
gonflées, un délire très révélateur de sa conception purement musicale
(et narcissique…) de l'opéra.
→ Ce n'est pas moche du tout, mais ça ne ressemble plus à grand'chose,
en tout cas pas à un opéra de Verdi (mais j'aime assez).
→ Je ne comprends pas le quart d'heure (du moins bon passage de
l'opéra, en plus). Vendu en dématérialisé ?
Teasing pour une intégrale qui
prend son temps ? Chute d'une intégrale
avortée mais monétisable ? «
Single
long » ? Marché numérique ?
♥♥♥
Verdi – Simone Boccanegra – Homoki ;
Rowley, Jorijikia, Nicholas Brownlee, Gerhaher, Fischesser ;
Zürich, Luisi (Arte 2020)
→ Direction d'acteurs formidable, et l'usage de ce simple décor
tournant qui nous mène de coursive en antichambre… Homoki à un sommet
de maturité.
→ Orchestre mordant, N. Brownlee fabuleux. Rowley assez pharyngée mais
expressive comme une actrice au temps du Code Hays.
→ Très content d'entendre chanter Verdi comme Gerhaher.
♥
Verdi – Aida, début inédit de l'acte III
– Scala, Chailly (euroradio)
→ 100 mesures coupées avant la création. Moment suspendu de prières
douces aux registres étagés, très réussi, à comparer à l'ambiance du
temple avant « Nume custode e vindice ». Méritait d'être
entendu, et mériterait d'être systématiquement joué.
→ (en revanche, vocalement, quoique tout à fait honnête, ça laisse
vraiment entendre la crise du chant verdien – alors que dans les autres
répertoires, l'opéra se porte vraiment bien…)
♥♥
Verdi – Otello – Torsten
Ralf & Stella Roman - Dio ti giocondi (Met, 1946)
OPÉRA FRANÇAIS
♥♥♥
Lully – Isis – Rousset
♥♥♥
Lully – Armide (acte I) – Herreweghe II
(HM)
♥♥♥
Lully – Armide (actes I, III, IV &
V) – Rousset (Aparté)
♥♥
Mozart – La Flûte enchantée en français –
M. Vidal, Scoffoni, Lécroart, Lavoie ; Le Concert Spirituel, Niquet
(France 5)
→ Très vivante version raccourcie et en français, dans une distribution
française de très grand luxe.
Rossini – Le Barbier de Séville
(en français) – Berton, Giraudeau, Dens, Lovano, Depraz, Betti,
Pruvost ; Opéra-Comique, Gressier (EMI 1955)
♥♥
Boïeldieu – La Dame Blanche – Jestaedt,
Buendia, Ratianarinaivo, Hyon, (Yannis) François, Les Siècles, Nicolas
Simon (France 3)
→ Les qualités de charisme vocal de Buendia et Ratia souffrent de la
retransmission (un peu proche des voix, on entend les aspérités, les
micro-défauts), mais quand on les connaît, on mesure le bonheur
incommensurable qu'aurait été cette série de représentations
itinérantes… Voix franches (superbe découverte de Yannis François
également, baryton-basse clair et avec de vrais graves riches !),
chaleur des instruments d'époque… La mise en scène n'est pas
passionnante, mais le bonbon est très apprécié !
♥♥
Offenbach – M. Choufleuri –
Mesplé, Rosenthal (EMI)
→ Avec des citations de
Nonnes qui
reposez, de bouts de Verdi, thème du premier numéro du
Freischütz…
♥♥
Offenbach – Ba-ta-clan –
avec Corazza
→ Très bonne musique, même si d'une certaine façon sans texte !
♥♥♥
Bizet – Carmen – Angelici, Michel,
Jobin, Dens ; Opéra-Comique, Cluytens (réédition The Art Of
Singing 2014)
♥♥♥
Bizet – Carmen – Horne, McCracken
Bernstein (DGG)
OPÉRA ALLEMAND
Mozart – Zauberflöte – Della
Casa, Simoneau, Berry ; Opéra de Vienne, Szell
→ Orchestre très imprécis et hésitant, peu frémissant. Della Casa un
peu surdimensionnée dans le legato. Berry alors très clair.
♥♥♥
Wagner – Lohengrin – Bieito ;
Miknevičiute, Gubanova, Alagna, Gantner, Pape, Berliner Staatsoper,
Pintscher (Arte Concert)
→ Splendide orchestre et chœurs (et surpris par le lyrisme et la
tension de Pintscher dont j'avais un très mauvais souvenir dans le
« grand répertoire »), splendide distribution.
→ J'attendais évidemment Martin Gantner, l'une des voix les mieux
projetées du marché (ça paraît nasal et étroit en captation, mais en
salle, c'est une proximité et d'une expressivité miraculeuses).
Telramund pas du tout noir, très clair et concentré, très convaincant
dans un genre absolument pas canonique.
→ Roberto Alagna chante un allemand de grande qualité ; toutes les
voyelles sont un peu trop ouvertes, mais ceci va de pair avec la clarté
caractéristique de son timbre et la générosité jamais en défaut de son
médium. Un régal de bout en bout, élocution limpide et splendeur
vocale. Le second tableau de l'acte iII le voit se fatiguer, et les
aigus deviennent vraiment blancs et métalliques, le médium un peu plus
aigre. Tout le reste se montre à la fois original et très marquant.
→ La mise en scène de Bieito m'a paru laide, sans propos clair ni
animation scénique, sans cohérence psychologique ni lien avec le sujet.
Sans parler de son tic de faire trembler ses personnages pendant vingt
minutes , récupéré de la pire idée de son Boccanegra… Dire que ce fut
un si grand metteur en scène… Trop d'engagements. Trop d'empâtement.
♥
Wagner – Götterdämmerung, Janowski
I : prologue.
→ assez scolairement égrené, mais super prise de son. chanteurs
valeureux mais déjà un côté « déclin ».
Schoeck – Vom Fischer un syner
Fru, Op. 43 – Harnisch, Dürmüller, Shanaham , Winterthur, Venzago
(Claves 2018)
Harnisch en-dessous de ses standards, Dürmüller un peu dépassé, Venzago
un peu froid, version décevante d'une œuvre qui a déjà bien moins de
saillances que le Schoeck habituel (son principal intérêt étant d'être
composée directement sur le vieux dialecte allemand).La version
Kempe-Nimsgern est à privilégier.
♥♥
Schoeck – Massimilia Doni –
Edith Mathis, G. Albrecht
→ Décadentisme consonant dans le goût de
Venus et
Das Schloß Dürande, en plus lyrique
et plus basiquement dramatique, comme mâtiné de Verdi.
♥
Dusapin – Faustus – Nigl
(extrait)
OPÉRAS D'AUTRES LANGUES
♥♥
Mozart & Minna Lindgren – Covid
fan tutte – Mattila, Hakkala, Opéra de Helsinki, Salonen (Operavision
2020)
→ Così (plus Prélude de Walküre et air du Catalogue) en très condensé
(1h30), sur un texte finnois inspiré de nos mésaventures pandémiques.
Point de départ dramaturgique : Salonen vient diriger la Walkyrie
et la
situation sanitaire impose le changement de programme.
→ Tout y passe : les opinions rassurantes ou cataclysmiques, les
avis
contradictoires, les (inter)minables visios, la détresse de la mauvaise
cuisinière, la doctrine des masques, les artistes désœuvrés… Parfois
avec beaucoup d'esprit (« Bella vita militar » pour la
mission papier
hygiénique), par moment de façon confuse ou un peu plate (la vie des
sopranos).
→ Les récitatifs sont changés en dialogues menés par « l'interface
utilisateur », sorte de directrice de la communication hors sol.
→ Hakkala (Alfonso) fantastique, Mattila remarquablement sa propre
caricature, avec toujours un sacré brin de voix (les poitrinés rauques
en sus).
→ Globalement, un jalon de notre histoire s'est écrit – on aurait pu
creuser davantage quelque chose de cohérent, avec les mêmes éléments,
ménager une arche qui soit un peu moins une suite de moments
dépareillés… Pour autant, le résultat est la plupart du temps très
amusant, et marquera le souvenir artistique de la Grande Pandémie des
années 2020 pour les archéologues du futur – du moins si notre éphémère
technologie numérique n'a pas tout laissé disparaître…
Moniuszko – Halka – Paweł Passini ;
Mych-Nowika, Piotr Fiebe, Golinski ; Poznan, Gabriel Chmura
(Operavision 2020)
→ Pas fabuleux vocalement (aigus blancs de la soprano et du ténor, bon
baryton). Superbes scènes de ténor, mais œuvre vraiment ennuyeuse
dramatiquement : Halka reste debout trahie, son comparse le lui
explique longuement, et c'est l'essentiel, malgré le terrible condensé
de tragédie contenu dans la pièce.
→ Musicalement peu fulgurant aussi, quoique moins gentillet que le
Manoir hanté.
♥♥
Hatze – Adel i Mara –
Zagreb 2009 (YT)
Britten – A Midsummer Night's Dream – M.-A.
Henry, Montpellier (Operavision 2020)
→ Belle version d'une œuvre aux belles intuitions mais qui patine un
peu, à mon sens, dans le formalisme de ses duos et ensembles intérieurs
(livret très bavard, également).
2. MUSIQUE
DE SCÈNE / BALLETS
Marais – Suites à joüer d'Alcione –
Savall (Alia Vox)
→ Bien mieux que le concert. (Mais ces suites ont-elle un grand intérêt
isolées?)
♥♥♥
Rameau – Hippolyte (Prélude du III) dans
« Tragédiennes » #1 – Talens, Rousset
Piron – Vasta – Almazis
(Maguelone 2020)
→ Pas très séduit, ni par le texte (vraiment plat, comparé aux pièces
grivoises de Grandval qui m'amusent assez), ni par les musiques (pas
passionnantes, et textes assez pesants aussi).
→ Musicalement, pas séduit non plus par les timbres instrumentaux.
Dommage, c'était très intriguant.
→ Il existe une lecture très vivante de la Comtesse d'Olonne de
Grandval en complément d'un disque de ses cantates, je recommande
plutôt cela pour se frotter à ce type de théâtre leste.
♥
Cannabich – Electra – Hofkapelle Stuttgart,
Bernius (Hänssler 2020)
→ Mélodrame dans le style classique, très réussi et ici très bien joué
et dit (par Sigrun Bornträger).
♥
Wagner – Die Meistersinger, ouverture –
Vienne, Solti
♥
Tchaikovsky – The
Tempest, Op. 18 – Orchestra of St. Luke's; Heras-Casado (HM 2016)
♥♥
Humperdinck – « Music for the Stage
» : Das Wunder, Kevlar, Lysistrata… – Opéra de Malmö, Dario Salvi
(Naxos)
→ Très belle sélection de scènes d'opéras et autres œuvres dramatiques,
variées, pleines de la naïveté et de l'emphase pleine de simplicité
propres à Humperdinck. Extrêmement persuasif, délicieux, très bien
joué. Hâte de découvrir ces œuvres intégrales désormais, une très belle
ouverture vers cet univers encore chichement documenté ! (Et la
générosité accessible de cette musique plairait à un vaste public,
a fortiori en Allemagne dont
l'imaginaire populaire est une référence récurrente…)
3. RÉCITALS VOCAUX
Haendel,
Vivaldi… – « Queen
of Baroque » – Cecilia Bartoli (Decca 2020)
→ Pot-pourri de différents disques. Très bons, mais autant profiter des
programmes cohérents. Si jamais vous voulez comparer les orchestres et
les répertoires, pourquoi pas.
♥
Salieri, Strictly private, Heidelberg SO
(Hänssler)
→ Lecture nerveuse d'airs et duos très spirituels, qui évoquent les Da
Ponte mozartiens, un délice.
♥
Rossini – « Amici e Rivali » –
Brownlee, Spyres, I Virtuosi Italiani, Corrado Rovaris (Erato 2020)
→ Impressionnant Spyres en baryton et bien sûr en ténor (même si le
coach d'italien devait être covidé, à en juger par certains titres).
Brownlee a perdu de son insolence, mais pas de sa clarté et de son
moelleux.
Superbe attelage, pour un répertoire purement glottique qui n'a pas
forcément ma prédilection d'ordinaire, accompagné par un orchestre très
fin (instruments d'époque ?) et discret, petit effectif, cordes sans
vibrato.
Gounod,
Bizet, Tchaïkovski, Puccini – « Hymnes of Love » –
Dmytro Popov
→ Pas fini, ça a l'air bien. Mais la rondeur de la voix est davantage
conçue pour le répertoire slave que pour l'éclat des
spinti.
Massenet par ses créateurs (Malibran
2020)
→ Scindia par Jean Lasalle
→ Salomé par Emma Calvé
(ouille)
4. MUSIQUE SACRÉE
Un
disque mystérieux (Aparté 2021)…
… de cantates luthériennes du Schleswig, totalement inédites – pour
lesquelles je viens
d'écrire une notice le nez plongé dans des
interpolations vétérotestamentaires tirées de la Bible de Luther, et
qui devraient paraître en fin d'année prochaine. (Avec des textes
d'époque très
denses, des chanteurs très éloquents et un continuo imaginatif, pour ne
rien gâcher.)
Pfleger – Cantates sacrées en
latin & allemand – Bremen Weser-Renaissance, Cordes) (CPO)
→ Splendide ! Entre Monteverdi et Bach, un côté très Steffani…
Airs quasiment tous à deux voix !
♥♥♥
Steffani – Duetti di camera – Mazzucato,
Watkinson, Esswood, Elwes, Curtis… (Archiv)
♥
Legrenzi – Compiete con le
letanie e antifone della Beata Vergine – Nova Ars Cantandi, Giovanni
Acciai (Naxos 2020)
→ Un des plus grands compositeurs du XVIIe siècle, Legrenzi excelle
dans toutes formes d'audace, un contrepoint riche et libre, une
harmonie mouvante, une agilité qui préfigure le seria du XVIIIe siècle…
→ Première gravure discographique de ces Complies Op. 7, la dernière
prière du jour. Superbes voix franches et articulées… sauf le soprano
masculin, très engorgé, vacillant, inintelligible, qui tranche
totalement avec le reste et distrait assez désagréablement. Étant la
partie la plus exposée, le plaisir est hélas un peu gâché.
Bach – Cantates format chambre
– Nigl
Haendel – Dixit Dominus –
Scholars Baroque (Naxos)
→ Première fois cette version en entier. Génial 1PP.
Haendel – Dixit Dominus
Réécoutes et nouvelles écoutes : Gardiner-Erato, Scholars Baroque,
haïm, Toll, Fasolis, Creed Alte Musik, Öhrwall Drottningholm, Zoroastre
Rochefort, Meunier, Parrott, Minkowski, Chistophers-Chandos,
Christophers-Coro, Rademann, Dijkstra, Gardiner-Decca, Bates, Preston.
du baroque à Satie – « War
& Peace, 1618-1918 » – Lautten Compagney (DHM 2018)
→ Amusant mélange (avec la Gnossienne n°3 revisitée par cet ensemble
baroque), plaisant et bien interprété (avec une soprano au fort accent
britannique).
♥
Pergolesi – Stabat Mater –
Galli, Richardot ; Silete venti, Toni (La Bottega Discantica, 2016)
♥
♥
♥
Borodine
– Requiem (arr. Stokowski) – BBC Symphony Chorus, Philharmonia
Orchestra, Geoffrey Simon (Signum 2020, réédition)
→ Cinq minutes de paraphrase sur le thème grégorien, avec des harmonies
typiques de l'avant-garde russe du second XIXe. Les doublures pizz-bois
alla Godounov sont incroyables !
+ Suite Prince Igor, Petite Suite…
5. CONCERTOS
♥
Rejcha
– Symphonies concertantes flûte-violon, puis 2 violoncelles –
Kossenko, Stranossian, Coin, Melknonyan ; Gli Angeli Genève,
MacLeod (Claves 2020)
→ Flûte-violon : aimable. Entre le son un peu aigrelet des solos
sur instruments d'époque (pas faute d'aimer ces quatre artistes
pourtant) et la progression harmonique très traditionnelle, les
mélodies vraiment banales, je n'y trouve pas le grand Rejcha que
j'aime. Joli mouvement lent tout de, qui débute par violon et flûte
seuls.
→ La symphonie à deux violoncelles est bien plus intéressante, en
particulier le premier mouvement inhabituellement varié (dont le
premier fragment thématique est similaire à celui de Credeasi misera)
et le final assez foisonnant. Mais pour cette œuvre, le disque
Goebel-WDR (aux couplages passionnants) de cette même année 2020
m'avait davantage convaincu.
B.
Romberg – Cello Concertos
Nos. 1 and 5 (Melkonyan, Kölner Akademie, Willens) (CPO 2016)
→ Décevant, du gentil concerto décoratif et virtuose, rien à voir avec
ses duos de violoncelle, très musicaux et variés !
Lalo,
Ravel
– Symphonie espagnole ; La Valse, Tzigane & Bolero – Deborah
Nemtanu, Pierre Cussac, La Symphonie de Poche, Nicolas Simon (Pavane
2017)
→ Sympathique, mais la partie concertante et le mixage permettent moins
d'apprécier l'exercice que dans le disque Beethoven.
♥
Elgar – Concerto pour violoncelle –
Johannes Moser, Suisse Romande, Manze (PentaTone 2020)
→ Très sérieux et dense, nullement sirupeux, avec un orchestre à la
belle finesse de touche, qui fait entendre le contrechant avec netteté.
→ Parution du seul concerto, uniquement en numérique (avant un futur
couplage en disque physique ?).
♥♥♥
Schmidt, Stephan – Symphonie n°4,
Musique pour violon & orchestre – Berlin PO, K. Petrenko (Berliner
Philharmoniker 2020)
→ Interprétations très fluides et cursives, dans la veine transparente
du nouveau Berlin issu de Rattle, vision assez lumineuse de ces œuvres
à la taciturnité tourmentée.
Hisatada
Otaka : Concerto
pour flûte (version orchestre) – Cheryl Lim, Asian Cultural SO, Adrian
Chiang (YT 2018)
→ Décevante orchestration : les harmonies sont noyées dans des
jeux de cordes très traditionnels (et un peu mous), on perd beaucoup de
la saveur de la verison Op.30b avec accompagnement de piano, à mon
sens.
♥♥
Mossolov, Concerto pour harpe, Symphonie n°5
– Moscou SO (Naxos)
→ Très festif, très décoratif, très « Noël », cet étonnant
concerto
pour harpe que je n'aurais jamais imaginé une seconde attribuer à
Mossolov !
→ Dans la Symphonie, on entend surtout des chants populaires traités en
grands accords. Joli, mais pas très fulgurant par rapport à sa période
futuriste.
♠ Lubor Barta – Concerto pour violon n°2 1969 – Ivan Straus, Otakar
Trhlik (1969)
6. SYMPHONIES & POÈMES
ORCHESTRAUX
SYMPHONISTES
GERMANIQUES
♥♥
Beethoven / Robin Melchior – « Beethoven, si tu nous
entends » – La Symphonie de Poche, Nicolas Simon (Klarthe 2020)
→ Jubilatoire blind-test pot-pourri dont les développements sont (très
bien !) récrits. Le tout étant joué pour quatuor, contrebasse,
flûte,
clarinette, clarinette basse, saxhhorn baryton, accordéon, harpe et
percussions… !
→ Il m'a fallu quelques secondes pour retrouver le fantastique
mouvement lent du Concerto n°5 ainsi transfiguré… dont la cadence de
harpe débouche sur les pointés du mouvement lent de la Quatrième
Symphonie ! Mazette.
→ Ou encore la fin sur une boucle minimaliste autour du thème de l'Ode
à la Joie.
→ Par des musiciens de très très haute volée, la densité sonore et
l'engagement individuel comme collectifs sont exceptionnels.
→ La fièvre de la nouveauté s'empare de nous en réécoutant Beethoven
pour la millième fois.
♥
Haydn – les Symphonies Parisiennes –
Orchestre de Chambre de Paris, Boyd (NoMadMusic 2020)
→ Petite frustration en première écoute : attentivement, j'y
retrouve tout l'esprit (quel sens de la structure !) de cette
association formidable, mille fois admirée en concert… Mais à l'écoute
globale, j'entends plutôt l'épaisseur des timbres d'instruments
modernes, comme une petite inertie – alors qu'ils jouent sans vibrato,
et pas du tout selon le style tradi !
→ Quelque chose s'est perdu via le micro, la prise de son, l'ambiance
du studio… Pincement au cœur, je les adore en concert, mais à côté des
nombreuses autres propositions discographiques
« musicologiques », ce n'est pas un premier choix.
♥
A. Romberg – Symphony No.
4, "Alla turca" – Collegium Musicum Basel, K. Griffiths (CPO 2018)
♥♥♥
B. Romberg – Symphonies
Nos. 2 and 3 / Trauer-Symphonie (Kolner Akademie, Willens) (Ars
Produktion 2007)
→ Symphonies contemporaines de Beethoven (1811, 1813, 1830), qui en
partagent les qualités motoriques et quelques principes d'orchestration
(ballet des violoncelles, traitement thématique et en bloc de la petite
harmonie, sonneries de cor qui excèdent Gluck et renvoient plutôt à la
7e…).
→ Je n'avais encore jamais entendu de symphonies de l'époque de
Beethoven qui puissent lui être comparées, dans le style (et bien sûr
dans l'aboutissement). En voici – en particulier la Troisième,
suffocante de beethovenisme du meilleur aloi !
Brahms – Symphonies –
Pittsburgh SO, Janowski (PentaTone 2020)
→ Très tradi, sans doute impressionnant en vrai connaissant l'orchestre
et le chef, mais pas très prenant au disque par rapport à la pléthore
et à l'animation enthousiasmante des grandes versions. Assez massif,
peu contrasté et coloré, pas très convaincu (vu l'offre) même si tout
reste cohérent structurellement et inattaquable techniquement.
→ Tout de même très impressionné par la virtuosité de
l'orchestre : rarement entendu des traits de violon aussi fluides,
les cuivres sont glorieux, la flûte singulièrement déchirante…
♥
Brahms – Symphonie n°3,
lieder de Schubert orchestrés, Rhapsodies hongroises, Rhapsodie pour
alto – Larsson, Johnson, SwChbO, Dausgaard (BIS)
Mahler – Totenfeier – ONDIF,
Sinaisky (ONDIF live)
→ Cet entrain, ces cordes graves !
♥
Nielsen – Symphonie n°1 – LSO, Ole Schmidt
(alto)
→ Très énergique, mais trait gras.
♥
Nielsen – Symphonie n°1 – LSO, C. Davis
(LSO Live)
♥♥
Nielsen – Symphonie n°1 – BBC Scottish SO,
Vänskä (BIS)
♥♥♥
Nielsen – Symphonie n°1 – Ireland NSO,
Leaper (Naxos)
♥♥♥
Nielsen – Symphonies n°1,2,3,4,5,6 –
Stockholm RPO, Oramo (BIS)
→ Lyrisme, énergie mordante, couleurs, aération de la prise… une
merveille, qui magnifie tout particulièrement la difficile Sixième
Symphonie !
♥
Mahler – Symphonie n°5 – Boulez Vienne
(DGG)
→ Un peu terne et mou, du moins capté ainsi.
♥
♥
♥
Schmidt – Symphonies – Frankfurt RSO,
Paavo Järvi (DGG)
→ Au sein de ce corpus extraordinaire, voire majeur, le plaisir
d'entendre une version qui s'impose d'emblée comme colorée,
frémissante, captée avec profondeur et détails, par un orchestre de
première classe, et surtout articulée avec ce sens incroyable des
transitions qui caractérise l'art de Järvi. Chacune des symphonies en
sort grandie. Indispensable.
♥
♥
♥
Graener – Variations orchestrales sur «
Prinz Eugen » – Philharmonique de la Radio de Hanovre, W.A. Albert
(CPO 2013) → On ne fait pas plus roboratif… mon bonbon privilégié
depuis deux ans que je l'ai découvert par hasard, en remontant le fil
depuis le dernier volume de la grande série CPO autour du compositeur
(concertos par ailleurs tout à fait personnels et réussis).
SYMPHONISTES SLAVES
Tchaïkovski – Symphonie n°5, Francesca da
Rimini – Tonhalle Zürich, Paavo Järvi (Alpha 2020)
→ Ébloui en salle par le génial sens des transitions organiques de
Järvi, où chaque thème semblait se verser dans l'autre (avec
l'Orchestre de Paris), je le trouve ici plus corseté, plus raide. Je ne
sais quelle est la part de la différence de culture des orchestres
(Zürich a toujours eu un maintien assez ferme) et d'écoute un peu
distraite au disque au lieu de l'attention indivisée en salle sur tous
les détails splendides. Peut-être la prise de son un peu lointaine et
mate, aussi ? Mais ce fonctionnait très bien avec les Mahler
de Bloch…
→ Très belle lecture pas du tout expansive, très sobre et détaillée, en
tout état de cause.
→ Francesca da Rimini confirme cette impression d'interprétation très
carrée – on y entend encore l'orchestre de Bringuier !
♥
♥
Borodine – Symphonie n°1 – URSS SO,
Svetlanov
→ Là aussi, des thèmes populaires, quoique plus tourmentés. Pas très
développé mais grand caractère.
→ bissé
♥
♥
Borodine – Symphonie n°2 – Royal PO,
Ashkenazy (Decca 1994)
♥
♥
Balakirev, Kalinnikov – Symphonies
n°1 – Moscou PO, Kondrachine (Melodiya)
→ Foisonnement de thèmes folkloriques ! Interprétation pas
si typée…
♥
♥
Kalinnikov – Cedar and Palm - Bylina
- Intermezzos - Serenade & Nymphs –
The Ussr Symphony Orchestra, Evgeniy Svetlanov, (Svetlanov 1988)
♥
♥
Novák – Suite de la Bohême méridionale +
Toman & la Nymphe des Bois – Moravian PO Olomouc, Marek Štilec
(Naxos 2020)
→ Généreux slavisme qui a entendu Wagner. Le grand poème
Toman de 25 minutes est une très
belle réussite, qui culmine dans des élans richardstraussiens
irrésistibles.
→ Bissé.
♥
Vladigerov – Symphonies 1 & 2 – Radio de
Bulgarie, Vladigerov (Capriccio)
→ Le partenariat Capriccio avec les Bulgares se poursuit !
J'avais beaucoup aimé ses concertos pour piano…
SYMPHONISTES
BRITANNIQUES & IRLANDAIS
♥
♥
Bax – Symphonie n°2 – LPO, Myer
Fredman (Lyrita)
♥
♥
Scott – Symphonie n°3 « The
Muses » – BBCPO, Brabbins (Chandos)
→ Debussyste en diable (le chœur de Sirènes…), de bout en bout, et très
beau.
+ Neptune
→ Très debussyste aussi, remarquablement riche (un côté Daphnis moins
contemplatif et plus tendu). Splendide.
♥
Scott – Symphonie n°4
– BBCPO, Brabbins (Chandos)
Kinsella – Symphonies Nos. 3
and 4 – Ireland NSO, Duinn (Marco Polo 1997)
→ étagements brucknériens à certains endroits.
♥♥
Kinsella :
Symphony No. 5, "The 1916 Poets":
– Bill Golding, Gerard O'Connor, ; Ireland RTÉ National Symphony
Orchestra; Colman Pearce
Symphony No. 10 – Irish ChbO, Gábor
Takács-Nagy (Toccata Classics)
→ n°5 : avec basse et partie déclamée. Très vivant.
→ n°10 : Néoclassicisme avec
pizz et percussions prédominantes, très dansant. Vrai caractère, très
beaux mouvements mélodiques ni sirupeux ni cabossés.
SYMPHONISTES JAPONAIS
Hisatada
Otaka –
Sinfonietta pour cordes 1937 – Sendai PO, Yuzo Toyama
→ Assez lisse.
Hisatada
Otaka – Suite
japonaise (1936, orch. 1938) – Shigenobu Yamaoka
→ Orchestration de la suite piano.
Hisatada
Otaka – Midare
pour orchestre – NHK, Niklaus Aeschbacher (1956)
→ Un peu néo, du xylophone, du romantique un peu univoque, avec un côté
mauvaise imitation occidentale du japin, à la fin de la pièce. Mitigé.
♠
Akira
Ifukube -
Symphonie concertante avec piano (1941) –Izumi Tateno, Japon PO,
Naoto Otomo
→ Du planant sirupeux fade, pas trop mon univers.
Akira
Ifukube – Ballata
Sinfonica (1943) – Tokyo SO, Kazuo Yamada (1962)
→ Entre Turandot et l'Oiseau de feu, en plus simple (tire sur Orff).
→ (bissé par curiosité trois jours plus tard)
♥
♥ Yasushi
Akutagawa – Prima Sinfonia 1955 –
Tokyo SO, Akutagawa
→ Étonnant, et très riche, pas du tout sirupeux (pas mal de Mahler et
de Proko, mais dans un assortiment personnel). J'aime beaucoup.
→ Pas du tout dans le genre du symphonisme japonais post-debussyste ou,
horresco referens, post-chopinien.
7. MUSIQUE DE CHAMBRE
SONATES
♥♥♥
J. & H. Eccles, Matteis, Daniel Purcell – « The Mad Lover » –
Langlois de Swarte, Dunford (HM 2020)
→ Les Matteis et (Henry) Eccles sont fulgurants ! Quelle musique
rare, sophistiquée et jubilatoire ! Dunford improvise avec une richesse
inouïe et la musicalité de Swarte emporte tout.
♥
Rossini, Castelnuovo-Tedesco… –
« Rossiniana » (pour violoncelle & piano) – Elena
Antongirolami (Dynamic 2020)
→ Toutes sortes de variations & paraphrases, très sympa.
♠
Mendelssohn – Les 3 Sonates violon-piano –
Shlomo Mintz, Roberto Prosseda (Decca 2020)
→ Violon très baveux, dont le timbre s'altère au fil des phrasés, je
n'aime pas du tout. Et conception générale assez figée… voyage dans le
passé (et pas forcément chez les meilleurs). Pas du tout aimé.
♥♥♥
Gédalge,
Marsick, Enescu – Sonate
violon-piano n°1 / Poème d'été / Sonates 1 & 2 – Julien Szulman,
Pierre-Yves Hodique
→ Œuvres très rares, incluant celles des professeurs d'Enescu, lui
dédiant leurs nouvelles œuvres alors qu'il n'a que seize
ans !
→ Martin-Pierre Marsick, son professeur de violon, écrit clairement de
la « musique d'instrument ».
→ En revanche André Gedalge, assistant (et véritable professeur
officieux) de la classe de composition de Massenet puis Fauré, nous
livre un vrai bijou, écrit dans une veine mélodique un peu convenue,
mais où tout effet est pesé – et pèse –, avec un sens de la structure
remarquable (quels développements !). La superposition en décalé des
thèmes, dans le faux scherzo, est un coup de maître assurément.
→ Pas très séduit par la Sonate n°2 d'Enescu : trop de complexités, une
expression contournée qui déborde de partout dans l'harmonie
ultra-enharmonique, le rythme (premier mouvement en 9/4, à quoi bon),
sa fin nue anticlimactique. Plus de complexité pour moins d'effet…
→ Car la n°1, au contraire (à 16 ans !) manifeste une générosité
mélodique et un lyrisme très emportés, certes pas du tout subversifs,
mais focalisés dans une forme maîtrisée qui en accentue le caractère
profusif, jusqu'aux bouts de contrepoint du final !
→ Interprètes de premier choix (Julien Szulman, qui finit une thèse sur
Enescu au CNSM, vient d'être nommé violon solo au Philharmonique de
Radio-France), avec un violon au son assez international, dense, d'une
virtuosité immaculée et chaleureuse, sise sur la musicalité attentive,
exacte et subtile de Pierre-Yves Hodique.
♥
Dupuis – Sonate
violon-piano – Prouvost, Reyes (En Phases)
♥ Hisatada
Otaka – Concerto
pour flûte version avec piano – Miki Yanagida, Takenori Kawai (YT 2016)
→ Captation sèche qui ne fait pas épanouir toute la poésie de la pièce.
Mais plus convaincant qu'à l'orchestre, clairement, avec ses très
belles couleurs debussystes.
DUOS
♥♥
Rameau – Suites à deux clavecins tirées
des Indes, Zoroastre… – Hantaï, Sempé (Mirare)
♥♥
A. Romberg &
B. Romberg – Duos for violin and
cello – Barnabás Kelemen, Kousay Kadduri (Hungaroton 2002)
→ Interprétation très tradi, pas très exaltante, de ces duos
remarquablement écrits, quoique moins fascinants que ceux pour
violoncelle.
→ Les variations finales du troisième duo Op.1 sont écrites sur le
premier air d'Osmin de l'Enlèvement au Sérail !
→ Quant au premier duo d'Andreas Romberg, il se fonde sur « Se
vuol ballare » des Noces de Figaro ; le second, sur
« Bei Männerm », le duo Pamina-Papageno…
A. Romberg &
B. Romberg – Duo for Violin and
Cello in E Minor, Op. 3, No. 3 – Duo Tartini (Muso 2019)
♥
Wagner – Götterdämmerung
final par Tal & Groethuysen sur deux pianos (Sony)
→ Chouette initiative, mais manque un peu de fièvre.
♥
Fauré, Widor, Dupré, D. Roth,
Falcinelli, Mathieu Guillou, J.-B. Robin
– « L'Orgue chambriste, du salon à la salle de concert »
–Thibaut
Reznicek, Quentin Guérillot (Initiale 2020)
→ Beau programme (en particulier Roth, intéressé aussi par l'inattendue
Sonate de Dupré), beau projet, où je découvre un violoncelliste au
grain extraordinaire, Thibaut Reznicek, sacré charisme sonore !
Hisatada
Otaka – Midare
capriccio pour deux pianos – Shoko Kawasaki, Jakub Cizmarović (YT 2015)
TRIOS
Beethoven – Trios Op.1 n°3 et Op.11,
arrangement anonyme pour hautbois, basson et piano – Trio Cremeloque
(Naxos, octobre 2019)
→ On perd clairement en conduite des lignes et en nuances, avec les
bois. Mais très agréable de changer d'atmosphère.
♥♥
B. Romberg: 3 Trios,
Op. 38: – Dzwiza, Gerhard; Fukai, Hirofumi; Stoppel, Klaus
(Christophorus 2007)
→ Étonnant effet symphonique de ces trois cordes graves !
♥
Tchaïkovski-Goedicke
– Les Saisons – Varupenne, Trio Zadig (Fuga Libera 2020)
→ La redistribution de la matière pour piano seul à trois instruments
(dont le piano…) n'est pas la chose la plus exaltante du monde
(mélodies au violon, piano simplifié…), mais c'est une occasion
d'entendre un des meilleurs trios de l'histoire de l'enregistrement
dans un répertoire qu'ils servent merveilleusement – hâte qu'ils
gravent le Trio de Tchaïkovski, qu'ils jouent mieux que personne.
→ Et en effet, (Ian) Barber particulièrement en forme, Borgolotto
toujours d'une présence sonore impérieuse, Girard-García un peu
sous-servi par l'encloisonnement dans un disque, mais on sent toute son
élégance néanmoins. D'immenses musiciens à l'œuvre, on l'entend.
Saint-Saëns – Violin Sonata No. 1, Cello Sonata
No. 1 & Piano Trio No. 2 – Capuçon, Moreau, Chamayou (Erato 2020)
→ Surtout impressionné par le grain et la présence de Moreau,
saisissants. Le son très rond / vibré de Capuçon convient un peu moins
bien à Saint-Saëns (surtout la Sonate) qu'aux Brahms et Fauré où il a
fait merveille avec sa bande !
♥♥
Magnard – Piano Trio in F
Minor / Violin Sonata in G Major – Laurenceau, Hornung, Triendl
(CPO)
→ Merveille, et à quel niveau ! (lyrisme de Laurenceau, et
comme Hornung rugit !)
♥♥♥
Clarke – 3 Mvts for 2
violins
& piano / Sonates violon-piano : en ré, fragments en
sol / Trio
Dumka / Quatuor– Lorraine McAslan, Flesch SQ, David Juriz, Michael
Ponder, Ian Jones… (Dutton Epoch 2003)
→ Le trio à deux violons et surtout la Sonate en ré sont des sommets de
la musique de chambre mondiale, d'une générosité incroyable, et sises
sur une très belle recherche harmonique qui doit tout à l'école
française.
♥♥
Graener – Trios avec piano
– Hyperion Trio (CPO 2011)
→ Lyrique et simple pour la musique aussi tardive, ce fait
remarquablement mouche ! (Plus proche de Taneïev que des
décadents allemands.)
QUATUORS À CORDES
♥
Beethoven, Quatuor n°1 / Bridge, Novelettes / Chin, Parametastrings – « To Be
Loved » – Esmé SQ (Alpha)
→ Très vivante version de l'excellent n°1 (enfin, dans l'ordre
d'édition) de Beethoven. (Testées en salle : énergie folle dans le
n°11.)
→ Pépiements sympas de Chin.
♥♥♥
Beethoven, Quatuor n°3, Orford SQ (Delos)
→ Superbe détail.
+ Cremona, Takács, Bartók, Jerusalem, Belcea
♥♥♥
Beethoven, Quatuor n°4, Orford SQ
(Delos)
→ Pas très tendu, mais remarquablement articulé !
+ Quatuor n°15 : là aussi pas un sommet émotionnel, mais j'aime
beaucoup certe individualisation extrême des voix !
♥♥
Arriaga – Quatuors – La
Ritirata (Glossa 2014)
→ Très belle lecture sur instruments anciens. Reste un corpus bien plus
mineur que ses œuvres orchestrales, d'un jeune romantisme encore assez
poliment classique.
→ Le rare Tema variado en cuarteto est en revanche une petite
merveille !
♥♥♥
Stenhammar : Quatuors 3 & 4 – Stenhammar
SQ (BIS)
♥♥♥
d'Albert – Quatuors – Sarastro SQ
(Christophorus)
♥♥
Weigl String Quartet No. 3
//
Berg Op.3 – Artis SQ (Orfeo)
→ Richesse et véhémence remarquables de ce corpus sans comparaison avec
les pâles symphonies ! Parmi les très grands quatuors du
premier XXe siècle.
→ Le Berg est vraiment très beau, d'une tonalité tourmentée.
Weigl – 5 Lieder pour soprano & quatuor Op.44, Quatuor n°5 –
Patricia Brooks, Iowa SQ (NWCRI 2010)
→ Son ancien.
♥♥
Weigl – String Quartets Nos. 1 and 5 (Artis
Quartet) (Nimbus)
→ Richesse et véhémence remarquables de ce corpus sans comparaison avec
les pâles symphonies ! Parmi les très grands quatuors du
premier XXe siècle.
♥♥
Weigl – String Quartets Nos. 7 & 8 –
Thomas Christian Ensemble (CPO 2017, parution en dématérialisé le 3
juillet 2020)
→ Weigl est donc un grand compositeur… mais certainement pas de
symphonies ! Ces quatuors, plus sombres, mieux bâtis, d'une
veine mélodique très supérieure et d'une belle recherche harmonique,
s'inscrivent dans la veine d'un postromantisme dense, sombre, au
lyrisme intense mais farouche, à l'harmonie mouvante et expressive. Des
bijoux qui contredisent totalement ses jolies symphonies toutes fades.
(On peut songer en bien des endroits au jeune Schönberg, à d'autres à
un authentique postromantisme limpide mais sans platitude.)
→ Aspect original, le spectre général est assez décalé vers
l'aigu : peu de lignes de basses graves, et les frottements
harmoniques eux-mêmes sont très audibles aux violons, assez haut. avec
pour résultat un aspect suspendu (le Quatuor de Barber dans le goût des
décadents autrichiens…) qui n'est pas si habituel dans ce répertoire.
♥♥
Weingartner – Quatuor n°5, Quintette à cordes
– Sarastro SQ, Petra Vahle (CPO)
→ Rien trouvé de très saillant, à réessayer encore ?
→ trissé. toujours rien.
♥♥♥
Hahn – Quatuors à cordes, Quintette
piano-cordes – Tchalik SQ, Dania Tchalik (Alkonost 2020)
→ Encore un coup de maître pour l'élargissement répertoire avec le
Quatuor Tchalik ! La sophistication souriante de la musique
de chambre de Hahn, où le compositeur a clairement laissé le meilleur
de sa production (particulièrement dans ces œuvres, ainsi que dans le
Quatuor piano-cordes qui manque ici), se trouve servie avec une ardeur
communicative.
→ Le déséquilibre antérieurement noté entre violon I & violoncelle
très solistes d'une part (les frères), petite harmonie très discrète
d'autre part (les sœurs) s'estompe au fil des années vers un équilibre
de plus en plus convaincant. Et toujours cette prise de risque
maximale, au mépris des dangers.
→ Grandes œuvres serives de façon très différente des
Parisii :(qui étaient plus étales et contemplatifs, plus voilés,
moins solistes, très réussis aussi).
→ Saint-Saëns, Hahn, Escaich… en voilà qui ne perdent pas leur temps à
rabâcher le tout-venant ! (Merci.)
→ Bissé.
♥
Novák – Quatuor n°3 – Novák
SQ (SWR Classic Archive, parution 2017)
→ Très folklorisant et en même temps pas mal de sorties de route
harmoniques, sorte de Bartók gentil. On sent la préoccupation commune
du temps.
♥♥♥
Scott – Quatuors 1,2,4 – Archeus SQ
(Dutton Epoch 2019)
→ Très marqués par l'empreinte française (on y entend beaucoup Debussy,
le Ravel de Daphnis également), des bijoux pudiques, d'une
sophistication discrète et avenante. Un régal absolu !
♥♥
Bridge, Holst, Goossens, Howells,
Holbrooke, Hurlstone – « Phantasy » –
Bridge SQ (EM Records)
→ Goossens impressionnant. Howells frémissant…
AUTRES QUATUORS
♥
Ritter – Quatuors avec
basson – Paolo Cartini, Virtuosi Italiani (Naxos 2007)
→ Très joliment mélodique. Moins riche et virtuose que Michl.
♥
B. Romberg: Variations
and Rondo, Op. 18 – Mende, Trinks, Pank & piano (Raumklang 2012)
→ Très beau postclassique.
QUINTETTE
♥
Bax – Quintette avec piano – Naxos
♥♥♥
Scott, Bridge – Quintette avec piano
n°1 / en ré mineur – Bingham SQ, Raphael Terroni (Naxos 2015)
→ Beau Quintette de Bridge, splendide de Scott, avec son premier
mouvement très… koechlinien-2 !
→ Bissé Scott.
SEXTUOR ET
AU DELÀ
♥♥♥
Weingartner – Sextuor pour quatuor,
contrebasse & piano / Octuor pour clarinette, cor, basson, quatuor
& piano – Triendl (CPO)
→ Complètement fasciné par le Sextuor pour piano et cordes (la pochette
dit Septuor à tort). Un lyrisme extraordinaire.
→ bissé
♥
Chabrier – Souvenirs de
Munich (arrangement David Matthews pour ensemble) – Membres du Berlin
PO, Michael Hasel (Col Legno 2009)
→ Doublures étranges qui accentuent le côté foire de ces réminiscences
de Tristan façon quadrille.
Roussel,
Koechlin, Taffanel, d'Indy, Messager, Françaix, Chabrier, Bozza, Tansman –
musique française pour vents et piano – V. Lucas, Gattet, Ph. Berrod,
Trenel, Cazalet (solistes de l'Orcheste de Paris), Wagschal (Indésens
2020)
→ Joli ensemble, pas le meilleur de la production chambriste française
(excepté les extraits de la Suite de d'Indy), avec des timbres assez
blancs, il existe plus exaltant ailleurs même si le projet est très
beau et mérite d'être salué !
HORS DES FRONTIÈRES
♥♥
de Mey – Musique de table – James Cromer,
Corey Robinson, Gregory Messa (vidéo culte d'Evan Chapman)
8.
SOLOS
Froberger –
Œuvres pour orgue – Temple Saint-Martin de Montbéliard, Coudurier (BNL)
Folías par Frédéric Muñoz à
l'orgue de Guimiliau –
https://www.youtube.com/watch?v=EX8OSpPboz4
(YT 2017)
→ Superbe orgue XVIIe en état de jeu. Pourquoi ne s'en sert-on pas
davantage pour les enregistrements, plutôt que des instruments
contemporains de la composition (qu'il y avait moins de probabilité de
pouvoir jouer à l'époque, car en petit nombre), voire
postérieurs ?
♥
Gabrielli,
Biber, Young –
« Jacob Stainers Instrumente » – Maria Bader-Kubizek, Anita
Mitterer, Christophe Coin (Paladino 2020)
→
La Partita 6 de l'Harmonia artificiosa-ariosa est marquante par son
vaste air à variations de 13 minutes et son langage un peu original.
→ La parenté des traits de (Domenico) Gabrielli avec les figures des
Suites pour violoncelle de Bach reste toujours aussi frappante. (Coin
fait merveille dans ce grand solo.) Elles sont assez bien
documentées
au disque, ce sont des bijoux.
♥♥
Gabrielli – Œuvres
complètes pour violoncelle – Hidemi Suzuki, Balssa, Otsuka (Arte
dell'arco 2012)
→ Quels solos bachiens, en plus rayonnants !
→ Bissé.
♥♥
Giuliani – Le Rossiniane – Goran Krivokapić,
guitare (Naxos 2020)
→ Réellement des arrangements (virtuoses) de grands airs rossiniens, en
particulier comiques (Turco, Cenerentola…), très bien écrits (quel
symphonisme !) et exécutés avec une rare qualité de timbre et de
phrasé.
♥
Bach, Chorals / Elgar, Sonate 1 / Lefébure-Wély Boléro / Karg-Elert 3 Impressions / John Williams, 3 arrangements de Star Wars –
Nouvel orgue de la cathédrale Saint-Stéphane de Vienne, Konstantin
Reymaier (DGG 2020)
→ Splendides Bach pudiques sur jeux de fonds, une transcription de
Williams réussie, les frémissements du trop rare Karg-Elert, un joli
Elgar sérieux inattendu… Superbe récital.
9.
MADRIGAL, AIR DE COUR, LIED & MÉLODIE
MADRIGAL & AIR DE COUR
♥♥♥
Monteverdi – Combattimento
– Beasley & Regenc'hips en concert (YT)
Lanier, Ramsey, Jenkis, Banister, Lawes,
Webb, Hilton… – « Perpetual Night » – Richardot,
Correspondances, Daucé (HM 2018)
→ Ni les œuvres ni la manière ne me font dresser l'oreille, je l'avoue.
Très rond, confortable, contemplatif, le tout manque vraiment d'arêtes,
d'événements.
♥♥
Jacquet
de La Guerre – Le
Déluge – Poulenard, Verschaeve, Giardelli, Guillard (Arion)
♥
Monteverdi, Purcell, Haendel
– « Guerra amorosa » – Nigl, Pianco, Ghielmi (Passacaille
2012)
♥♥
Cerutti,
Auletta, Tartini, Mayr, anonymes – « Il Gondoliere
veneziano » – Holger Falk, Nuovo Aspetto (WDR 2020)
→ Varié et réjouissant, chanté avec verve !
♥
Steffani,
Vivaldi, Hahn, Satie… –
« Eternity » Kermes & Gianluca Geremia, théorbe (Simone
Kermes 2020)
→ Très joli album planant et délicat, sur son propre label. 30 minutes
de musique, un format uniquement dématérialisé je suppose.
LIEDER ORCHESTRAUX
♥♥♥
Schubert – An Schwager
Kronos (orchestration Brahms)
→ Monteverdi Choir ♥
→ Schroeder, AMSO, Botstein (horriblement engorgé)
→ Steffeb Lachenmann, Brandenburger Pkr, gernot Schulz (mou et pas
ensemble)
→ Johan Reuter, SwChbO Dausgaard (orch en folie) ♥♥♥
♥♥♥
Schubert – «
Nacht
und Träume » (orchestrations de Berlioz, Liszt, Reger, R. Strauss,
Britten) – Lehmkuhl, Barbeyrac, Insula O, Equilbey (Warner 2017)
→ Splendidement chanté, accompagné sur instruments d'époque, un régal.
→ bissé
♥♥
Schubert – Lieder
orchestrés
par Max Reger – Ina Stachelhaus, Dietrich Henschel, Stuttgarter
Kammerorchester, Dennis Russell Davies (MDG 1998)
♥
Schubert – Lieder orchestrés (Liszt,
Brahms, Offenbach, Reger, Webern, Britten…) – von Otter, Quasthoff,
COE, Abbado (DGG 2003)
→ Orchestrations pas nécessairement passionnantes en tant que telles,
même si entendre Schubert dans ce contexxte dramatisé fait plaisir.
(Les Webern sont franchement décevants.)
→ Splendide orchestre (même si direction un peu hédoniste), von Otter
un peu fatiguée mais fine, Quashoff à son faîte.
→ Étonnement : les attaques de l'orchestre sont de façon récurrente
désynchronisées des chanteurs (pas mal de retards, quelques-fois de
l'avance). Typiquement, Die Forelle, Ellens Gesang…
On parle d'Abbado, du COE, de von Otter qui a chanté du R. Strauss à la
scène, je ne sais pas trop comment / pourquoi c'est possible. (Je ne
vois pas à quoi ça sert si c'est volontaire, pour moi ça ressemble au
chef qui attend le phrasé de la chanteuse mais qui réagit un peu tard.)
Peut-être est-ce que l'attaque est au bon endroit mais que le gros du
son parvient plus tard. (Mais justement, en principe c'est anticipé par
les musiciens, les contrebasses attaquent toujours avec un peu d'avance
pour cette raison.)
♥♥♥
Fried – Die verklärte Nacht – Ch. Rice,
Skelton, BBCSO, Gardner (Chandos 2021)
→
Chef-d'œuvre absolu du lied orchestral décadent,
tout en vapeurs, demi-teintes et éclats aveuglants, cette
Nuit transfigurée
bénéficie à présent d'une seconde version, aux voix très différentes
(Rice plus charnue et timbrée, Skelton plus sombre) et à la direction
très lyrique. Je conserve ma tendresse pour Foremny qui privilégie le
mystère initiatique plutôt que les couleurs orchestrales (et la clarté
éclatante de Rügamer dans la transfiguration est un bonheur sans
exemple !), mais disposer d'un second enregistrement, et de niveau
aussi superlatif, est absolument inespéré – et quoique dès longtemps
attendu.
→ Parution en janvier 2021, mais les chanteurs ont déjà fait fuiter sur
les comptes YouTube respectif la plupart des pistes vocales…
→ (déjà écouté une dizaine de fois)
♥♥♥
Fried – Die verklärte Nacht – Foremny
→ (réécouté à peu près autant de fois le mois passé…)
♥♥
Schoeck – Nachhall – Arthur Loosli, ChbEns
Radio de Berne, Theo Loosli – (Jecklin 2015)
→ Tout est plus clair, l'orchestre (moins dramatique, certes), le chant…
♥♥
Schoeck – Nachhall –
Hancock, AmSO, Botstein (AmSO)
→ Splendide ambiance de fin du monde mélancolique.
♥♥♥
Fefeu & Gérard
Demaizière – L'An 1999
– François Juno (RGR
1979)
→ et diverses parodies (version metal, version symphonique, version
épique…), voire son interprétation imaginaire de Quelque chose en nous
de Tennessee…
LIED & MÉLODIE
Schubert, Spohr, Weber, Giuliani
– Lieder arrangés avec guitare – Olaf Bär, Jan Začek (Musicaphon
2007)
♥♥
Beethoven – Lieder (An die
ferne Geliebte) – Bär, Parsons (EMI 1993)
♥♥♥
Beethoven, Schubert, Britten… – « I
Wonder as I Wander » – James Newby, Joseph Middleton (BIS 2020)
→ Splendide voix de baryton-basse, mordante, clairement dite, sensible
aux enjeux dramatiques, aussi à l'aise dans la demi-teinte
a cappella des Britten que dans la
gloire mordante des poèmes les plus expansifs. Grand
liedersänger très à son aise ici,
et une fois de plus très bien capté par BIS.
♥♥♥
Beethoven ferne Geliebte, Schubert, Rihm – « Vanitas » – Nigl, Pashchenko
(Alpha)
→ Accompagné sur piano d'époque.
→ Emporté d'emblée par les mots et le phrasé de cette
ferne Geliebte ; splendeur de
cette voix claire et souple, adroitement mixée et extraordinairement
expressive (Beethoven !).
→ Concentration et la clarté de cette voix assez incroyables, on dirait
un représentation de l'époque glorieuse des années 50-60, j'entends la
concentration du son des très grands ténors d'autrefois (quelque part
entre Cioni et Tino Rossi pour l'allègement délicat).
→ (Mais je ne comprends pas pourquoi il est noté baryton, c'est assez
clairement un ténor pour moi, même s'il chante dans des tessitures
centrales… Peut-être l'équilibre harmonique de la voix est-il différent
en personnel.)
→ Et tout cela lui permet une finesse d'expression assez
extraordinaire. (Rihm très réussis, je ne suis pas sûr que cet univers
un peu raréfié m'aurait autant séduit sinon !)
♥♥
Schubert – Die junge Nonne
→ Ameling, Baldwin ♥♥
→ Ludwig, Gage
♥♥
Mahler – Wundherhorn – Gerhaher, Huber
(RCA)
♥
Mahler – Ruckert-Lieder /
Des Knaben Wunderhorn– Bauer, Hielscher (Ars Musici 2003)
→ Voix vraiment claire, manque d'assise et d'incarnation pour une
fois !
♥♥
Schoeck – Notturno – Gerhaher, Rosamunde
SQ
→ Gerhaher très peu vibré, un peu sophistiqué, mais remarquable. Le
grain du quatuor est fantastique.
♥
Mitterer – Im Sturm – Nigl,
Mitterer (col legno 2013)
→ Très mélodique (et le naturel de Nigl !), sur poèmes romantiques,
avec bidouillages acousmatiques un peu stridents (trop proches dans la
captation, on reçoit tout dans les oreilles sans distance) mais pas
déplaisants.
→ Beaucoup de citations (Ungeduld de la Meunière), quasiment de l'a
cappella avec des effets atmosphériques autour… Fonctionne très bien
grâce à l'incarnation exceptionnelle de Nigl !
LISTE D'ÉCOUTES à
faire – nouveautés
→ reich eight lines
→ philippe leroux : nous par delangle (BIS)
→ Ch Lindberg
→ kontogiorgos, kaleidoscope pour guitare
→ adiu la rota
→ australian music two pianos « the art of agony »
→ elisabetta brusa ulster O
→ rossini matilde di shabran passionart O
→ haydn messe st tolentini naxos
→ vivaldi argippo eura galante
→ fürchtet euch nicht
→ letters chamber choir ireland
→ stanford chamber somm
→ alcione Marais
→ arte scordatura
→ trios alayabiev glinka rubinstein, brahms Trio (naxos)
→ martynov : utopia
→ boesmans & cornet à bouquin
→ asperen louis couperin
→ tabarro puccini janowski jagde
→ quartetto cremona : italian postcards
→ dmytro popov hymns of love
→ gurrelieder thielemann
→ Schubert: Lieder (orchestrations de Mottl, Britten, Liszt, Brahms,
Berlioz, Strauss, Reger, Webern...)/Barbeyrac, Lehmkuhl, Equilbey
→ mahler lied erde bloch
(plus tous les autres des listes précédentes…)
LISTE D'ÉCOUTES à
(re)faire – autres
→ Christie Combattimento
→ symphs Romberg
→ Bruch symphs
→ legrenzi sedecia
→ legrenzi missa lauretana
→ LEGRENZI, G.: Concerti musical per uso di chiesa, Op. 1 (Oficina
Musicum Chorus, Favero)
→ GOOSENS, E.: Violin Sonata No. 1 / HURLSTONE, W.: Violin Sonata in D
Major / TURNBULL, P.: Violin Sonata in E Minor (Mitchell, Ball)
→ Chamber Music - LALLIET, C.-T. / POULENC, F. / RACHMANINOV, S. /
RAVEL, M. (Trio Cremeloque)
→ BACH, C.P.E.: Oboe Concerto, Wq. 164 and 165 / Solo, Wq. 135
(Ebbinge, Amsterdam Baroque Orchestra, Koopman)
→ wellesz symph 1
→ alwyn symph 3
→ křenek symph 2
→ oratorium fanny
→ farrenc sextuor & trio
→ schoeck notturno bär
→ froberger moroney org robert-dallam de lanvellec
→ lebendig begraben
→ bax 2 lloyd ou lyrita
→ rééd rückert minton boulez
→ coin
→ mosaïques SQ der Beeth
→ Blancrocher - L’Offrande. Pièces de Froberger, Couperin, Dufaut et
Gaultier:
→ forqueray intégral devérité & friends, rannou…
→ schoeck nathan berg griffiths) + opéras
→ lalande laudate
→ bär gelibte
→ Lamia de Dorothy Howell
→ vivaldi baiano cctos clvcn
→ holger falk + nigl + newby
→ Lugansky franck debussy
→ Rawsthorne McCabe, Hoddinott, Mathias. Bate et
Benjamin, coles. swayers.
→ Solemnis gardiner
→ A. Rawsthorne, Symphony No. 2
→ reutter op.58,56,jahreszeiten
→ Robert Simpson, Symphonie n°9, Bournemouth SO, Vernon Handley.
→ rubbra ccto pia
→ Coles : je réécoute les Four Verlaine Songs pour la dixième fois
aujourd'hui, c'est véritablement renversant.
→ e préfère moi aussi la No. 2 de Boughton et pas qu'un peu,
→ stephan sieben saiteninstrumente, horenstein ensemble ( et suite pour
quatuor de butterworth)
→ Michel dens
→ Goublier - Mélodies lyriques populaires (6) : baryton, choeurs, et
Orchestre - Michel Dens - HD
→ The Primrose Piano Quartet : Hurlstone, Quilter, Dunhill, Bax
→ BRITISH PIANO QUARTETS : Mackenzie, Howells, Bridge, Howells,
Stanford, Jacob, Walton (The Ames Piano Quartet)
→ Viola Sonatas, Idylls & Bacchanals : McEwen, Maconchy, Bax,
Jacobs, Rawsthorne, Milford, Leighton (Williams/Norris)
(plus tous les autres des listes précédentes…)
… et voici pour la dernière livraison de l'année 2020, deux ans
complets de traque aux pépites nouvelles – et il y en a beaucoup, même
en mettant l'accent sur les répertoires délaissés ou les
interprétations hors du commun !
Je n'ai pas encore décidé si je poursuivais l'aventure en 2021 : je
fais ce repérage pour moi-même, mais la mise en forme lisible prend à
chaque fois plusieurs heures, et j'ai plusieurs séries de notules que
j'aimerais davantage achever, poursuivre ou débuter. Je me disais que
ce pouvait être utile, puisque j'écoute beaucoup et laisse des traces
écrites, mais en fin de compte, devant la masse, je crains de noyer mes
lecteurs plus que de les éclairer. Et cela suppose aussi que mon agenda
soit gouverné par les parutions plutôt que par ma fantaisie (ce qui
n'est pas bien).
Ce qui est sûr, c'est que je n'aurai pas le temps de faire la
remise des prix des disques de
l'année. Ce serait absurde de toute façon : même en choisissant un
disque par genre et par époque, je serais obligé de trancher de façon
parfaitement arbitraire. Il y a beaucoup de choses à découvrir, avec
leurs commentaires à chaque fois, aussi je vous invite, si vous
souhaitez façonner votre propre bouquet, à remonter la piste du
chapitre correspondant dans CSS, et à faire votre
choix parmi les disques mentionnés en bleu-violet ou 2-3 cœurs !
Si jamais vous vous interrogiez sur la conclusion
l'année Beethoven, j'ai ici commis
une petite
suite de tweets où je relève ce qui m'a paru
marquant, en classant par genre – et en incluant les disques traitant
des contemporains, puisqu'il y a eu beaucoup de parutions majeures
autour de Salieri / Rejcha / B. Romberg / Hummel / Moscheles que vous
seriez fort avisés de ne pas négliger… (En revanche, il y eut extrêmement peu de raretés du catalogue de Beethoven à proprement parler.)
Belles explorations à vous, et à bientôt, sous d'autres formats sans
doute !




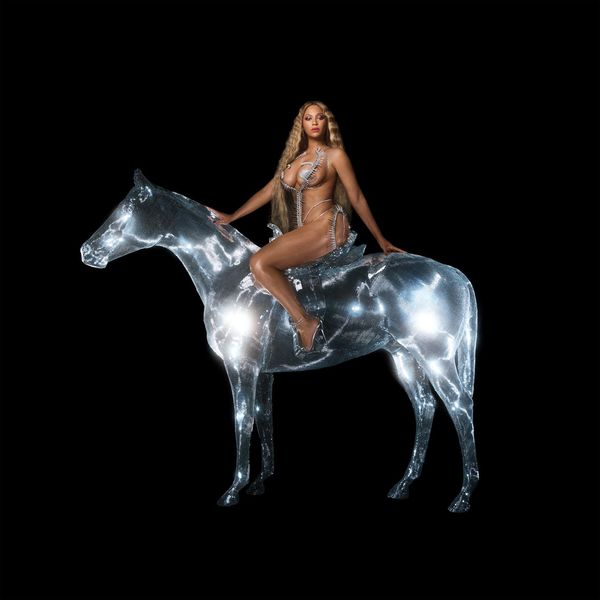













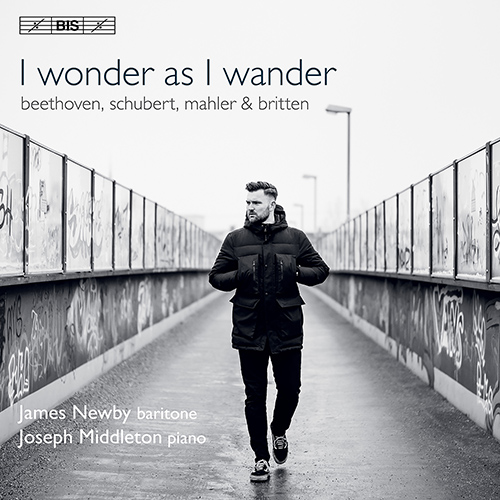










 J'irai voir si elle a fait un peu de mélodie
en demi-finale, ce serait intéressant.
J'irai voir si elle a fait un peu de mélodie
en demi-finale, ce serait intéressant.










 : dispensable
: dispensable : ouille
: ouille