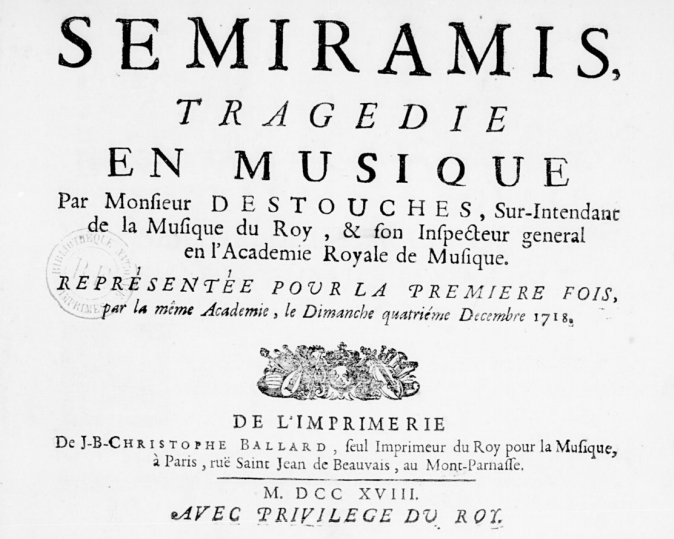Un immense concours, par LULLY
attiré,
Découvrit l'imposture tout écumant de rages :
Qu'aurait Dauvergne osé ? – Grands gestes et visages
De toutes parts tournaient vers l'oracle admiré.
Bref, on me demande, je réponds.
Le Concert Spirituel joue, dans une distribution éclatante constituée
des meilleurs spécialistes (M. Vidal, Guilmette, Christoyannis, K.
Watson, Teitgen, Kalinine, Santon, Lenormand, Dubois, Dolié, Z. Wilder
!),
Persée de LULLY,
mais
dans sa dernière révision de 1770,
celle qui fut chantée par Sophie Arnould (
1,
2,
3,
4) et Henri Larrivée !
Le concert vient d'être donné à Metz et passe ce soir au Théâtre des
Champs-Élysées, la semaine prochaine à l'Opéra Royal de Versailles.
En 1770, il s'agit d'agrémenter le mariage de Marie-Antoinette
d'Autriche avec le Dauphin, et d'inaugurer l'Opéra Royal du château de
Versailles, rien de moins.
Comme c'était l'usage tout au long du XVIIIe, les tragédies en musique
dotées du
plus
grand succès sont
reprises, mais
adaptées au goût du temps. Les poèmes de Quinault étaient
réputés indémodables, et malheur à ceux qui y touchaient,
tel
Pitra pour Racine, pour les besoins de la cause –
Marmontel
fit les frais de ces quolibets
pour Atys recomposé
par
Piccinni et, justement, pour une récriture de
Persée, en 1780 (toute la musique y
est, semble-t-il, de Philidor).
En principe, comme la sobre galanterie des vers de Quinault et
l'expressivité de la prosodie de
LULLY sont considérées
comme inégalables,
les adaptateurs
récrivent surtout l'
Ouverture,
les
danses, vers une forme
plus vive (plus ramiste, pourrait-on dire), et
certains airs. L'essentiel des
récitatifs est en principe conservé.
Ces adaptations vont aussi dans le sens d'une plus grande concision du
texte : il n'est pas rare, comme ici, que les cinq actes en deviennent
quatre. Malgré les remarques désagréables sur le livret (j'y
reviens),la musique a rencontré un assez beau succès.
1.
Pourquoi jouer cette version adaptée ?
Je vois plusieurs motivations assez puissantes, et ce n'est pas la
suppression du Prologue
pour faire plaisir à Hervé Niquet, puisque Bernard de Bury en a composé
un autre un nouveau texte (sera-t-il joué ?).
Comme précisé en commentaires : ce
Prologue a été composé en 1747 par Bernard de Bury, et n'a pas été
repris dans la version de 1770. (Vu l'aspect très post-ramiste de
l'Ouverture, voire gosseco-grétrysant, je gage qu'elle a aussi été
récrite en 1770, peut-être plutôt par Dauvergne, en charge des actes I
et IV – hypothèse confirmée par le document reproduit ci-après.)
¶ L'intérêt
pour les chercheurs,
auxquels sont adossés les concerts du CMBV : on parle souvent de ces
adaptations, et on les entend peu. Ou alors des refontes du compositeur
(versions de
Castor et Pollux ou de
Dardanus de Rameau), ou des
recompositions comme l'
Armide
de Gluck ou l'
Atys de
Marmontel ; mais les
remises à neuf
d'opéras de LULLY avec
conservation de portions anciennes, c'est très rare. Il faut donc au
moins essayer pour voir – même si les
LULLYstes qui rôdent
dans ces pages seront forcément déçus de la ramisation rampante de la
bonne musique.
¶
Persée a déjà été
donné récemment à l'Opéra Royal de
Versailles, et n'a pas la réputation d'
Atys
ou d'
Armide pour maintenir un
public aussi fréquemment : c'est une façon de
renouveler l'intérêt du public
d'aujourd'hui aussi, de suggérer qu'on redonne du neuf. (Même si je
crois que, justement, le public est rassuré par la présence de noms et
de références familiers.)
¶ Enfin, même s'il n'a guère été mis en avant, l'argument de
l'inauguration de l'Opéra Royal
et du mariage du futur Louis XVI a sans doute un aspect assez flatteur
pour ceux qui aiment à s'imaginer dans les chaussons des Grands
d'autrefois, vivre le frisson de l'histoire en se figurant qu'on
pourrait, soudain, s'incarner dans un quelque-part (confortable) du
passé.
Je crois cependant que l'argument « recherche du CMBV » est le plus
pertinent, dans la mesure où un titre célèbre de
LULLY est
meilleur moyen de remplir
que tous les autres argumentaires évoqués ; et dans la mesure, aussi,
ou le CMBV décide bel et bien de la programmation en fonction des
actualités de sa propre recherche.En témoigne le colloque dont vous
pouvez trouver, ici,
le détail.
 Lullyste après un soir de
Dauvergne, stuc vers 1770.
Lullyste après un soir de
Dauvergne, stuc vers 1770.
Hôtel de Luzy, 6 rue Férou à Paris.
2. À
quoi ressemble le livret ?
C'est donc la question qui m'a été posée sans relâche. Voici un début
de réponse.
Le livret a été remanié pour l'occasion par
Nicolas-René Joliveau, secrétaire
perpétuel de l'Académie
(Royale / Française) ; le poème dramatique est d'1/3 plus court que
celui de Quinault, dont il n'a donc conservé que la moitié – le texte
final ne contient donc qu'environ1/5 de vers nouveaux.
En réalité,
Joliveau coupe ce qui est
(paradoxe, considérant le goût dramatique et musical du temps !)
le plus décoratif, et conserve
l'action principale de Quinault. Il fusionne l'action des actes IV et V
– il est vrai que cette double fin
était bien étrange, de nouvelles péripéties surgissant à coup de magie
une fois la victoire remportée contre la Gorgone, les réunir dans un
acte unique n'a rien d'absurde. Nombre de rôles campant simplement un
caractère précis (le Grand Prêtre…) disparaissent, et les parents
d'Andromède (Mérope et Céphée) sont réduits à laportion congrue.
Le chœur est au contraire élargi,
et
ses dernières interventions, de même que la tirade de Vénus écrite par
Joliveau (« Hymen, d'un jour si beau consacre la mémoire ») ou la
passacaille
du divertissement final, célèbrent à mots à peine voilés l'union du
Dauphin et de la Dauphine.
Les critiques les plus violentes subies par Joliveau (car il était
indispensable d'adapter Quinault &
LULLY, mais
adaptateurs se faisaient toujours démolir pour leur incompétence ou
leur impudence, surtout les poètes !) portent sur la
« correction » de 11 vers de Quinault,
conservés mais altérés, ce qui a suscité une ire dont mesure mal la
force si l'on ne lit pas les imprécations des contemporains.
3.
Que contient la musique ?
Les visuels de promotion du spectacle ne sont pas très clairs,
puisqu'il reste du
LULLY, largement remplacé / augmenté par
Antoine Dauvergne, qui n'est pas le
seul à officier, puisque
François
Rebel (acte II) et
Bernard de
Bury (acte III) contribuent aussi.
Les notices bibliographiques du
Fonds Philidor
(il faut aller chercher dans l'aborescence, donc je reproduis
l'information ci-après) détaillent la contribution de Dauvergne :
ACTE I [Vol. 1]
- p. 1-13 : Ouverture. Fièrement, sans lenteur, puis Allegro, Ut
Majeur, C/, 3
[SCÈNE 5]
- p. 23 : Ritournelle, sol mineur, 2
- p. 29 : Annonce, sol mineur, 2
- p. [30-[32] : Marche, sol mineur, 2
- p. 33-41] : Trio et Choeur. O déesse veillez sur nos jours
(Trois Éthiopiens, Choeur), sol mineur, 3
- p. 43 : Air grave pour la lutte, Ut Majeur, C/
- p. 44-54 : Air vif. Presto, Ut Majeur, 3
- p. 55-61 : Air pour l'exercice de l'arc. Presto, Ut Majeur, 6/8
- p. 62-63 : [Air et Choeur]. [Des beaux noeuds de l'hymen]
protectrice adorable (Une Éthiopienne, Choeur), la mineur, 3 [début
raturé]
- p. 64-65 : Air pour la danse gracieuse. Voluptueusement, La
Majeur, 3 [2e partie raturée]
- p. 65-[67] : Air pour la danse vive. Gaiment, La Majeur, 2
- [68]-[73] : 3e Air pour la danse gracieuse et vive en même
tems. Allegro, La Majeur, 2/4
- p. 74-84 : Choeur. Fière trompette éclatez dans les airs,
Vivement, Ré Majeur, 2
- p. 87-88 : Entracte, Sol Majeur, C/
ACTE IV [Vol. 2]
[SCÈNE 2]
- p. [59]-[67] : [Duo] Les vents impétueux (Mérope, Phinée), Si b
Majeur, 3 [quelques bribes vocales de Lully]
SCÈNE 3
- p. [67]-[71] : Choeur [et récit] O ciel inexorable (Mérope,
Phinée, Un Éthiopien, Choeur), sol mineur, 2 [quelques fragments de la
musique de Lully]
SCÈNE 6
- p. [90bis] : Duo. Les plus belles chaînes [Andromède, Persée],
si mineur, 3
- p. [91]-[93] Bruit. D'où naît ce bruit ? (Cephée), Ré Majeur, 2
SCÈNE 10
- p. [100]-[102] [Air] Cessons de redouter la fortune cruelle
(Persée), Ré Majeur, 3
- p. [103] : [Récit] Mortels, vivez en paix (Vénus), si mineur, 3
- p. [103]-[104] : [Air] Grâces, jeux et plaisirs (Vénus), Si
Majeur, 3/8
- p. [105]-[113] : Choeur. Gaiment. Chantons, célébrons le beau
jour (Vénus, Choeur), Si Majeur, [3/8]
- p. [114]-[116] : [Air instrumental]. Legerement, Si Majeur, 2
- p. [116] : [Récit] Hymen, de ce beau jour (Vénus), Si Majeur, 2
- p. [117]-[123] : [Air] L'aimable Hébé, le dieu des coeurs
(Vénus), Si Majeur, 2
- p. [125]-[130] : Passacaille. Du plus doux présage (Choeur), MI
Majeur, 3
- p. [131]-[132] : 1er Air léger, Mi Majeur, 2
- p. [133] : Ariette pour Persée [début uniquement]
- p. [134] : 2e Air léger, mi mineur, 2
- p. [135]-[154] : Ariette et Choeur. Vivement et fort. Sur
l'univers règne à jamais (Persée, Choeur), Mi Majeur, 2/4
- p. [155]-[160] : Chaconne, mi mineur, [3]
- p. [161]-[182] : Chaconne a 2 tems, Gaiment, Mi Majeur, 2
Donc pas mal de choses, et je suppose que François Rebel s'est chargé
de faire subir le même sort aux actes II et III. (Couper du
Quinault-
LULLY supposément dispensable pour
y fourguer des airs galants,
sérieusement
les gars ?)
Comme précisé en commentaires : en
réalité, l'acte III a échu à Bernard de Bury.
On peut quand même y vérifier que si les danses sont très largement
remplacées, un certain nombre de parties vocales d'origine sont
préservées.
… Pour le reste, j'attends d'entendre la chose sur place. Pour les
absents, un disque est prévu.
4. Après la représentation : état de la
partition
Quelques compléments à l'issue du concert du
Théâtre des Champs-Élysées.
¶
Les coupures opérées par Joliveau
accentuent le schématisme de l'action et des psychologies, dans un
livret qui était déjà extrêmement cursif chez Quinault – ce sont encore
Phinée (le rival) et Méduse qui ont le plus d'épaisseur, et le
raccourcissement (mêlé d'interventions de circonstance et de
galanteries pastorales ou virtuoses tout à fait stéréotypées pour 1770)
ne font qu'accentuer ces manques. Ce n'est pas de côté-là qu'il faut
chercher le grand frisson.

¶ Les
LULLYstes
ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec
colère, que le «
Persée
de Lully version 1770 »
ne contenait
finalement pas grand'chose de LULLY
: les récitatifs (certes, c'est le plus important),
quelques airs (arioso de Céphée, scène de Méduse) réorchestrés (plus de
cordes, et beaucoup de doublures de vents pour épaissir la pâte, cors
notamment), et telle ou telle portion (chœurs de l'acte IV-V, là encore
renforcés orchestralement par l'ajout de fusées de violon). Mais,
globalement, les parties instrumentales (même dans les accompagnements
des parties originales, hors récitatifs) sont toutes neuves, et
l'essentiel des airs et ensembles sont aussi remis au goût du jour. Il
y surnage certes un peu de
LULLY (l'acte III, qui contient
les
hits de Méduse et
Mercure, a été assez peu touché contrairement aux autres), mais l'opéra
sonne comme un opéra des années 1770 à 1800 (assez neuf pour 1770,
même).
Le parallèle le plus honnête serait sans doute avec le
Thésée de Gossec, qui en partage bien des
recettes musicales (dont le spectaculaire traitement des chœurs de
combat
hors scène).
On voit bien le problème de vendre un spectacle
« Persée
de Dauvergne-F.Rebel-Bury avec des bouts de Lully réorchestrés »,
surtout avec notre réflexe de valoriser la singularité de l'auteur,
mais mettre en avant le nom de
LULLY était
très trompeur, et avait d'autant plus de quoi désarçonner les
auditeurs qui n'y auraient pas prêté garde… qu'il s'agit d'une
esthétique d'
un siècle
postérieure !
¶
L'effectif est déjà celui du
Rameau tardif (
Boréades)
ou de la tragédie lyrique « réformée » d'après Gluck : adjonction de 2
clarinettes et de 2 cors à la nomenclature (2 traversos, 2 hautbois, 2
bassons). Le nombre de cordes sur scène est plutôt important (14
violons, 6 altos, 6 violoncelles, 2 contrebasses), mais c'était aussi,
en réalité, le type de nombres présents du temps de
LULLY
(voire supérieurs) – même si on le joue désormais avec des proportions
plus réduites (à ma grande satisfaction). Le contraste de ce point de
vue relève donc de l'illusion d'optique.
¶ Le
continuo est en train de
disparaître : le clavecin accompagne bien sûr les récitatifs de la main
de
LULLY (avec un violoncelle), mais ne double pas tout le
temps l'orchestre. Bien sûr, sa présence n'est jamais indiquée
explicitement sur les portées, mais c'est bel et bien l'époque où il
disparaît progressivement : il peut rester en fond (beaucoup
d'ensembles spécialistes adoptent désormais, à l'exemple de Jacobs, le
pianoforte à la place, pour raffermir le son d'orchestre), mais n'a
plus du tout la même fonction d'assise, considérant les carrures
beaucoup plus régulières (batteries de cordes fréquentes, c'est-à-dire
le même rythme égal répété en accords). De fait, il devient facultatif,
et chez Haydn ou Gossec, il n'est plus véritablement nécessaire – même
s'il peut encore figurer, plus ou moins à la fantaisie du compositeur
ou des interprètes, pour ce que j'en vois dans les disques (je n'ai pas
creusé les contours exacts de l'historicité de cette pratique).
¶ Musicalement, le contraste est plus frappant à l'intérieur des actes
(et pas seulement entre les parties originales et les parties récrites)
qu'entre eux : le style disparate qu'exposent
Dauvergne,
F. Rebel et
Bury est assez comparable d'un acte
à l'autre.
Les
danses, dont plus aucune
n'est de
LULLY, ont un
aspect
martial et tempêtueux assez
étonnant, qui ne laissent quasiment pas de part à la galanterie ; un
air de Persée et la grande tirade de Vénus tirent un peu plus sur la
pastorale pour l'un, l'air galant pour l'autre (malgré son propos
solennel, celui de célébrer les commanditaires !), mais globalement, on
se situe plutôt du côté des plus mâles portions du
Grétry de
Céphale et Procris ou du
Gossec du
Triomphe de la République. Elles font au demeurant partie
des plus réussies que j'aie entendues dans ce style – je crois bien que
j'aime davantage ça que les belles danses un peu plus décoratives de
LULLY
(magnifiques, ne me faites pas dire autre chose).
¶ Au chapitre des étrangetés réussies, les
parties autonomes et thématiques des
violoncelles en certaines occasions (jusqu'ici, le baroque les
réservait à l'assise de la ligne de basse, fût-elle vive et marquante)
; ou bien cet air vocalisant final chanté par Persée comme un héros
ramiste… mais accompagné d'un
tapis
choral qui évoque plutôt les airs de basse des deux Passions de
Bach…
¶ En fin de compte, l'aspect général ressemble à du
Gossec (oui, vraiment proche de
Thésée, mais avec des mélodies plus
inspirées et un sens du drame plus exacerbé), où persistent les beaux
frottements harmoniques de
Rameau
(le milieu du XVIIIe siècle étant plus audacieux harmoniquement, en
France, que la période qui a suivi). Un
très beau mélange, que j'ai trouvé
pour ma part tout à fait enthousiasmant : plutôt qu'à un
LULLY
du rang, on a droit à une partition de premier plan de la «
quatrième é
cole » de
tragédie en musique, qui
combine, de mon point de vue,
tous les avantages de la période :
drame exacerbé (façon
Danaïdes
de Salieri), danses très franches et roboratives (façon
Triomphe de la République de
Gossec), éclats tempêtueux saisissants (façon
Sémiramis
de Catel), harmonie ramiste (façon
Boréades,
un langage qui n'est plus de mise dès Gluck), des ariettes virtuoses
étourdissantes (là aussi, encore un peu ramistes, façon final de
Pygmalion), mais sans les longueurs
galantes (ni les fadeurs compassées dans les moments dramatiques) qui
font souvent pâlir les opéras de cette période face à
LULLY.
Évidemment, la prosodie n'est pas du même niveau, mais ce demeure un
opéra remarquablement réussi.
J'ai sans doute eu l'air un peu sérieux en décrivant ses écarts par
rapport à l'original, mais le résultat, même en révérant
LULLY,
était particulièrement réjouissant, peut-être davantage même que
l'original – car plus concis, moins prévisible aussi, considérant sa
nature hétéroclite.
5. Après
la représentation : quels moyens aujourd'hui pour jouer la tragédie en
musique ?
Bien sûr, avant toute chose, il faut souligner combien l'
offre, qui était à peu près nulle
(en quantité comme en qualité) il y a 30 ans, est aujourd'hui
généreuse, les nouveautés continuant
à pleuvoir (même si ses anciens défricheurs émérites comme Herreweghe,
Christie, Gardiner, Minkowski… sont partis enregistrer Brahms ou
rejouer à l'infini leurs propres standards – Niquet le fait
aussi, mais en supplément et non exclusivement).
Chose particulièrement significative, les
exhumations sont généralement
adossées à des financements discographiques
qui permettent de documenter le répertoire pour ceux qui n'habitent pas
à côté de la salle de concert.
En matière d'
interprétation
aussi, on a beaucoup exploré, et les continuistes capables de réaliser
des contrechants riches et adaptés à chaque caractère sont désormais
légion. Néanmoins, je remarque quelques réserves récurrentes, qui
étaient rares il y a 15 ans.
Bref, il y a tout lieu de se féliciter de la situation ; j'ai souvent
écrit ici que nous vivons
un âge d'or
pour le lied, jamais aussi bien chanté (et notamment sous l'influence
des recherches baroqueuses), de façon aussi précise et expressive (la
comparaison avec les grands diseurs d'autrefois est même assez cruelle,
tant leur rigidité éclate, quelle que soit la beauté de la voix ou la
science rhétorique). On pourrait presque être tenté de dire la même
chose pour le baroque… et pourtant, par rapport aux deux premières
vagues de découvertes dans le répertoire français (de la fin des années
80 au début des années 2000),
quelque
chose manque.
Mercredi soir, donc, nous disposions d'
un
des meilleurs ensembles spécialistes et
du meilleur du chant francophone pour
servir l'œuvre.
¶ Le
Concert Spirituel était
particulièrement en forme : son empreinte sonore caractéristique, plus
ronde que d'ordinaire chez les instruments d'époque, était aussi
caractérisée ce soir-là par une homogénéité que je n'avais pas toujours
noté en concert (de petits trous ou des inégalités ponctuelles dans le
spectre sonore) ;
le niveau semble
avoir (encore) monté, et en plus de conserver ses qualités, il
sonne avec autant d'assurance que dans ses meilleurs studios. La
direction d'
Hervé Niquet en
tire chaleur et engagement constants, c'est formidable, et de ce point
de vue, nul doute,
instrumentalement
ce répertoire n'a jamais été aussi bien servi qu'aujourd'hui.
¶
Mathias Vidal est le plus
grand chanteur francophone actuel chez les Messieurs (je suppose que
chez les dames, l'honneur reviendrait à Anne-Catherine Gillet), et le
confirme encore : le grain de la voix n'a pas la pureté des chanteurs
les plus célébrés, mais c'est pour permettre une franchise des mots et
une vérité prosodique extraordinaires (à l'inverse des voix parfaites
qui s'obtiennent par un reculement des sons et un nivellement des
voyelles), une éloquence, une urgence de tous les instants. Non
seulement le texte est toujours très exactement articulé, mais il est
aussi en permanence appuyé avec justesse, et pour couronner le tout
ardemment incarné – trois qualités très rarement réunies, et à peu près
jamais à ce degré, chez un même interprète. (Car il est possible
d'avoir les bons appuis avec un texte peu clair ou des apertures
fausses, ou en de disposer de tout cela sans en faire un usage
expressif particulier, comme les grands anciens des années 50…)
Son principal défaut était finalement que la voix sonnait un brin
étroite, limitée en volume. Ce n'est plus du tout le cas, et comme si
la bride avait lâché, Vidal tourne le potentiomètre à volonté lorsque
l'expression le requiert, dominant ses partenaires et l'orchestre.
J'attends
avec impatience son Parsifal dans la traduction française de Gunsbourg.

Le
contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus
spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il
que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes
francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens
hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…
Deux grandes catégories dans cette distribution :
¶ Ceux qui ont les atouts idéaux de leurs rôles mais ne sont
manifestement pas sollicités par le chef sur la question de la
déclamation.
–
Hélène Guilmette, favorise
davantage la netteté légère de son timbre que l'ampleur, la rondeur et
le moelleux (propre aux francophones américains) qu'elle peut
manifester autre part, et se coule parfaitement dans le rôle. Mais les
phrasés ne sont pas réellement déclamés, simplement joliment chantés,
alors qu'elle est une
grande mélodiste par ailleurs ; il n'aurait pas
fallu lui en demander beaucoup pour qu'elle fasse quelque chose de plus
éloquent d'Andromède !
–
Jean Teitgen (Céphée, le
père d'Andromède) a déjà fait frémir de terreur les amateurs du genre,
en
Zoroastre de
Pyrame
et surtout en
Amisodar de
Bellérophon
; pourquoi, dans ce cas, se contente-t-il ici de chanter (de sa voix de
basse d'une densité et d'une portée extraordinaires) tout
legato, en belles lignes égales,
quand il sait si bien mettre les mots en valeur dans d'autres
circonstances ? De vraies basses nobles françaises, il n'y a que
Testé (dont l'émission est parente) et, dans un autre genre, Varnier et
Courjal, qui soient de cette trempe, aussi bien vocale
qu'interprétative…
–
Tassis Christoyannis (Phinée,
le rival), dont on dit toujours le plus grand bien ici pour son
mordant, son intensité, sa voix impeccable et sa diction parfaite, que
ce soit dans Salieri, Grétry, David, Verdi ou Gounod, est certes moins
habitué au répertoire du XVIIe siècle (or il dispose essentiellement
ici de récitatifs de
LULLY), mais semble déchiffrer
(quelques détails pas très propres) et chante lui aussi de façon très
homogène et égale, sans exprimer grand'chose… Vraiment étonnant de sa
part, comme s'il avait été laissé à l'abandon dans un style (à peine)
différent.
–
Cyrille Dubois (Mercure) est
le seul à être égal à lui-même, avec son étrange voix, étroite et
grêle, mais d'un grain très particulier. Sa diction est fort bonne,
mais là aussi, assez inférieure à ses propres standards – son Laboureur
du
Roi Arthus crissait des
mots crus, tout à fait saisissant.
Eux semblent victimes d'un absence de soin porté à la diction (Christie
le faisait, Rousset le fait, les autres attendent un peu qu'on fasse le
travail pour eux), peut-être d'un nombre de répétitions réduit, d'une
étude pas assez précise de leur partie…
¶ Les autres sont limités par des caractéristiques plus inhérentes à
leur technique.
–
Chantal Santon-Jeffery, en
Vénus, rôle élargi par Joliveau, confirme une évolution préoccupante ;
je me rappelle avoir été très séduit lorsque je l'ai découverte (en
salle, me semble-t-il), dans du baroque français sacré, où la voix
était franche et la diction parfaitement acceptable (ce doit pourtant
faire à peine plus de 5 ans). Désormais, est-ce l'interprétation
occasionnelle de rôles plus larges (des parties écrasantes dans les
Cantates du Prix de Rome, ou même Armida de Hadyn, partie plus
vocal), ou, comme je le crains,
plutôt le moment de sa vie où la voix change, mais les stridences ont
augmenté, et surtout le centre de gravité de la voix a complètement
reculé, avec une émission (légèrement dure mais très équilibrée)
devenue flottante, quasiment hululante pour ce répertoire. En plus,
l'effort articulatoire paraît très (inutilement) important (peut-être
parce que la nature de la voix est un peu trop dramatique pour ce
répertoire) pour des rôles à l'ambitus aussi réduit et à la tessiture
aussi confortable.
Restent deux options : reprendre la technique en main, chercher la
netteté et l'antériorité plutôt que de sauver à tout prix le timbre au
détriment de tous les autres paramètres ; ou bien se tourner vers un
autre répertoire, sa voix évoluant clairement vers davantage de largeur
(mais j'ai bien conscience que lorsqu'on est chanteur, on ne choisit
pas, et vu qu'elle a ses réseaux déjà constitués, pas sûr que ce puisse
changer si facilement). En l'état en tout cas, impossible de sasisir un
mot de ce qu'elle dit, ce qui est un peu incompatible avec ce
répertoire.
–
Marie Lenormand (Cassiope),
égale à elle-même : comme Michèle Losier (qui est plus phonogénique),
son émission typiquement américaine (plus en arrière, beaucoup de
fondu) nuit à son impact physique et à sa déclamation (mais dans le peu
qui reste du rôle, elle demeure au-dessus de tout reproche, ce n'est
pas inintelligible non plus).
–
Katherine Watson (Mérope),
étrange choix pour une jalouse, même si la refonte de Joliveau gomme sa
participation néfaste, file un mauvais coton : la voix devient de plus
en plus minuscule et de moins en moins timbrée… il ne s'agit presque
plus de chant d'opéra, dans la mesure où le timbre est « soufflé » et
où la projection est quasiment celle de la voix parlée…
J'en ai
souvent dit du bien ici, parce que j'ai toujours cru que c'était – la
faute des programmes qui ne les mettaient jamais dans l'ordre, j'ai
vérifié – Rachel Redmond, que j'aime beaucoup en revanche (minuscule,
mais le timbre est net et focalisé) ; ce doit être la première fois que
j'entends l'une sans l'autre ! Même si je n'ai donc
jamais été très enthousiaste, je trouve que dans un rôle aussi modeste,
ne pas faire sortir la voix n'est pas un très bon signe – très facile à
dire de mon siège, mais ajouté à l'absence à peu près généralisée de
souci déclamatoire (chez elle aussi), cela finit par nuire
collectivement à l'œuvre et au genre.
– Enfin
Thomas Dolié (Sténone),
grand sujet de perplexité : je l'avais beaucoup aimé lors de ses
premiers grands engagements, au début des années 2000 (avant sa
consécration aux Victoires de la Musique, bizarrement sans grand effet
sur sa carrière, qui reste essentiellement confinée à des seconds rôles
réguliers), et en particulier dans le lied, où l'assise grave du timbre
et la sensibilité au texte produisait de très belles choses pour un
aussi jeune chanteur, et pas d'origine germanophone. Son Jupiter dans
Sémélé était très respectable également – même s'il s'agissait, comme
d'habitude dans ce répertoire, d'un baryton et non d'une réelle basse
comme on pourrait l'attendre ici.
Mais depuis un moment, la construction de la voix à partir du grave lui
joue des tours : depuis le second balcon, il était littéralement
inaudible dès que l'orchestre jouait, toute la voix restait collée dans
une émission extrêmement basse (dans le sens du placement, pas de la
justesse qui est irréprochable) ; depuis le parterre, et surtout
lorsque sa partie s'élargit dans la seconde partie, on entendait
beaucoup plus d'harmoniques (les harmoniques, justement, sont toutes
redirigées vers le bas de la salle, c'est très étrange, sans doute à
cause d'une impédance exagérée), et la conviction était perceptible –
l'engagement de
l'artiste finissait par donner vie au personnage et lever une partie
des
préventions. Néanmoins, qu'une articulation aussi lourde et opaque
produise aussi peu de son explique sans doute, d'un point de vue
pratique, la limitation de ses emplois : il n'est pas suffisament
adapté stylistiquement à ce répertoire pour tenir des premiers rôles,
et il n'aurait pas le volume suffisant pour tenir des rôles de baryton
dans des opéras du XIXe siècle. Encore une fois, la construction de
voix trop tôt couvertes, très en arrière, bâties à partir des graves et
non des aigus, provoque des résultats bouchés et difficiles à
manœuvrer. Ce peut donner l'illusion de l'ampleur dramatique au disque,
mais c'est toujours frustrant, en salle, par rapport à une voix
nasillarde qui sonnera infiniment plus ample (syndrome Mime, quasiment
tous sont plus sonores que les Siegfried de nos jours…).
À titre personnel, quitte à avoir de petits volumes, je choisis des
émissions libres et intelligibles, comme
Igor
Bouin (vraiment minuscule) ou
Ronan Debois (pas si mal projeté au demeurant !) ;
qu'on ait ce type de caractéristiques pour chanter les Russes ou
Wagner, soit, mais dans de la tragédie en musique, il ne paraît pas
logique que la voix paraisse aussi (inutilement) étrangère à l'émission
parlée.
Il n'y avait donc pas de mauvais chanteurs, mais ils semblent avoir été
peu (pas) préparés sur la question de la diction (voire, pour certains,
avoir peu lu leur partie), et un certain nombre dispose de
caractéristiques qui peuvent trouver leur juste expression ailleurs,
pas vraiment adaptées à ce répertoire.
J'ai de l'admiration pour
Marie
Kalinine : elle incarne exactement le type d'émission que je
n'aime pas (fondée d'abord sur un son très couvert et sombré, et pas
sur la différenciation des voyelles ou sur la juste résonance
efficace), et pourtant elle s'efforce, saison après saison, de se
fondre dans les styles avec le plus de probité possible – peu de
Santuzza peuvent se vanter de faire des
LULLYstes potables,
et inversement. Par ailleurs, son
carnet en
dessins, drôle et attachant, laisse percevoir une conscience très
franche de son art et une absence radicale de prétention, ce qui ne
fait que la rendre plus sympathique.
Je ne peux pas dire que sa Méduse m'ait séduit (déjà, quel dommage que
Bury l'ait confié à une femme, alors que la voix de taille ou
basse-taille campait immédiatement le caractère !), mais elle est avant
tout desservie par le diapason, ce qui me permet (merci Marie Kalinine
!) d'aborder une question que je me pose depuis longtemps et que j'ai
pas vraiment eu l'occasion de développer jusqu'ici.
On entendait essentiellement
Zachary
Wilder (Euryale)
dans les ensembles, difficile de mesurer l'étendue de ses talents :
issu du Jardin des Voix, j'ai été jusqu'ici très
impressionné par ses retransmissions, un beau ténor libre et lumineux
(et au français parfait)
comme l'école américaine en produit régulièrement depuis Aler et Kunde.
En salle, la rondeur du timbre n'était pas équivalente et la projection
limitée, mais on sentait bien que, dès que la partie s'élevait un peu
dans l'aigu, toutes ses aptitudes revenaient (d'où sa meilleure
adéquation dans les retransmissions de Rameau). Dans un Hérold, ça
aurait sans doute fait beaucoup plus d'étincelles, la tessiture basse
éteignant mécaniquement le timbre. Ce qui rejoint la même remarque que
pour Marie Kalinine, donc.
J'ai le sentiment désagréable d'avoir paru assez négatif alors que j'ai
finalement tout aimé (peut-être moins la grande tirade de Vénus, déjà
pas la plus grande trouvaille de Dauverge, par Chantal Santon, vu que
le texte était impossible à suivre et la voix pas adéquate non plus),
de l'œuvre aussi bien que du résultat interprétatif – avec la petite
frustration d'un manque de déclamation, mais avec des artistes de ce
niveau (et quelques-uns qui jouaient vraiment le jeu), ce n'est pas une
grande mortification non plus.
Je suppose que c'est le principe même d'entrer dans le détail qui met
en valeur les petites réserves : souligner tout ce qu'on a (de belles
voix qui chantent juste et avec implication) est tellement évident
qu'on entre dans d'autres. Et puis il y a mes marottes (probablement
plus fondées que pour Wagner) sur la mise en valeur du texte, que tous
les contemporains décrivaient comme primant sur la musique dans les
techniques de chant (les français ayant la réputation de hurleurs) ;
dans l'absolu, c'est bien chanté tout de même. [Disons qu'à volume
sonore tout aussi modeste, on pouvait avoir des couleurs vocales plus
libres et séduisantes, un texte énoncé avec plus de naturel.]
Illustration : Mathias Vidal, grand-prêtre de la diction dans un
petit couvent, tiré d'un cliché
de Jef Rabillon.
6. État
des lieux du chant baroque français
Pour le chant baroque dans l'opéra
seria,
un point a déjà été partiellement réalisé
là.
Cette soirée donne l'occasion de mentionner quelques évolutions.
Le niveau des orchestres (et en
particulier des orchestres baroques, de pair aussi avec la
spécialisation des facteurs, je suppose)
a considérablement augmenté au fil du XXe
siècle, et il est assez difficilement contestable que dans tous
les répertoires, on entend aujourd'hui couramment des interprétations
immaculées de ce qui était autrefois joué un peu plus
à peu près, que ce soit en
cohésion des pupitres, en précision des attaques, en célérité, en
justesse.
La voix n'a pas les mêmes
caractéristiques mécaniques et c'est sans doute pourquoi elle
est
beaucoup plus tributaire
de l'air du temps, des professeurs disponibles, de la langue d'origine
des chanteurs.
Au début de l'ère du renouveau
baroque français, de la moitié des années 80 à celle des années 90, le
vivier était constitué essentiellement de spécialistes, formés pour
cette spécialité par Rachel Yakar (pour la partie technique) et William
Christie (de façon plus pratique), de pair avec une galaxie de
professeurs qui officiaient pour ceux qui n'étaient pas au CNSMDP (ou à
l'Opéra-Studio de Versailles), voire de « rabatteurs » (Jacqueline
Bonnardot, quoique pas du tout spécialiste, envoyait certains talents à
Christie, m'a-t-il semblé lire).
Autrement dit,
les gosiers qui chantaient cette musique
étaient spécifiquement formés à cet effet (d'où la mauvaise
réputation de « petites voix » qui a persisté assez couramment au moins
jusqu'au début des années 2000), en privilégiant la clarté du timbre,
le naturel de l'articulation verbale, l'aisance dans la partie basse de
la tessiture, la souplesse des ornements, au détriment d'autres
paramètres prioritaires dans l'opéra du « grand répertoire », à
commencer par la puissance et les aigus. (Un certain nombre de ces voix
très légères et claires peuvent rencontrer des difficultés dans les
aigus, qu'elles ont pourtant, mais que leur technique d'émission,
centrée sur une zone plus proche de la voix parlée, ne favorise pas.)
La
reconversion n'était pas chose facile
: Jean-Paul Fouchécourt s'est limité à quelques rôles de caractère,
Paul Agnew n'a guère excédé Mozart et Britten (il aurait pu,
d'ailleurs), Agnès Mellon a fait une belle carrière de mélodiste après
sa grande période lyrique, et l'on voit mal Monique Zanetti ou Sophie
Daneman chanter un répertoire plus large. Ceux qui se sont adaptés
l'ont fait soit assez tôt, au fil du développement de leur voix (Gens,
Petibon, et aujourd'hui Yoncheva, dont la formation initiale n'était de
toute façon pas baroque), soit au prix de changements assez radicaux,
comme Gilles Ragon, qui a assez radicalement changé sa technique pour
pouvoir chanter les grands ténors romantiques (avec un bonheur
débattable).
On disposait alors de
réels spécialistes, pas forcément
exportables vers d'autres répertoires (ne disposant pas nécessairement
de la même qualité d'agilité que pour l'opéra
seria italien), en dehors de Mozart
éventuellement ; mais ils étaient rompus à toutes les caractéristiques
de goût (agréments essentiellement, c'est-à-dire notes de goût ; les
ornements plus amples, de type variations, n'étaient alors guère
pratiqués par les pionniers) et de phonation spécifiques à ce
répertoire.
Christie était assisté, jusqu'à
une date récente, d'une
spécialiste
de la déclamation française du Grand Siècle, qui participait à
la formation permanente des chanteurs récurremment invités par les Arts
Florissants. L'insistance sur l'
articulation
du vers, sur la
mise en valeur
de ses appuis et de ses consonances (ce qu'on pourrait appeler
la « profondeur » de son pour les syllabes importantes) était une
partie incontournable de son travail de chef, l'une des nouveautés et
des forces de sa pratique, dont tout les autres ensembles ont tiré
profit – une fois émancipés (ou lassés / fâchés), les anciens disciples
allaient travailler chez les ensembles concurrents tandis que Christie
formait de nouvelles générations, équilibre qui a pendant deux
décennies élargi le spectre des productions où la qualité du français,
que le chef y prête attention ou pas, était particulièrement
exceptionnelle.
Mais Christie était seul à produire cet effort de formation –
depuis, le CMBV fait de belles choses avec ses chantres, mais plutôt
orienté vers la formation de solistes ou de
comprimari que de grands solistes,
considérant les voix assez blanches qui en sortent souvent (mais ce
n'est pas une généralité, témoin l'immense Dagmar Šašková, sans doute
actuellement la meilleure chanteuse pour le baroque français).
Et cet effort, pour des raisons que
j'ignore,
s'est interrompu :
il a cessé, apparemment, de faire travailler spécifiquement la
déclamation, et, lui qui était célèbre pour son tropisme vers les voix
étroites et aigrelettes, s'est mis à recruter des voix moelleuses
articulées plus en arrière, selon la mode d'aujourd'hui – qu'il
chouchoute Reinoud van Mechelen était une perspective inconcevable il y
a quinze ans ! [Mode qui a son sens au disque mais est, à mon
avis, assez absurde du point de vue des résultats en salle – les voix
sont moins intelligibles et ont très peu d'impact sonore, qu'elles
soient grandes ou petites.]
Emmanuelle de Negri, elle-même
une voix beaucoup plus ronde que les anciennes amours de Christie, est
à peu près la seule de sa génération à avoir repris le flambeau du
verbe haut. Elle chante d'ailleurs fort peu d'autres répertoires, et sa
Mélisande (tout petit rôle de l'
Ariane
de Dukas) paraissait un peu désemparée par rapport à un univers
technique tout à fait différent du sien – précisément parce que toutes
ses forces sont tournées vers l'excellence spécifique du répertoire
baroque français.
Aujourd'hui, par conséquent, plus
personne n'informe et ne gourmande, au besoin, les chanteurs sur ce
point. On trouve donc (comme dans ce
Persée)
les voix les plus adaptées à ce répertoire laissées sans direction, ce
qui donne à voir de rageant gâchis : non pas que ce soit mauvais, mais
ces chanteurs ont tous les moyens et
savent
faire, à condition d'être entraînés et incités à appliquer ces
préceptes.
À cela s'ajoute le fait que, victime de
son succès, l'opéra baroque français accueille volontiers des chanteurs
de formation traditionnelle. Certains en font leur seconde maison au
hasard des réseaux de leurs années d'insertion professionnelle (Thomas
Dolié par exemple, qui a étudié au CNIPAL, plutôt un réservoir de voix
pour les grands rôles lyriques… et avec Yvonne Minton) et ont donc
l'opportunité d'en acquérir les codes, d'autres le font
occasionnellement pour ajouter d'autres répertoires conformes à leur
voix (porte d'entrée en Europe pour Michèle Losier), d'autres enfin
viennent comme invités-vedettes pour fournir un type de voix rare ou un
prestige particulier à une production (Nicolas Testé en Roland, dont on
sent les origines extra-baroques, mais qui se plie remarquablement à
l'exercice).
Le problème est que, dans bien
des cas, la technique de départ n'est pas vraiment compatible avec le
baroque : les voix très couvertes, où les voyelles sont très altérées,
n'ont pas grand rapport avec le chant réclamé par ces partitions.
Stéphane Degout et Florian Sempey s'en tirent très bien (alors que je
ne les aime guère ailleurs), mais on peut s'interroger sur la logique
d'employer des voix aussi extérieures au cahier des charges de la
tragédie en musique.
J'ai déjà longuement ratiociné sur ces questions dans de précédentes
notules, ce qui me mène à quelques interrogations
nouvelles
supplémentaires.
7.
Quelques questions à se poser
D'abord, il ne faut pas désespérer : certains chanteurs qui
n'ont pas suivi cette voie manifestent les qualités requises, à
commencer par
Mathias Vidal
(CNSM de Paris) ! Par ailleurs,
Christophe Rousset, en plus
d'être un peu seul à se consacrer aussi méthodiquement à explorer le
répertoire enseveli de la tragédie en musique, demande cet effort de
mise en valeur des mots à ses chanteurs – il est un peu celui qui a
imposé, par exemple, l'accent expressif ascendant sur les « ah ! »,
d'abord largement moqué et qui est devenu une norme par la suite chez
les autres ensembles (en cours de disparition, puisque plus personne ne
semble s'intéresser au texte des œuvres jouées). Son insistance, dans
les séances de travail, sur l'expressivité, jusqu'à la demande de
l'outrance, est centrale, et se ressent à l'écoute – alors même que sa
direction musicale pouvait être, il y a dix ans, assez molle. Il suffit
d'observer les mêmes chanteurs chez lui et chez les autres : avec lui,
ils phrasent ; ailleurs, certains semblent moins s'occuper des mots.
En revanche, voilà un moment que je n'ai pas entendu Niquet, malgré
toutes ses qualités de clairvoyance dans le choix des œuvres et de
générosité dans leur mise en œuvre, donner des productions où le phrasé
est mis en valeur…

D'où
me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :
¶ Alors qu'on s'échine à utiliser
des
instruments originaux, à les préserver ou à les reconstruire, qu'on va
jusqu'à reprendre les diapasons exacts des différents lieux où l'on
créa les œuvres, n'est-il pas
étrange
d'embaucher des chanteurs dont la technique est fondée sur les
nécessités vocales de l'opéra italien du XIXe siècle ?
Comment est-il possible, pour ces gens qui s'interrogent sur le style
exact d'un continuo de 1710 vs. 1720, sur le nombre de battements d'un
tremblement pratiqué dans telle chapelle, de ne pas voir la terrible
transgression d'engager des mezzos-sopranos verdiens et des barytons
wagnériens pour chanter des œuvres où les interprètes utilisaient une
technique tellement naturelle qu'on les décrivait comme criant ?
J'ai bien conscience qu'on ne
peut pas gagner sa vie en chantant simplement dans les quelques
productions de baroque français (essentiellement concentrées à Paris,
Bruxelles et Versailles d'ailleurs, plus un peu à Toronto et Boston…),
et que construire une voix exclusivement calibrée pour le lied (sans en
avoir forcément la diction allemande) serait un suicide professionnel…
Mais tout de même, n'y a-t-il pas une réflexion à avoir là-dessus ?
¶ Car
les
tessitures du baroque, et spécifiquement celles du baroque
français,
sont très basses.
Les rôles de
dessus chez
LULLY
culminent au sol, ce qui, joué au diapason d'origine (392 Hz), équivaut
à peu près à un fa, soit trois tons plus bas que les mezzos-sopranos
verdiens, voire plus bas que les grands rôles de contralto ! Or,
on ne peut pas faire jouer la jeune première Andromède pépiant sur son
rocher par l'équivalent de Maureen Forrester, n'est-ce pas. Et
inversement, faire chanter une soprane aussi bas va l'empêcher de
projeter ses sons, voire « éteindre » sa voix.
C'est pourquoi la catégorisation
en soprano / mezzo n'a pas grande pertinence dans ce répertoire, et
qu'il s'agit avant tout d'une question de couleur – à l'opéra,
dessus et
bas-dessus ont d'ailleurs
strictement la même tessiture avant Rameau ! Couleur qui ne peut
jamais, considérant l'effectif raisonnable, l'accompagnement discret,
l'aération des timbres des instruments naturels (pas de mur de fondu
comme avec les instruments modernes) et la nécessité d'intelligibilité,
être trop sombre, ni le grain trop épais.
La
couverture vocale (c'est-à-dire la modification des voyelles
pour pouvoir émettre des aigus qui ne soient pas serrés et poussés)
n'a de ce fait
pas grand sens dans ce répertoire,
en tout cas chez les femmes (chez les hommes, on peut
couvrir en mixant chez les ténors,
et certains aigus des basses demandent sans doute un peu de rondeur et
de protection, procurées par la couverture vocale), pas à l'échelle
massive où le chant lyrique l'utilise d'ordinaire (souvent trop ou mal,
même pour du Verdi).
Alors, si l'on ne peut pas changer du
tout au tout l'enseignement du chant (la tradition adéquate
existe-t-elle seulement encore ? peut-on la
retrouver
aussi aisément que pour un instrument ?), ne serait-il pas judicieux,
quitte à ne pas être
authentique,
de
remonter le diapason d'un ou deux
tons, pour permettre aux techniques d'opéra telles qu'elles sont
de retrouver leur centre de gravité et leur brillant – étant calibrées
pour s'élever avec confort loin de la zone de la parole…
Illustration : costume de Louis-René Boquet pour les
représentations de 1770, une Éthiopienne (parfaitement).
Je livre cet état des lieux à votre sagacité, n'ayant pas de réponse
sur la marche à suivre – et tout de même assez émerveillé d'entendre
ces œuvres et ces ensembles spécialistes qu'on n'aurait jamais rêvé
d'entendre, et certainement pas aussi bien, il y a seulement trente ans
!


















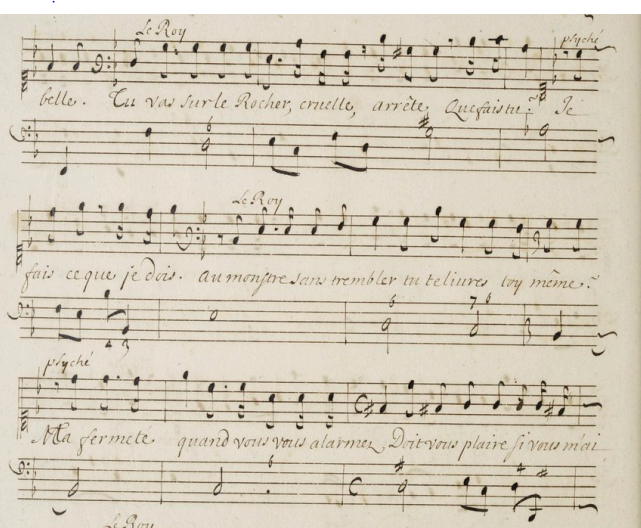



































 Il
m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,
cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu
mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de
l'opéra de Beaumarchais.
Il
m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,
cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu
mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de
l'opéra de Beaumarchais. 


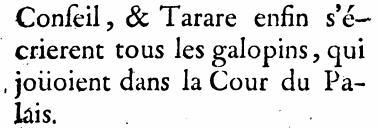



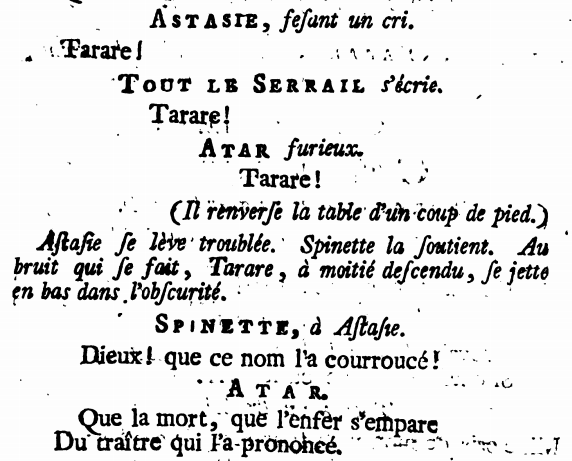









 ¶ Les LULLYstes
ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec
¶ Les LULLYstes
ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec  Le
contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus
spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il
que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes
francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens
hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…
Le
contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus
spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il
que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes
francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens
hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…  D'où
me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :
D'où
me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :