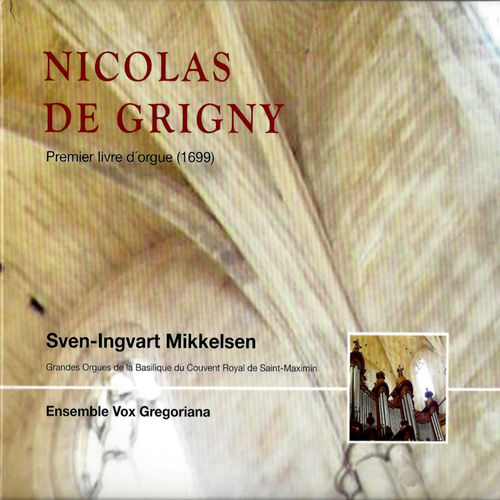lundi 18 octobre 2021
Une décennie, un disque – 1840 (b) : Jacopo FORONI, l'opéra italien d'influence allemande en Suède

Fin de l'acte I, avec ses mélodies proches de La Traviata, ses trémolos dramatiques qui évoquent Il Trovatore…
(Christine maudit les amants cachés et leur promet de les tenir séparés à jamais.)
Les chefs-d'œuvre des années 1840
Mon premier choix pour illustrer la période des anées 1840 se serait évidemment tourné Les Diamants de la Couronne d'Auber, le meilleur opéra de son auteur (qui n'en a pas commis beaucoup d'indispensables) et (de loin) le meilleur opéra comique du XIXe siècle, feu d'artifice de récitatifs intelligents, d'ensembles aux dispositifs originaux, d'une intrigue atypique et jubilatoire, qui existe de surcroît au disque dans une distribution étourdissante (Raphanel, Einhorn, Arapian !) et en vidéo (régulièrement vidéodiffusée la nuit par TF1, mais non commercialisée) dans une mise en scène de Pierre Jourdan, tradi mais pleine d'esprit. Brigands, grottes secrètes, faux moines, fonderies d'or, joyaux impériaux volés, ministre de Police roulé, impostures multiples et bons sentiments se mêlent dans une cavalcade musicale inspirée de bout en bout, en particulier pour son premier acte, une des plus belles choses jamais produites par un esprit français.
Mais… le disque Mandala de la fin des anées 90 est indisponible depuis le début des années 2000, et le label, sans doute disparu, ne publie rien en ligne et en dématérialisé ou flux… je crains que ce ne soit vraiment difficile à trouver pour ceux qui n'habitent pas à proximité d'une médiathèque bien achalandée. Aussi, le propos de la série étant de proposer une découverte du répertoire par le disque, je ne souhaite pas transformer l'exercice en chasse au trésor. Si toutefois vous voyez le disque passer (ou mieux encore, la vidéo rediffusée), jetez-vous dessus ! Que vous aimiez ou pas le genre de l'opéra comique alla Scribe (car c'est bien sûr lui, le maître-d'œuvre de ces folies), vous ne trouverez pas mieux.
Le second choix logique se serait tourné vers les lieder de Clara Wieck-Schumann, qui recèlent quelques bijoux absolus du genre. Mais j'en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises (il y a même une catégorie dédiée dans la colonne de droite, et j'apprête à redonner quelques éléments biographiques sur sa vie !), et elle commence à être bien documentée par le disque et les concerts (son Concerto pour piano, pourtant plutôt une jolie chose qu'un chef-d'œuvre sans égal, est donné deux fois cette saison à Paris !), à devenir emblématique du retour en grâce des compositrices, comme Louise Farrenc – étrangement (faute de fonds unifié et lisible ?), Alma Schindler-Mahler ne semble pas bénéficier de cet engouement, contrairement à Luise-Adolpha Le Beau, Henriëtte Bosmans, Charlotte Sohy ou Ethel Smyth, à juste titre en cours d'exploration et réhabilitation.
Par ailleurs, à part la poignée gravée sur le fameux disque de Cristina Högman & Roland Pöntinen (avec d'autres lieder de Mesdames Mendelssohn-Hensel et Schindler-Mahler), je n'ai pas nécessairement de disque incontestable à proposer, même s'il existe plusieurs très belles propositions : Loges formidable (Gritton-Loges-Asti chez Hyperion), et sinon de très valeureuses propositions (Craxton-Djeddikar chez Naxos, Fontana-Eickhorst chez CPO).
Foroni s'est donc imposé, parce que moins connu des lecteurs de CSS, et parce qu'il apporte aussi une lumière intéressante sur l'histoire de la musique telle que nous la percevons. J'y reviens dans la présentation.
Le splendide air de baryton (Frederik Zetterström, ici) du début de l'acte II.
(Carl Gustav arrive dans l'île de la Baie de Saltsjön par une nuit illuminée par la lune.
Il sera bientôt informé – et horrifié – du complot contre Christine.)
Un peu de contexte – a – Foroni avant Cristina
Jacopo Foroni avait tout pour réussir une grande carrière musicale : fils d'un compositeur et chef d'orchestre, né pré de Vérone et étudiant à Milan, il s'y produit comme chef et pianiste dès 1846 et reçoit commande d'un opéra créé en 1848 à la Scala, créé alors qu'il n'a que 23 ans – Margherita. Il ne s'agit pas encore d'un grand opéra sérieux mais d'un melodramma semiserio – dans le goût du Déserteur de Monsigny et de L'Elisir d'amore de Donizetti (les lazzi en moins) : Margherita aime un soldat, accusé à tort d'avoir attaqué le Comte (Rodolfo, comme tous les comtes…) et jeté en prison par son colonel. Celui-ci extorque le consentement au mariage de Margherita en échange de la libération de l'amant, mais le Comte reconnaît dans la personne du colonel son agresseur, et tout est bien qui finit bien.
Les dons du jeune homme sont admirés, mais dix jours plus tard, ce sont les Cinq Journées de Milan (aboutissement d'une effervescence anti-autrichienne des élites nord-italiennes), insurrection (inspirée par celle de février 1848 en France) à laquelle participe activement le jeune homme. Pour échapper à la répression, il part en tournée en tant que chef d'orchestre.
Pendant ce temps, à Stockholm, la troupe de l'impresario Vincenzo Galli rencontre des difficultés : son partenariat avec l'Opéra Royal a été rompu – les accès de colère du baryton Gian Carlo Casanova (le futur librettiste de Cristina !) et le mépris ostensible pour le répertoire italien (et les Italiens eux-mêmes) de la part du chef local, Johan Fredrik Berwald (cousin du Franz resté célèbre), a conduit le groupe à retourner dans un théâtre secondaire de la capitale. Comble de malheur, le chef d'orchestre de la compagnie part.
C'est ainsi que Jacopo Foroni, en quête d'engagements, se retrouve en décembre 1848 chef permanent de ce petit équipage de chanteurs italiens en terre suédoise. Il dirige avec grand succès Rossini (Il Barbiere di Siviglia), Donizetti (Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia, Lida di Chamonix, Parisina d'Este…), Bellini (Beatrice di Tenda), Verdi (I Lombardi alla prima crociata).
Et dès mai 1849, il se présente au public local comme compositeur, en donnant cette Cristina qui nous occupe aujourd'hui. Il est piquant d'observer que pour cette carte de visite, il adopte un livret en miroir de sa propre situation : Christine de Suède abdique et quitte son pays devenu hostile pour l'Italie, tandis que Foroni abandonne l'Italie où il risque la condamnation pour des délits politiques – et se réfugie en Suède.
Un peu de contexte – b – Foroni en Suède
Jusqu'à sa mort prématurée du choléra, la vie artistique de Foroni est essentiellement constituée de succès : il écrit des musiques de scène, une « tragedia lirica » I Gladiatori (à l'origine un Spartaco, sujet un peu audacieux écrit pour Milan et censuré comme tel par les autorités autrichiennes), et une opérette comique suédoise Advokaten Pathelin (d'après La Farce de Maître Pathelin) ; il reçoit d'une manière générale un accueil très favorable du public, comme chef et comme compositeur.
Il faut dire qu'il a très vite maîtrisé le suédois, ayant une aisance pour les langues, ce qui a sans doute grandement favorisé son intégration à la communauté musicale locale – en plus de son image d'enfant prodige de la grande nation musicale d'alors. Son caractère était réputé avenant, sa personne plutôt charismatique, son travail orchestral exigeant (notamment vis-à-vis du travail personnel des musiciens en amont des représentations).
Imprécations de Christine contre son favori lorsque le complot visant à la renverser est dévoilé.
(L'acidité assez nilssonienne de Liine Carlsson est particulièrement audible dans ce passage !)
Compositeur : Jacopo FORONI (1825-1858)
Œuvres : Cristina, regina di Svezia (« Christine, reine de Suède ») (1849)
Commentaire 1 :
♣ Cet opéra a le mérite de documenter l'écriture d'opéra italienne hors du belcanto à airs fermés (qui restait toujours implanté dans ces années) : en effet la plupart de ce que montre la discographie hors Rossini-Donizetti-Bellini-Verdi est écrit dans une perspective plutôt belcantiste et purement vocale que dramatique, façon Verdi. Si l'on se fie à ce qui est publié, Verdi est le seul à utiliser certains procédés, et surtout une gestion du temps dramatique aussi urgente et resserrée, où de longues scènes récitatives ont une réelle substance musicale et servent de pivot à l'action, voire de sommet à l'œuvre, plutôt que les seuls moments d'épanouissement vocal.
♣ Le livret, très dense en action, est centré, comme vous l'auriez deviné sans me lire, à la fois sur l'abdication (forcément) de Christine de Suède, et sur (évidemment) ses amours – ici son favori Magnus Gabriel de la Gardie, qui aime en secret la cousine de Christine. Le poème compacte, pour des raisons dramaturgiques évidentes, des événements qui se déroulent sur une dizaine d'années, et pas nécessairement dans cet ordre – la Reine accepte le mariage de son favori des années avant que l'abdication ne se profile.
♣ Foroni, d'une douzaine d'années le cadet de Verdi, donne à entendre un langage qui se rapproche bien plus de cette esthétique nouvelle que du belcanto traditionnel : on y retrouve les trémolos et trépidations, les ensembles bousculés, les duos d'affrontement asymétriques (où les personnages ne font pas seulement leur stance à tour de rôle puis leur joli duo homorythmique), et surtout les grandes « scènes » récitatives où la musique et le drame sont bien plus libres… Dès son premier opéra, au demeurant, on discute de ses influences, celle de la tradition italienne transmise par son père Domenico, et celle issue de l'étude des maîtres allemands (son maître, Alberto Mazzucato, lui a enseigné Bach et Beethoven). Clairement, il ne se situe plus dans la seule tradition italienne belcantiste, conçue pour la glorification des voix, qui s'étend du seria-à-castrats du début du XVIIIe jusqu'à ce milieu du XIXe. Peu de choses spectaculaires du point de vue du chant dans Cristina, on sent que l'énergie de la composition est tout entière tournée vers la crédibilité des psychologies et le rythme du drame.
♣ Foroni peut donc simultanément être considéré comme le symptôme du prestige de l'Italie à travers l'Europe, dont la norme, au moins en matière d'opéra, irradiait ensuite toutes les autres écoles nationales… et réciproquement comme le signe d'une perméabilité de l'enseignement italien aux nouveautés introduites par les écoles allemandes.
♣ Surtout, j'y perçois une belle veine mélodique (d'un style évoquant le Verdi de Nabucco, du Trouvère…), un livret trépidant, un véritable sens du rythme dramatique, des ensembles réellement mobiles et inspirés : cet objet opéra mérite pleinement l'écoute, indépendamment de sa place à la croisée des histoires du genre.
Interprètes : Liine Carlsson, Daniel Johansson, Frederik Zetterström, Kosma Ranuer, Ann-Kristin Jones, Anton Ljungqvist – Opéra de Göteborg, Tobias RINGBORG
Label : Sterling (2010)
Commentaire 2 :
♣ De belles voix dans l'ensemble : en particulier le baryton clair et noble Frederik Zetterström en Carl Gustav, successeur de Christine, et le ténor Daniel Johansson en Gabriel, amant de la reine. Liine Carlsson, dans le rôle-titre, a la particularité de conserver une petite acidité des attaques et du timbre qui évoquent assez Nilsson ou Caballé – bien sûr le reste de l'émission, plus ronde et pas du tout aussi large, n'est pas du tout pensé sur le même patron.
♣ Mais le véritable prix de cet enregistrement – outre que c'est le seul, et qu'il est bon de surcroît – réside dans la présence de l'Orchestre de l'Opéra de Göteborg, qui apporte une finesse de trait et une précision d'exécution (avec des timbres très nets), telles qu'on n'en entend pas très souvent dans les exécutions d'opéra italien en Italie, en France et quelquefois en Allemagne. Très belle réussite de ce point de vue, à laquelle s'ajoute une prise de son agréable, avec de l'espace et un peu de réverbération, mais qui laisse entendre très nettement les détails – les voix sot un peu en avant de l'orchestre, mais sans le couvrir et pas trop proches de nos oreilles.
… Nous arriverons donc, pour la prochaine livraison, en 1850. J'ai bon espoir de parvenir à traiter la décennie 2020 (tout les disques sont déjà sélectionnés !) avant que la dernière dose de rappel de vaccin ne parcoure la dernière veine d'Afrique centrale.
Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Une décennie, un disque a suscité :
silenzio :: sans ricochet :: 2527 indiscrets