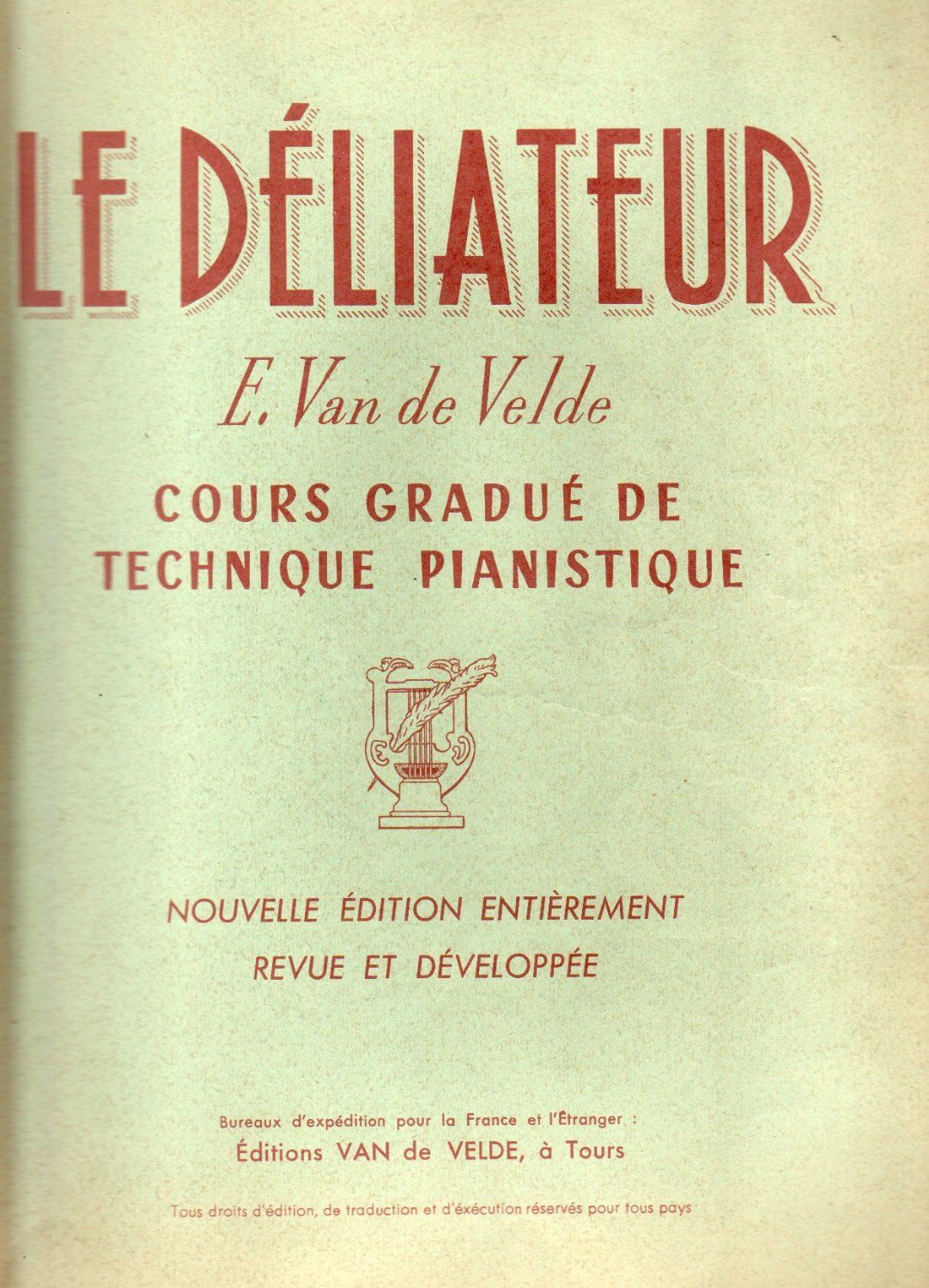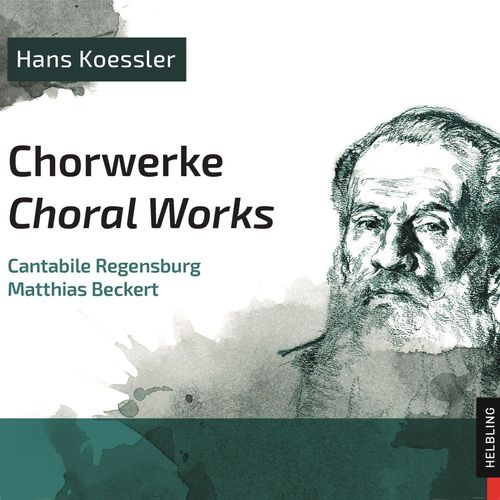dimanche 1 juin 2025
Présenter un concert

Ce dimanche, je me lance dans une nouvelle expérience : j'avais testé le concert (amateur), et même le concert simultanément commenté, mais c'est la première fois que je participe à un concert professionnel – en tant que commentateur, on ne m'a heureusement pas invité à jouer quoi que ce soit !
C'est de surcroît pour un festival où j'aime venir en tant que spectateur : le festival itinérant du Provinois, Inventio, toujours riche en propositions originales et en lieux patrimoniaux remarquables – vous en trouverez quelques recensions enthousiastes dans ces pages.
Le projet de cette notule : raconter l'envers du décor et aussi, pour ceux qui ne viendront pas, fournir une partie du contenu de cette communication.
Comment ça se passe
Un Festival itinérant représente immanquablement un énorme enjeu logistique, qu'on ne mesure pas toujours en tant que spectateur : il faut bien sûr déménager la scène, l'éclairage, le système d'amplification et de captation, sans même parler du piano, une aventure en soi – qui n'a pas vu les machines MARVELesques faire descendre un piano d'un autel (et son prix...) ne connaît pas le frisson authentique de la production d'un concert.
Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas : la simultanéité d'une création d'opéra de chambre avec un festival de rock distant d'un pâté de maison, par exemple. L'implication différente des collectivités. Les exigences distinctives de chaque lieu d'accueil. Et bien sûr, pour ne rien dire de la contrainte du financement et, au bout de compte, de faire venir un public qui n'a pas ses habitudes dans une salle unique, son petit abonnement, sa place de parking préférée, etc.
Je l'ai aussi vécu dans ce projet, qui a connu plusieurs mutations.
Je rappelle d'abord le programme musical du concert :
¶ Debussy, Prélude à l'Après-midi d'un Faune (transcription pour trio piano-cordes) ;
¶ Ravel, Sonate pour violon & violoncelle ;
¶ Debussy, Syrinx (transcription pour violon) ;
¶ Schönberg, La Nuit transfigurée (transcription pour trio piano-cordes).
Le Festival Inventio, pour sa dixième édition, tourne autour d'une double thématique dont, pour celle qui me concerne, « À portée de mots ». Et à chaque fois, le festival propose un nouveau dispositif, une activité gratuite ouverte à tous qui précède le concert (film documentaire, rencontre, taï-chi, randonnée, visite guidée du lieu ou des environs, etc.). Dans cette perspective, l'un des concerts de cette série autour de la parole devait être construit autour de la question de la critique musicale. Et c'est dans ce contexte que je fus contacté.
1) En janvier, il était question de créer une sorte de portail initiatique : en ouverture de concert, présenter la réception critique du Faune, et en clôture, parler de l'évolution de la perception de Schönberg par lui-même et par les autres, autour de la Nuit Transfigurée, une fois l'écoute candide du public achevée.
2) Finalement, fin avril, l'ordre des pièces m'a convaincu de procéder plutôt à une très courte introduction (plutôt sous forme de sketches mi-informatifs, mi-divertissants) de chaque pièce : je ne me voyais pas venir pérorer après l'émotion de la fin de concert (et les trente minutes de Nuit Transfigurée !), comme pour voler la vedette aux artistes. Toujours dans la perspective de présenter le rapport entre ces œuvres et la critique, notamment la divergence de perception, l'évolution au fil du temps. Et aussi, sans doute, de mentionner la démarche de transcription, trois œuvres sur les quatre, tout de même, et pas de la petite adaptation, de véritables mutations d'effectif !
3) Puis, une semaine avant le concert, après les essais acoustiques (le boulot logistique a été très minutieux, les équipes du Festival ont pré-testé chaque lieu), changement de pied : acoustique trop réverbérée pour envisager une communication un peu longue, que ce soit avec ou sans amplification. Ce sera donc une rencontre avec le public avant le concert.
Ce format est assez différent des précédents : je suis bien moins contraint sur la brièveté, je pourrai développer des idées entières, mais il faut que ce soit bien structuré pour rester clair – il n'est pas prévu d'interlocuteurs pour la relance –, à la fois assez nourrissant pour justifier le projet d'une dimension augmentée du concert, mais surtout pas long, épais, verbeux. C'est donc à la fois plus confortable pour l'orateur, et moins plaisant pour le public.
Le défi est d'autant plus exigeant qu'il y aura dans le public des mélomanes aguerris venus de toute l'Île-de-France (et même d'Eure-et-Loir), mais aussi, majoritairement, un public qui ne va au concert que lorsque Inventio vient dans les villages attenants. Il faut donc à la fois donner de l'inédit aux connaisseurs et avancer assez doucement sur les notions pour ne perdre personne. C'est finalement encore plus sur la forme que sur la matière que le succès de l'entreprise se joue. (Évidemment, pour pouvoir s'occuper de forme, il faut de la matière, glanée en passant deux après-midis par semaine à la BNF pendant tout le mois de mai.)
Ce que je dirai
Comme cela peut intéresser les lecteurs de CSS, il est bien sûr encore temps de venir (un peu tard pour réserver la navette, mais vous pouvez toujours essayer).
→ https://www.inventio-music.com/festival-de-musique-10ème-édition/programmation-a-portee-de-mots/
Et, pour tous les autres, je touche un mot ici de ce que je dirai – si beaucoup de choses se passent et changent, je le narrerai peut-être ensuite ici.
RENCONTRE : « À quoi sert la critique musicale ? »
(c'était le titre d'origine, à partir duquel j'ai élaboré)
1) Les œuvres de ce concert ont eu une réception critique contrastée.
Rapide définition de ce qu'est la critique : perception d'une œuvre, dans la presse notamment. Le critique était celui qui l'exerce régulièrement.
2) Que fais-je là ?
Je ne perçois pas vraiment comme critique, mais c'est un titre qui m'est souvent accolé – et ne me flatte pas vraiment, si vous voulez tout savoir. [Je me perçois comme un mélomane bavard.] Je poserai simplement quelques éléments de mon activité : vulgarisation, exploration, programmes de salle, magazines musicaux, notices de disque, et bien sûr spectateur et lecteur (du moins naguère) de la presse musicale – tout ça en une seule phrase, juste pour situer pourquoi ce sont mes fesses qui sont sur cette chaise, sinon le public ne comprendrait pas trop mon rôle. L'idée est que je vois de près ce qu'est une critique / un critique.
3) À quoi sert la critique ?
a) Un mélomane sort du rang, sert de truchement entre les artistes et le public.
b) Raccourci pour l'exploration : permet d'avoir une idée de ce qui a été donné en concert ; permet d'aider dans le choix des concerts ou des disques (ne serait-ce que parce qu'on connaît les marottes du critique).
c) Réputation. Formation de tous types : des littéraires, des compositeurs jaloux… Pas nécessairement les meilleurs connaisseurs ou les plus objectifs. Qui sont-ils pour critiquer ce qui font ? Quelle est leur légitimité ? Je raconterai sans doute l'anecdote terrible de la Sonate pour alto de Ligeti, mon pire frisson de pouvoir impuni, heureusement retenu à temps par l'impulsion de toujours se documenter avant que d'affirmer et de juger…
d) D'une façon qui me paraît assez absurde, le critique est un peu au sommet de la chaîne alimentaire : il donne la visibilité à toute action artistique, et c'était (il y a encore peu, même si cela change aujourd'hui !) le moyen principal de faire parler de ses concerts ; c'est aussi le moyen (avec la billetterie…) de rassurer les financeurs publics et privés. Les artistes, en général infiniment mieux formés que lui, sont obligés de le chouchouter, d'une façon parfois un peu absurde. Là aussi, j'ai des anecdotes.
e) Bien sûr je parlerai de la mauvaise réputation des critiques : ceux qui sont verbeux, ceux qui sont péremptoires, ceux qui sont méchants, ceux qui se vantent de ne pas vraiment écouter les disques. Alors que les plus intéressants sont ceux qui cherchent à être descriptifs et empathiques. (Coucou Frédéric Sarter / Peredovitch.)
4) Un concert de transcriptions.
L'intérêt de la transcription : préparation d'une œuvre avec solistes et accompagnateur, accès aux mélomanes avant le disque, puis jouer à petit coût, approprier pour son instrument, et pour les spectateurs de ce jour, renouveler l'écoute, permet à de nouveaux détails d'affleurer, à de nouvelles couleurs de s'épanouir.
5) Les œuvres au programme et la critique.
FAUNE
¶ Mallarmé extatique. (Parle d'approfondissement du poème par Debussy).
¶ Scandale des mouvements pelviens de Nijinski. (Première fois qu'on hue les Ballets Russes à Paris !)
¶ Succès et scandale tel qu'on doit repousser Daphnis, et que la police, dans le cadre de l'Alliance franco-russe, envoie des effectifs pour surveiller les mouvements de foule au Théâtre des Champs-Élysées et prévenir tout incident à potentielles répercussions diplomatiques !
RAVEL
¶ Initialement un Tombeau de Debussy.
¶ Musique pure, sans programme.
(¶ Boulez raconte encore des trucs à rebours de tout le monde là-dessus, mais je ne vais pas en parler, je vous le glisse juste pour égayer votre journée.)
SYRINX
¶ Initialement, La Flûte de Pan, musique de scène pour Psyché de Gabriel Mourey, avec lequel Debussy a conçu plusieurs projets d'opéra, dont un Tristan fondé sur la célèbre traduction / adaptation de Joseph Bédier (la première version à proposer l'ensemble du mythe).
¶ Musique depuis les cintres pour la séduction d'une nymphe par la musique de Pan. (Censé être la mort de Pan, lis-je, mais contradictoire avec l'explicite de la pièce.) L'acteur devait mimer la flûte sur scène, ce devait être assez horrible.
¶ Debussy refuse de faire des chœurs pour la pièce (en substance, il trouvait ça accessoire et kitsch).
¶ La pièce a donc été publiée en tant que telle seule, mais pensée initialement comme musique de scène.
NUIT TRANSFIGURÉE
¶ Poème de Dehmel. (Traduction maison dans le programme de salle.)
¶ Critique hostile à chaque étape créative de Schönberg : trop hardi, et sur le tard renvoyé à ses œuvres de jeunesse qui avaient pourtant été jugées trop hardies.
¶ Un mot rapide sur le dodécaphonisme (la démocratie en musique, toutes les notes sont égales) pour situer la démarche de Schönberg sur le temps long. Or la musique n'a pas de référent, on ne peut pas changer aussi vite la grammaire commune qu'avec la littérature ou les arts visuels. [Il existe une vidéo sur ce sujet, qui paraîtra le 11 juin, mais aussi des notules qui l'évoquent, comme celles sur le style révolutionnaire, sur la musique au temps de Werther. Et je me rends compte que j'avais aussi consacré un peu de temps à ce sujet dans la série sérielle et en notule-podcast.]
¶ La Nuit Transfigurée a été critiquée sur tous les plans : musique de chambre à programme (qui favorise le flou, la confusion), « évangile de l'amour libre » (sujet du poème), procédés éculés pour la lune, le fameux accord inexistant qui empêche la première exécution (une neuvième à la basse !), accusations de dissuader le public, de détruire le plaisir, de faire exprès de provoquer comme un jeune sauvage. Avant que d'être renvoyé plus tard dans sa carrière à l'idéal de sa Nuit Transfigurée, lorsqu'il écrivait encore des choses lyriques et écoutables.
6) Beaucoup de démarches possibles dans la critique : s'informer ; tomber dans le danger mortel des écoutes comparées… chaque membre du public peut se faire son propre chemin.
Le programme de salle
POUR LE FAUNE
Extrait de la tirade du Faune dans Mallarmé, L'Après-midi d'un Faune :
« Ô nymphes, regonflons des souvenirs divers.
Mon œil, trouant les joncs, dardait chaque encolure
Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure
Avec un cri de rage au ciel de la forêt ;
Et le splendide bain de cheveux disparaît
Dans les clartés et les frissons, ô pierreries !
J’accours ; quand, à mes pieds, s’entrejoignent (meurtries
De la langueur goûtée à ce mal d’être deux)
Des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux ;
Je les ravis, sans les désenlacer, et vole
À ce massif, haï par l’ombrage frivole,
De roses tarissant tout parfum au soleil,
Où notre ébat au jour consumé soit pareil. »
« Et la grandeur, le sublime… où les trouver, dans ces pages affectées et languissantes ? … Il se pourrait que M. Debussy occupât quelque jour dans l'histoire de la musique une place similaire à Verlaine et Mallarmé, poètes dotés d'originalité, mais d'aucune force. » (Arthur Coquard, compositeur)
« Pour la première fois les Ballets Russes furent hués. […] L'étendue du scandale, dans le contexte de l'alliance franco-russe, fut telle que la police dut montrer sa présence pour la deuxième représentation. » (Robert Orledge, Debussy and the Theatre)
POUR SYRINX
Écrit pour la musique de scène au début de l'acte III de Psyché de Gabriel Mourey, avec lequel Debussy eut plusieurs projets d'opéra.
« La scène représente la grotte de Pan ; par sa large ouverture, on aperçoit une clairière au cœur de la forêt touffue. Dans la prairie, un ruisseau passe, formant un petit lac. Rocher blancs au fond.
La lune inonde le paysage, tandis que la grotte demeure dans l’ombre. Dans la clairière, des nymphes dansent, vont et viennent, toutes vêtues de blanc, avec des poses harmonieuses. D’autres cueillent des fleurs, d’autres, étendues au bord de l’eau, s’y mirent. Par moments elles s’arrêtent toutes, émerveillées, écoutant la syrinx de Pan invisible, émues par le chant qui s’échappe des roseaux creux.
L'ORÉADE
Ainsi, tu ne l’avais encore jamais vu ?
LA NAÏADE
Jamais. Jamais Pan n’est venu
Dans le vallon où jusqu’à ce jour j’ai vécu
Seule, gardant l’humble source fleurie
Dont les brebis d’Hélios, après l’avoir tarie,
Ont desséché les bords et ravagé le lit.
Et j’ai dû fuir là-haut, sur ce rocher
Je le trouve effrayant et très beau, radieux
Et terrible, et bien tel qu’un dieu
Avec, autour de lui,
La splendeur de cette miraculeuse
Et chaude nuit
Qu’il enivre du son de sa flûte nombreuse !
L'ORÉADE
C’est ici qu’il habite ; entrons.
LA NAÏADE
Une autre fois…
J’ai peur, je te dis que j’ai peur ; lâche-moi.
L'ORÉADE
Peur de quoi ?
LA NAÏADE
Mais de lui. Puisqu’il est partout
Et qu’il est tout,
Qui sait si, dans cette caverne, en quelque coin,
Tout en restant là-bas, il ne se blottit point,
Parmi cette ténèbre bleue ou bien
Dans ce rayon qui vient
Si tendrement rôder sur mes épaules nues.
Et tiens, regarde, là, quelque chose remue…
Tu ne peux dire non.
L'ORÉADE
C’est l’ombre de ces feuilles
que la brise du matin proche a caressées.
LA NAÏADE
N’importe, ma sœur, je défaille ;
L’air brûle et je me sens glacée ;
Pan m’épouvante et de penser
Que tout à l’heure il me faudra peut-être
Affronter ses regards…
Non, non… avant qu’il soit trop tard,
Où me cacher, où disparaître ?
L'ORÉADE
Reste ; dès que tu le verras
De près, dès que tu entendras
Sa voix grave et tendre,
Je suis sûre que tu ne pourras te défendre
De l’aimer, je suis sûre que tu l’aimeras.
LA NAÏADE
Pan est méchant, cruel… Rappelle-toi le sort
De Syrinx et d’Echo.
L'ORÉADE
Je les envie !
Syrinx surtout, oui. N’est-ce pas du bord
Des roseaux creux où elle a répandu sa vie
Que le souffle de Pan donne l’essor
Aux sons ailés, aux rythmes d’or
Qui font germer dans le cœur des hommes la joie ?
N’est-ce pas l’âme de Syrinx qui, d’un vol droit
Et clair, par-delà les confins de l’éther bleu,
Monte enchanter les astres et les dieux ?
Mais voici que Pan de sa flûte recommence à jouer.
(Il commence à jouer de la flûte.)
LA NAÏADE, de plus en plus troublée
Prodige ! Il semble que la Nuit ait dénoué
Sa ceinture et qu'en écartant ses voiles
Elle ait laissé, pour se jouer,
Sur la terre tomber toutes les étoiles…
Oh ! comme, dans les champs solennels du silence,
Mélodieusement elles s'épanouissent !
Crois-tu que l'amant d'Eurydice
Faisait vibrer de plus touchants
Et plus sublimes chants
Les cordes d'airain de sa lyre
Non, n'est-ce pas ?
L'ORÉADE
Tais-toi, contiens ta joie, écoute.
LA NAÏADE
Si tu savais quel étrange délire
M'enlace, me pénètre toute !
Si tu savais… je ne puis pas te dire
Ce que j'éprouve. La douceur
Voluptueuse éparse en cette nuit m'affole…
Danser, oui je voudrais, comme tes sœurs,
Danser… frapper de mes pieds nus le sol
En cadence et, comme elles, sans effort,
Avec d'harmonieuses poses,
Éperdument livrer mon corps
À la force ondoyante et rythmique des choses !
Celle-ci qui, dans sa grâce légère,
Élève vers le ciel là-bas
Ses beaux bras,
Ressemble, au bord des calmes eaux
Où elle se reflète, un grand oiseau
Impatient de la lumière…
Et celle-là que des feuilles couronnent
Et qui, si complaisamment, donne
Aux lèvres de la lune à baiser ses seins blancs
Et l'urne close de ses flancs…
Et cette autre tout près qui, lascive, sans feinte,
Se roule sur ce lit de rouges hyacinthes…
Et cette autre dont on ne voit plus que les yeux
Étinceler, telles deux taches
De soleil, dans la frondaison de ses cheveux
Qui l'enveloppent et la cachent…
Par la chair d'elles toutes coule un feu divin
Et de l'amour de Pan toutes sont embrasées
Et moi, la même ardeur s'insinue en mes veines ;
Oh, Pan, les sons de ta syrinx, ainsi qu'un vin
Trop odorant et trop doux, m'ont grisée !
Oh, Pan, je n'ai plus peur de toi, je t'appartiens !
(Cependant la musique enchanteresse s’est tue.
Les nymphes se sont toutes tournées du côté de Pan encore invisible ; elles sont allées au-devant de lui, elles l’entourent, lui font cortège.)
LA NAÏADE, de plus en plus troublée
Ne m’abandonne pas… Il vient.
Quand il passera près de moi,
Ô dieux, vais-je mourir de joie !…
POUR VERKLÄRTE
Richard Dehmel, La Nuit transfigurée
(traduction David Le Marrec)
Deux êtres vont, à travers le bois nu et froid.
La lune mène sa course au-dessus d'eux ; ils la contemplent ;
La lune passe au-dessus des grands chênes.
Pas un petit nuage ne trouble la lumière qui tombe du ciel
Dans laquelle s'élancent les cimes noires.
Une voix de femme s'élève :
« Je porte un enfant. Il n'est pas de toi.
Je marche dans le péché, ici, à tes côtés.
J'ai lourdement fauté contre moi-même :
Je ne croyais plus au bonheur,
Et cependant je désirais ardemment
Le fruit de la vie, le bonheur d'être mère,
D'obéir à ses devoirs ; mais je me suis trop enhardie,
Et frissonnante, j'ai laissé mon sexe être étreint par un étranger ;
Je m'en suis même félicitée.
Mais voilà que la vie se venge,
A présent que je suis à tes côtés, toi que je bénis. »
Elle va d'un pas hésitant,
Lève le regard au ciel : la lune suit son cours,
Son regard voilé est submergé par la lumière.
Une voix d'homme s'élève :
« Que cet enfant, cet enfant que tu portes,
Ne pèse d'aucun poids sur ton âme ;
Vois, vois comme le monde entier resplendit !
Vois quel éclat nous environne !
Tu flottes à mes côtés sur la froide mer,
Et pourtant une chaleur singulière nous traverse,
De toi à moi, de moi à toi,
Elle va transfigurer cet enfant étranger :
C'est pour moi que tu vas le porter ;
Tu m'as donné la lumière,
Tu m'as moi-même fait enfant. »
Il l'étreint par ses larges hanches ;
Leur souffle se mêle dans les airs ;
Deux êtres s'en vont par la vaste, claire nuit.
Réception critique
« Évidemment, on redoutait que la vertu du programme de concert ne soit mise à mal par ce chapitre de l'évangile de l'amour libre et seuls les critiques, que l'on ne pouvait plus préserver de la corruption, reçurent des mains des employés de la salle une copie de ce poème peccamineux. » (Josef Scheu)
« Ceux qui ne connaissent pas le poème ne pourront suivre que la peinture de la magie de la nuit étoilée… et cela, encore, non pas parce que la musique de Schönberg implique une peinture claire et indubitable, mais parce que dans beaucoup d'opéras la lune et les nuits étoilées sont imitées avec des moyens semblables » (Richard Heuberger)
« Les auditeurs non familiarisés avec le poème de Dehmel ont dû se contenter de la musique, qui même sans programme proposait beaucoup de choses belles, intéressantes et excitantes. »
(Josef Scheu)
« Schönberg a pris le poème de Dehmel et l'a farci de fragments wagnériens de Tristan [de Wagner], de La Walkyrie, etc. » (article de la Revue du lundi)
« Cela sonne si l'on avait pris la partition de Tristan [de Wagner] encore humide et qu'elle avait déteint ! » (un membre, non précisé, du jury qui refusa une première exécution)
« Draperies orchestrales » causant d' « épouvantables cacophonies ». (Ludwig Karpath)
« Lorsqu'on détruit la forme seulement pour ne pas être comme les autres, on se met immédiatement hors jeu. Jamais Beethoven ni Brahms, lorsqu'ils avaient à dire quelque chose qui dépassait les limites habituelles, ne l'auraient forcé à entrer dans une forme trop petite, car ils n'auraient fait que balbutier alors qu'ils voulaient exprimer quelque chose de grandiose. » (Ludwig Karpath)
« Et si de telles expérimentations finissent par dissuader d'aller au concert encore plus de monde que cette saison, qui en portera la responsabilité ? Seulement ces jeunes musiciens croient que l'art n'est là que pour les amuser eux et pour irriter les autres. » (Richard Wallaschek)
Quand Schönberg s'exprime lui-même sur les critiques
« Une critique artistique est le fruit d'un effort, qui tente de définir une impression, de la matérialiser par des mots, en usant de comparaisons. Cet effort n'a pas nécessairement à se traduire par un jugement de valeur. Mais si jugement de valeur il y a […] alors [le critique] doit être de toute évidence apte à recevoir des impressions d'ordre artistique. »
« Si l'on veut être réceptif à une œuvre artistique, il faut mettre en jeu sa propre imagination. »
« J'ai découvert que si l'on met à part le plaisir malsain de détruire et l'envie que suscite inévitablement la supériorité d'un créateur, ces gens se trouvent plongés dans une profonde dépression morale par la nécessité où ils se trouvaient d'avoir perpétuellement à affirmer qu'ils comprenaient ou qu'ils aimaient une musique qui passait à d'effrayantes hauteurs au-dessus de leurs têtes. »
« Un certain sens du passé, une certaine intuition du futur sont également nécessaires. En fin de compte, on a le droit de se tromper, mais à condition d'être quelqu'un ! Combien nos critiques musicaux sont ici loin du compte ! La vraie raison en est leur incompétence. […] S'il fait des compliments, ce sera dans la seule intention d'irriter un confrère qu'il jalouse et dont il guigne la place. »
« […] se fier à un spécialiste – et surtout à celui qui en a usurpé le titre – pour juger d'une musique peut conduire au désastre. »
« L'influence que la critique pouvait avoir sur le public a complètement disparu et nul ne tient plus compte maintenant de ses jugements. »
« On comprendra sans peine qu'un compositeur conscient de la valeur de ce qu'il écrit et fort mal traité par la critique devienne quelque peu sceptique sur le crédit qu'il faut accorder à cette critique. 'Pourquoi donc', pourra-t-il se demander, 'se sont-ils bornés à mentionner ce qui leur déplaisait sans faire état de ce qui leur avait plu ? Ne pouvaient-ils admettre que même un veau à six pattes puisse avoir de beaux yeux ?' »
Et, pour le plaisir, quand Schönberg se fait lui-même critique
« Il n'y a pas de doute que la radio est un ennemi, au même titre que le gramophone et le film sonore. Un ennemi impitoyable, qui gagne irrésistiblement du terrain. Lutter contre elle est sans espoir.
Voici quels en sont ses plus funestes méfaits :
- Elle accoutume notre oreille à une sonorité vulgaire et innommable, à un gargouillis d'imprécision et de confusion qui exclut toute audition distincte. Le pire est peut-être que l'attitude du public envers cette sonorité va se modifier : […] à mesure que nous nous y habituerons, elle finira par nous servir de critère de beauté sonore et nous la trouverons supérieure à celle de tous les instruments qui étaient utilisés dans l'orchestre.
- Elle nous inonde d'un vrai raz de marée de musique. C'est peut-être ici que la terrifiante expression 'consommer de la musique' aura trouvé sa justification. Car ce perpétuel drelin, qui résonne sans s'occuper de savoir si l'on en a ou non envie, si l'on peut ou non l'entendre, si l'on peut ou non en tirer quelque chose, va nous conduire à un point où toute musique aura été consommée, vidé de sa substance. Au temps de Busch, [etc.] »
J'espère que ce petit récit vous aura égayé.
Je n'ai pas eu le temps d'ajouter de jolies images, les Milanais viennent de se faire paner et je dois essayer de trouver un peu de repos avant la réveil des supporters panaméens.
Je me contente donc, si ce sujet de la critique vous intéresse, de signaler deux des notules qui abordent la question :
¶ la famosa Le danger mortel des écoutes comparées ;
et, un peu plus récente,
¶ l'imposture de la critique, incluant quelques anecdotes que je retracerai de vive voix ce dimanche !
Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Discourir a suscité :
silenzio :: sans ricochet :: 222 indiscrets




 Christie
Christie