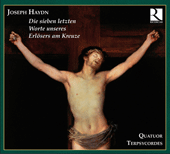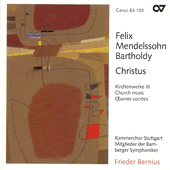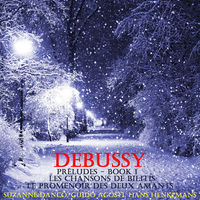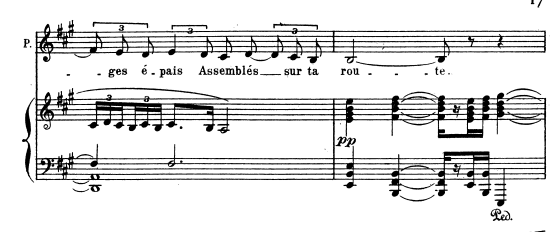dimanche 29 mars 2015
Ferdinand HÉROLD — Le Pré-aux-Clercs vu d'hier et d'aujourd'hui
(En fin de notule, vous pouvez télécharger deux versions de l'œuvre, en attendant la radiodiffusion des soirées de l'Opéra-Comique par France Musique.)

Extrait de la grande notice (lyrique) de Xavier Aubryet pour la revue L'Artiste, en 1859, longtemps après la mort du compositeur.
1. La place d'Hérold : Zampa (1831)
Le grand chef-d'œuvre d'Hérold reste Zampa ou la Fiancée de marbre (sur un livret de Mélesville), plaisant et tragique pastiche de Don Juan à grands coups d'ensembles, de couleur locale sicilienne, de pirates, de sérénades et de fantastique. Musicalement, si l'on sent toute l'équivalence avec la faconde et la célérité rossiniennes, le langage s'approche beaucoup de la richesse et des surprises de Meyerbeer – belles couleurs harmoniques et même orchestrales.
À sa création en mai 1831, six mois avant Robert le Diable, c'est ce que l'on fait de plus avancé musicalement en France (à l'Opéra du moins), d'assez loin devant Boïeldieu, Auber ou Halévy.
Il faut aller chercher chez des post-classiques comme Rodolphe Kreutzer pour trouver une autre forme de complexité qui puisse se comparer – ou partir en Allemagne, où les audaces sont bien plus conséquentes. En musique instrumentale, le cas est plus complexe, car les contraintes de langage, surtout en musique de chambre, sont très différentes.
Pour les détails, je renvoie aux notules précédemment consacrées à l'œuvre :
¶ Structure.
¶ Un peu de musique et distribution de la version donnée dans la même maison.
¶ Une parodie de Don Giovanni.
¶ ... vu sous l'angle de l'humour en musique.
¶ « Comique mais ambitieux » : une plus vaste évocation des finesses musicales de la partition.
En attendant d'ouïr un jour Le Siège de Missolonghi, où l'on retrouve paraît-il les prémices de Zampa…
2. Aujourd'hui même, au Pré-aux-Clercs
Le Pré-aux-Clercs, bien que composé plus d'un an plus tard (c'est son dernier opéra, créé en décembre 1832), tout en conservant un style similaire (petits airs galants ou piquants, échanges courts accompagnés de petites mélodies orchestrales soutenues par des trépidations de croches, grands ensembles…) reflète un aspect assez différent, plus caractéristique du reste de sa production : tout est très lumineux et gai, quasiment jamais de sections en mode mineur ni de moments de mélancolie réelle — les tristesses d'Isabelle (« Souvenir du pays ») sont finalement plutôt des ariettes qui semblent émaner d'un folklore fictif (puis parées de vocalisations virtuoses), et à l'exception de la scène de la barque funèbre, on n'a pas beaucoup le temps de s'apitoyer.
De façon très marquante, le livret d'Eugène de Planard supprime d'ailleurs tous les moments de solitude de Mergy : il est hors scène lorsque Marguerite de Valois souhaite par deux fois ourdir son complot amoureux, il est absent après qu'on lui a annoncé le mariage de sa bien-aimée selon la volonté du Roi, et entre les actes II et III, dans l'intervalle de l'entracte, se passent la révélation de l'amour d'Isabelle (elle n'a jamais eu l'occasion de le lui dire auparavant), la mise au courant du complot et leur mariage secret !
Autant dire qu'il a peu l'occasion d'exprimer sa tristesse ; tout juste sa colère lorsqu'il croit que Comminge va lui ravir ce qu'il aime. Son seul grand solo est d'ailleurs un air d'impatience amoureuse lorsqu'il arrive à Paris, plein d'espoir.
Pour le reste, le livret résume la Chronique du règne de Charles IX, l'un des rares ouvrages (longs et) faibles de Mérimée ; il ne faut pas en attendre des merveille, mais tout est très opérationnel pour la scène, et le jeu avec les nerfs du public de la fin est très réussi : le public sait qui se bat (contrairement aux trois femmes à l'avant-scène), mais ne voit pas le combat (or Comminge est invincible, c'est la prémisse première), puis arrive un corps en fond de scène (normalement Mergy), un archer l'arrête en disant qu'il vit encore (voilà comment sauver l'affaire), mais finalement non, et au moment où l'on peut se douter du subterfuge, le second du combat débarque et bafouille des paroles dépourvues de sens, avant l'arrivée finale de l'amant vainqueur. Plusieurs minutes où l'on se doute bien que tout va bien finir, mais où l'on ne parvient pas à voir de quelle façon exactement, si bien que le public finit par perdre confiance.
Pour nous, donc, le Pré aux clercs évoque furieusement du Rossini à la française, et même du Rossini assez peu mêlé d'affects, plutôt celui du Barbier de Séville. Les contemporains ne s'y sont pas trompés et Xavier Aubryet écrivait ainsi, dans sa longue présentation (enthousiaste) de l'art d'Hérold, pour la revue L'Artiste, en 1859 :
Zampa, qui fut son Guillaume Tell, comme le Pré aux clercs fut son Barbier de Séville
On remarquera au passage, à l'appui de cette impression, l'orchestration avec doublures de flûte à l'italienne et force pizz et cymbales, beaucoup plus sommaire que pour Zampa – témoin la romance de Camille introduite par les vents comme une sérénade populaire, qui n'a rien de révolutionnaire (Mozart fait ça aussi dans Così fan tutte), mais témoigne au moins d'un intérêt plus poussé pour les alliages instrumentaux…
Cette œuvre où l'on se tue, légère et jubilatoire, séduit assez immanquablement : les jolies mélodies délicates s'enchaînent au fil d'ensembles motoriques très efficaces. Ce fut déjà ressenti ainsi lors de la création, mais avec des nuances assez significatives qui ne laissent pas d'intéresser sur l'évolution des perceptions.
3. Au temps d'Hérold
L'œuvre est créée Salle des Nouveautés (ou Salle de la Bourse), mais elle est aussi choisie pour l'inauguration de la deuxième Salle Favart en 1840 (après l'incendie de 1838).
Le sujet de l'œuvre, qui peut nous paraître futile, était en réalité au cœur de l'actualité puisque Mérimée venait de publier sa Chronique du règne de Charles IX qui marque précisément (avec le plus solennel Cinq-Mars de Vigny) le début de l'engouement français pour le roman historique « médiéval ». Meyerbeer a d'ailleurs écrit pendant ces mêmes années (et commencé avant Hérold) ses Huguenots, sur un livret de Scribe inspiré des mêmes années (et manifestement marqué à son tour par Mérimée). Autrement dit, ce qui nous paraît pure convention décorative était au cœur de l'actualité littéraire, comme si l'on faisait un film sur le dernier Houellebecq.
Par ailleurs, si les contemporains ont bien ressenti l'impact dramatique de Zampa (et l'ont d'ailleurs moins aimé : 250 représentations en 1859, contre 800 pour le Pré), ils n'ont pas forcément vécu le Pré-aux-Clercs aussi légèrement que nous :
En affichant pour son jour d'ouverture le Pré-aux-Clercs d'Hérold, l'Opéra Comique a fait un acte de convenance qui lui a réussi. C'est ainsi que depuis quelques années les Italiens ont pris la coutume d'inaugurer la saison d'hiver avec les Puritains de Bellini ; et peut-être y aurait-il plus d'un rapprochement à faire entre ces deux partitions, œuvres suprêmes de deux génies qui se ressemblaient tant.
Écoutez le Pré-aux-Clercs ; que de mélancolie dans ces cantilènes si multipliées ! que de pleurs et de soupirs étouffés dans cette inspiration maladive ! comme toute cette musique chante avec tristesse et langueur ! Il y a surtout au premier acte une romance d'une mélancolie extrême ; l'expression douloureuse ne saurait aller plus loin. Eh bien ! cette phrase d'un accent si déchirant, vous la retrouvez dans les Puritains ; et, chose étrange, pour que rien ne diffère, les paroles sur lesquelles s'élève cette plainte du cygne, les paroles sont presque les mêmes : Rendez-moi ma patrie ou laissez-moi mourir, chante Isabelle dans le Pré-aux-Clercs, et dans les Puritains, Elvire : Rendetemi la speme o lasciate mi [sic] morir. Quoi qu'il en soit, le Pré-aux-Clercs d'Hérold est, comme les Puritains de Bellini, une partition pénible à entendre. Cette mélancolie profonde qui déborde finit par pénétrer en vous. Chaque note vous révèle une souffrance de l'auteur, chaque mélodie un pressentiment douloureux, et votre cœur se navre en entendant cette musique où l'ame de ces nobles jeunes gens semble s'être exhalée, cette œuvre écrite pendant les nuits de fièvre, et dont la mort recueillait chaque feuillet.
(Revue des deux mondes, 31 mai 1840.)
Il y a là, certes, un plaisir de prophétie rétrospective, de pair avec une croyance dans la superposition entre l'homme et l'œuvre qui n'a plus cours ; néanmoins, qualifier de « mélancolie extrême », d' « expression douloureuse » et de « souffrance » l'univers émotionnel du Pré-aux-Clercs, personne n'y songerait aujourd'hui.
Eh oui, on n'avait pas encore écouté le Sacre du Printemps en boucle, et les moindres inflexions d'une cantilène en mode majeur pouvaient encore faire chavirer les cœurs. De même qu'on peine à se figurer le public en larmes lorsque Gluck crée Iphigénie à Paris… pour nous, il s'agit de musiques intenses, mais toujours mises à distance par une sorte de jubilation purement musicale… on ne peut croire au désespoir réel sur des ritournelles majeures. Et pourtant, vu que la musique ne touchait pas encore aux zones où nous plaçons l'émotion triste, cette nuance subtile était ressentie.
(Tout de même, je m'interroge, pour cet Hérold-ci…)
Dans le même registre, Comminge, le bretteur irracible et invaincu, que nous distribuerions volontiers à un méchant ténor dramatique ou de caractère (d'où le choix des voix étranges de Paul Crook ou d'Emiliano Gonzalez Toro, dans les productions récentes), était confié pour la création à Louis-Augustin Lemonnier (tantôt décrit comme ténor, tantôt comme baryton), spécialisé dans les œuvres légères mais réputé pour son élégance — il a d'ailleurs tenu rien de moins que le rôle du comte de Torellas dans Masaniello ou le Pêcheur napolitain de Michele Carafa (sur le même sujet que la Muette de Portici d'Auber).
Ce choix est totalement respecté dans l'enregistrement de Benedetti, la seule version complète officiellement publiée à ce jour, puisque le rôle est confié à… Camille Maurane !
4. En 2015
Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Opéra-comique (et opérette) a suscité :
2 roulades :: sans ricochet :: 3512 indiscrets