[Carnet d'écoutes n°70] — Médée-Kožená, Barber-Roe, nouveau Rossignol éperdu, les meilleurs Wesendonck, Sextuors germaniques décadents, Quatuors de Haydn et Katzer…
Par DavidLeMarrec, dimanche 22 mars 2015 à :: Carnet d'écoutes :: #2650 :: rss
Cette fois-ci :
- Spectacle vivant :
- Médée de Charpentier à Bâle avec Magdalena Kožená.
- Re-création de Nausicaa de Hahn à l'Hôtel de Birague.
- Trois nouveautés (très réussies !) :
- Récital « Révolution » d'Emmanuel Pahud consacré à la fin du XVIIIe français, dirigé par Giovanni Antonini (Warner).
- Parution d'une quatrième version du Rossignol éperdu, vaste cycle pour piano en quatre parties de Reynaldo Hahn, par le spécialiste Billy Eidi (Timpani).
- Récital Barber-Britten d'Elizabeth Joy Roe, du formidable duo Anderson & Roe (Decca).
- De grandes versions de Haydn (quatuors) et Mozart (concertos).
- Chefs-d'œuvre du répertoire romantique et postromantique pour quintette et sextuor à cordes : Brahms, Wagner, Tchaïkovski, Bruckner, Rimski-Korsakov, Zemlinsky, Braunfels, Korngold…
- … dont la plus belle version des Wesendonck jamais enregistrées (Breedt / Sextuor à cordes de Vienne).
- Du contemporain : symphonique pour Lachenmann, quatuors pour Katzer.
- Arrangements divers pour cor et guitare ; arrangements de Schubert pour guitare solo.
- … et quelques autres (bonnes) choses.









Dimanche 8 mars
¶ Lachenmann – Tableau pour orchestre – Berliner Phkr, Rattle 

Agréable, mais pas très audacieux pour du Lanchenmann, on retrouve le langage standard de l'atonalité internationale, avec un langage et des outils symphoniques très habituels… Beau, mais très banal – il s'embourgeoise décidément !

¶ Britten – Concerto pour piano – Elizabeth Joy Roe, LSO, Tabakov 


¶ Barber – Concerto pour piano – Elizabeth Joy Roe, LSO, Tabakov 

 +
+
¶ Barber – Nocturne d'hommage à John Field – Concerto pour piano – Elizabeth Joy Roe 



¶ Britten – Night Piece – Elizabeth Joy Roe 


 +
+
Passé la surprise de voir en si bonne place Roe (alors que je misais bien davantage sur Greg Anderson dans leur formidable duo, dont les qualités individuelles de son et de discipline me frappaient davantage), c'est bien sûr un enchantement de la voir atteindre à ce degré de notoriété… Et, alors que je la trouvais un brin frêle dans le duo, on n'entend pas la moindre faiblesse ici.
Surtout, Elizabeth Roe ne s'est pas vendue à DECCA pour jouer du Chopin ou du Liszt : on a le droit à un album qui met opportunément en regard les deux grandes figures anglo-saxonnes du milieu du XXe siècle. Et si les concertos sont beaux (en particulier le Barber, qui évoque la fulgurante Sonate en légèrement plus sucré), les deux pièces nocturnes en complément (de vraies raretés) constituent deux bijoux de poésie très intenses (en particulier le Britten avec lequel l'album culmine tout en délicatesse).
Recommandé !

¶ Mozart – Concerto pour piano n°9 – Northern Sinfonia, Imogen Cooper (piano et direction) 




¶ Mozart – Concerto pour piano n°23 – Northern Sinfonia, Imogen Cooper (piano et direction) 



¶ Mozart – Concerto pour piano n°22 – Northern Sinfonia, Imogen Cooper (piano et direction) 


Grande accompagnatrice à la musicalité éprouvée, Imogen Cooper fait ici valoir tout son talent d'équilibre et de juste mesure avec des concertos à la fois primesautier et mélancoliques ; à la fois nets, lyriques et sobres. Malgré le son un peu flou du Northern Sinfonia, le disque couplant les deux plus beaux concertos de Mozart (9 & 23) est, pour moi, le disque ultime pour ce corpus. Je n'écoute quasiment plus que celui-là.
¶ Massenet – Manon, acte I (en allemand) – Jurinac, Dermota, NDR, Schüchter 

Toujours très sucré, mais chanté et joué comme ça, a tout de même de l'allure !

¶ Charpentier – Médée – M. Hartmann, Kožená, Dahlin, Tittolo, La Cetra, Marcon 




Dépaysement d'entendre à Bâle un ensemble plutôt spécialisé dans le répertoire italien (et dirigé par Andrea Marcon !) jouer avec beaucoup de style cette œuvre qu'on joue parfois hors de France, mais qu'on n'entend jamais retransmis jusqu'ici. Le Prologue (sans lien avec l'action et peu intéressant musicalement) est coupé (ainsi que quelques morceaux des divertissements), et la mise en scène de Nicolas Brieger transpose assez habilement dans une autre forme de palais plus récent, avec un grand soin apporté à la direction individuelle des acteurs ; très opérant.
Distribution fantastique : Kožená très en mots (« Dieux du Cocyte et des royaumes sombres » à couper le souffle), Dahlin toujours plus à l'aise dans le rôle au fil des ans, Meike Hartmann tout en rondeurs mordorées (et pourvue d'une très bonne diction… superbes duos)…
C'est encore visible sur CultureBox, ne le manquez pas : http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/opera/medee-de-charpentier-au-theatre-de-bale-211445.
¶ Massenet – Manon (acte I) – Los Ángeles, Gedda, Met, Morel 

Ne croyez pas que je prenne du plaisir à multiplier ces expériences — on m'a forcé. (Surtout si c'est pour écouter Gedda en voix pleine dans un rôle qui réclame de l'élégance…).
C'est disponible sur Musique Ouverte.

¶ François Devienne – Concerto n°7 en mi mineur – Pahud, Chambre de Bâle, Antonini 


¶ Luigi Gianella – Concerto n°1 en ré mineur – Pahud, Chambre de Bâle, Antonini 

 +
+
¶ Gluck – Concerto Op.4 en sol majeur – Pahud, Chambre de Bâle, Antonini 


¶ Ignaz Pleyel – Concerto B.106 en ut majeur – Pahud, Chambre de Bâle, Antonini 

 +
+
¶ Antoine Hugot – Rondeau en sol majeur – Pahud, Chambre de Bâle, Antonini
Nouveauté. En réalité écoutée au fil de la semaine, concerto par concerto…
Le princip est simple : des concertos pour flûte dans le goût français, écrits à la fin du XVIIIe siècle… tous dans une veine tempêtueuse, traversée d'éclairs de lumière… pas forcément évidents à différencier, mais chacun a ses beautés, vraiment un choix de très belles pièces : l'étrange palpitation militaire des bois au sein d'un mouvement final plus léger et lumineux chez Gianella, le mouvement lent galant (mais à la manière romantique) suivi d'un final qui hésite entre l'allégresse mozartienne et quelque chose de plus tournoyant et tourmenté chez Pleyel…
Très beau corpus, rarement parcouru… un plaisir qu'un artiste de cette notoriété s'y prête au lieu de réenregistrer Haydn et Mozart, surtout avec un accompagnement aussi adéquat et ardent.
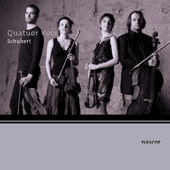
¶ Schubert – Quatuor n°8 – Voce SQ 

 +
+
¶ Schubert – Quartettsatz – Voce SQ 



Pas aussi neuf et bouleversant que leur participation au concours d'Évian-Bordeaux (avec le Quartettsatz à une prise de risque maximale), mais très beau tout de même ! Vraiment un ensemble doté d'une personnalité, qu'on se réjouit d'entendre à chaque fois…
Lundi 9 mars
¶ Wagner – Die Meistersinger (acte I, final) – Kónya, Stewart, Crass, Radio Bavaroise, Kubelik 



 ¶ Wagner – Die Meistersinger (acte II, début) – Janowitz, Fassbaender, Unger, Kónya, Stewart, Crass, Radio Bavaroise, Kubelik
¶ Wagner – Die Meistersinger (acte II, début) – Janowitz, Fassbaender, Unger, Kónya, Stewart, Crass, Radio Bavaroise, Kubelik 


 +
+
¶ Hahn – Nausicaa – Compagnie de L'Oiseleur (Hôtel de Birague) 

 +
+
Concert. Vrai bijou ; œuvre et contexte présentés dans la notule correspondante.
¶ Schubert – Quatuor n°8 – Voce SQ 

 +
+
Mardi 10 mars
¶ Wagner – Die Meistersinger (acte II) – Janowitz, Fassbaender, Unger, Kónya, Stewart, Crass, Radio Bavaroise, Kubelik 


 +
+
¶ Mahler – Symphonie n°3 (IV-V-VI) – Lucerne, Abbado 




Je suis toujours surpris par le refus de la tension continue dans cette version, qui privilégie l'exaltation du détail des petits épisodes. Magnifique lecture, mais j'avoue que j'aime encore davantage lorsque l'étau ne se desserre pas, comme chez Kondrachine, Rögner, Ozawa, Salonen, Litton, Chailly…
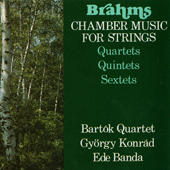
¶ Brahms – Quintette à cordes n°1 Op.88 – Bartók SQ (Hungaroton) 


Voilà une interprétation qui a du grain. Les ensembles choisis comme les prises de son chez Hungaroton sont en général dans cette veine : robuste, proche, réaliste, légèrement rugueuse. J'aime beaucoup.
Ce coffret inclut toutes les œuvres à cordes, des quatuors aux sextuors ; les Quintettes en sont les parents pauvres, rarement programmés et moins enregistrés, mais ce n'est pas justice : moins ouvertement mélodiques que les Sextuors, ils ont peut-être davantage de matière interne pourtant.
Mercredi 11 mars
¶ Gluck – Concerto en sol majeur Op.4 – Pahud, Basel ChbO, Antonini 


(Voir plus haut.)
¶ Brahms – Quintette à cordes n°1 Op.88 – Sextuor de Vienne (Pan Classics) 

 +
+
¶ Brahms – Quintette à cordes n°2 Op.111 – Sextuor de Vienne (Pan Classics) 



Joué avec la finesse de cet ensemble spécialiste, devient assez formidable.
¶ Brahms – Abendständchen (arrangement Rudolf Leopold) – Sextuor de Vienne (Pan Classics) 


 +
+
¶ Brahms – Nachtwäche I (arrangement Rudolf Leopold) – Sextuor de Vienne (Pan Classics) 


 +
+
Toute la beauté des harmonies chorales de Brahms dans l'écrin d'un sextuor à cordes. Assez bouleversant.
¶ Debussy – La Cathédrale engloutie (arrangement Rudolf Leopold) – douze violoncellistes des Berliner Phkr  +
+

¶ Braunfels – Quintette à cordes – Quatuor Gringolts 
 +
+
A ses moments dramatisés – l'œuvre commence comme si on débutait sur la pointe des pieds un opéra, avec un personnage qui entrerait (façon Fiorello ?). Le reste est du Braunfels standard, du germanisme bien robuste, assez abstrait tout de même.
¶ R. Strauss – Metamorphosen (arrangement pour septuor de Ruldolf Leopold) – Sextuor de Vienne 



¶ Korngold – Sextuor à cordes – Sextuor de Vienne 

 +
+
¶ Zemlinsky – Quintette à cordes – Sextuor de Vienne 


 +
+
Moins célèbre que ses Quatuors, mais largement du même niveau, une œuvre tout à fait majeure et formidable, sombre mais généreuse.
¶ Zemlinsky – Maiblumen blühten überall – Banse, Sextuor de Vienne 


 +
+
Là aussi, l'une des plus belles œuvres de Debussy, à la beauté capiteuse ineffable.
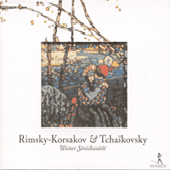
¶ Tchaïkovski – Souvenir de Florence – Sextuor de Vienne 



Une lecture très énergique et élancée, avec toute la finesse propre à cet ensemble.
¶ Rimski-Korsakov – Sextuor à cordes – Sextuor de Vienne 



¶ Album « La Résonance », par Tsutomu Maruyama (cor) et Shunsuke Matsuo (guitare). 

 +
+
Arrangements d'œuvres de Gervaise, Corrette, Mozart, Glière, Scriabine, Rachmaninov, Françaix, Granados, Kurijama pour cor et guitare…
D'une grande élégance, de beaux équilibres, des couleurs nouvelles… la mélodie de Rachmaninov est superbe, et même l'espagnolade déformée et assombrie de Kuriyama fonctionne à merveille. Très chouette disque.

¶ Katzer – Quatuor n°1 – Sonar SQ 

 +
+
¶ Katzer – Quatuor n°3 – Sonar SQ 


¶ Katzer – Quatuor n°4 – Sonar SQ 

Quelle allégresse de découvrir cette parution dans la maigre discographie de Katzer, que je n'avais pas vérifiée depuis quelques années. La musique de chambre est un genre particulièrement périlleux pour les nouveaux langages du XXe siècle, exposant les difficultés d'intelligibilité sans permettre les jolis expédients d'orchestrations (beaucoup de compositeurs bien en cour, à commencer par Boulez d'ailleurs, sont avant tout de grands orchestrateurs, plus que des constructeurs à la fois talentueux et suffisamment accessibles) ; même un compositeur soucieux de lisibilité comme Rihm se noie un peu dans le trio avec piano (et n'est pas particulièrement limpide dans ses quatuors, même s'ils valent mieux que bien d'autres).
Chez Katzer, justement, on retrouve dans les quatuors les mêmes qualité que dans le trio avec piano : directionnalité limpide, soli expressifs, écriture en accords, construction de climax grâce à des tuilages harmoniques progressifs, un peu comme chez Mahler… et même un certain lyrisme ! Vu les intervalles mélodiques utilisés, pourtant, cela sent fort la série dodécaphonique !
Tout cela vaut surtout pour le Premier Quatuor : le Troisième et le Quatrième ont aussi ces qualités, mais à un degré moindre, usant d'avantage de stridences (et même d'un certain minimalisme assez peu à mon gré, dans la Quatrième). En tout cas, si vous vous intéressez au quatuor contemporain, vraiment un corpus à découvrir !
¶ Elgar – Concerto pour violoncelle – vidéo Du Pré & Barenboim 

 +
+
Il y avait longtemps que je n'avais pas écouté cette version, un peu occupé ailleurs. Un peu plus expansif et moins fin qu'avec Barbirolli, sans doute, mais quand même toujours très intense et beau — il faut surtout être dans l'humeur, bien préparée par le voisinage plkus ascétique de Katzer.

¶ Herzogenberg – Requiem Op.72 – Chœur Monteverdi de Würzburg, Philharmonique Thuringien de Gotha-Suhl, Matthias Beckert 

Proche de Brahms, et musicalement une fois encore : l'ensemble ressemble assez fort à un agréable sous-Requiem allemand (en latin), où seul intervient le chœur. L'enregistrement est défavorisé, il est vrai, par le Chœur Monteverdi, manifestement amateur, qui assume la tâche mais manque absolument de relief (les voix assez blanches et plates ne peuvent pas fournir des contrastes comme des voix éduquées).
On perçoit tout de même une spectaculaire pointe à quatre tartelettes dans un endroit généralement peu choyé par les compositeurs : l'Hostias développe un langage assez différent du reste, beaucoup moins épais, qui évoque beaucoup les chœurs féminins de Brahms !
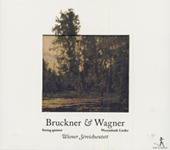
¶ Bruckner – Quintette à cordes – Sextuor de Vienne 


Superbe version d'une œuvre qui tire le meilleur du Bruckner symphonique (même langage, mais pas de lourdeurs possibles). Toujours cette finesse du sextuor viennois.
¶ Wagner – Wesendonck-Lieder (arrangement Rudolf Leopold) – Michelle Breedt, Sextuor de Vienne (Pan Classics) 



Meilleure version de tous les temps. Toute l'épaisseur un peu gourde de la version orchestrale, même les parties écrites par Wagner, même dans les réductions pour ensemble, disparaissent, pour laisser place à la finesse de l'aventure harmonique. En plus, Michelle Breedt, à la fois suspendue et éloquente, est une fois de plus idéale. L'œuvre s'en trouve haussée, à mon sens.
Prise de son étrange : les cordes sont nettes, mais la voix est réverbérée. C'est agréable et opérant, mais un peu bizarre lorsqu'on y prête attention.
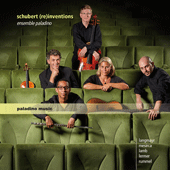
¶ Schubert – Lieder des trois grands cycles arrangés pour guitare (sans voix) par Johann Kaspar Mertz – Alberto Mesirca (Paladino Music) 


 +
+
Jeudi 12 mars 2015
¶ Korngold – Sextuor à cordes (I,II) – Sextuor de Vienne 

 +
+
¶ Wagner – Tristan und Isolde (fin du I, tout le II et le III) – Karajan studio 




On peut redire sur les solistes (aucun n'est à mon gré, en fait, excepté Ridderbusch), mais c'est l'une des versions les plus captivantes de toutes.
Vendredi 13 mars 2015
¶ Wagner – Tristan und Isolde (fin du I, début du II) – Böhm 1966 




Autre classique indémodable de la discographie, là aussi malgré une distribution qui n'a pas forcément ma faveur sur le principe.
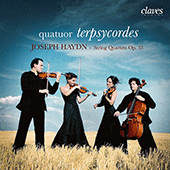
¶ Haydn – Quatuor Op.33 n°5 – Terpsycordes SQ 



¶ Haydn – Quatuor Op.33 n°2 – Terpsycordes SQ 

 +
+
Sur instruments d'époque, on n'a pas fait mieux, et de très loin : l'une des lectures les plus spirituelles de ce groupe. Depuis que je les ai entendus pour la première fois (jouer le Premier de Ligeti !) pendant le Concours d'Évian-Bordeaux, où je ne m'étais pas expliqué leur élimination au premier tour, je les suis avec plaisir, et je n'espérais pas alors une telle discographie, très méritée d'ailleurs (leur Treizième de Schubert est merveilleux aussi, et leurs Sept Dernières Paroles, et la plupart du reste…).
Au demeurant, l'opus 33 est, avec les deux derniers cycles, le plus intéressant des quatuors de Haydn (étrange baisse d'intérêt dans les opus des quarantaine et cinquantaine…).
Samedi 14 mars 2015
¶ Gluck – Concerto Op.4 en sol majeur – Pahud, Chambre de Bâle, Antonini 


¶ Ignaz Pleyel – Concerto B.106 en ut majeur – Pahud, Chambre de Bâle, Antonini 

 +
+
(Voir précédemment.)
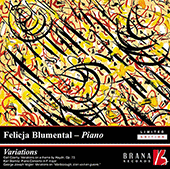
¶ Czerny – Thème et variations sur Haydn pour piano et orchestre – Felicja Blumental, Chambre de Vienne, Froschauer (Brana Records) 
 +
+
(En réalité le mouvement lent du quatuor Op.76 n°3. Chouette réalisation de Czerny.)
¶ Stamitz – Concerto pour piano en fa majeur – Felicja Blumental, Chambre de Vienne, Froschauer  +
+
Agréable, comme les concertos moyens de Mozart. Du Stamitz, en somme.
¶ __Abbé Vogler – Variations sur Malborough – F. Blumental, Chambre de Vienne, Zedda 
Le choix du thème (déjà rapidement pénible) n'était pas forcément judicieux, et la réalisation n'en est pas forcément intéressante…
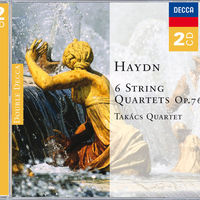
¶ Haydn – Quatuor Op.76 n°4 – Takács SQ 



¶ Haydn – Quatuor Op.76 n°5 – Takács SQ 



¶ Haydn – Quatuor Op.76 n°6 – Takács SQ 



¶ Haydn – Quatuor Op.76 n°3 – Takács SQ 




Des merveilles. Et la robustesse du spectre des Takács s'allie avec une réelle souplesse et une espièglerie non feinte. Le tout culminant dans les murmures blancs de la dernière variation du thème patriotique, ou leur archet allant et leurs portamenti dans le menuet. Il s'agit des musiques qui mettent le plus à nu le savoir-faire et l'imagination d'un ensemble, dont les très grands représentants, de tout temps, sont rares. En voilà quelques-uns.
¶ Schubert – Symphonie n°8 – Orchestre du Festival Menuhin, Menuhin 


¶ Schubert – Ouverture d'Alfonso und Estrella – Orchestre du Festival Menuhin, Menuhin 


Toujours une valeur sûre, même avec la lenteur pour Estrella, la tension demeure (et quelle gestion des traits de cordes !).

¶ Hahn – Le Rossignol éperdu – Billy Eidi 



Cette quatrième version d'un cycle majeur du répertoire pour piano vient de sortir chez Timpani. Pas forcément de différence majeure avec les précédentes, mais les parties archaïques sont plus réussies, les phrasés moins romantisants que chez Earl Wild, la prise de son moins réverbérée chez Cristina Ariagno (dont je parlerai dans les prochains carnets d'écoutes).
Un siècle de piano, de Schumann jusqu'à Roussel en passant par Liszt, passe dans le piano de Hahn, sans parler des archaïsmes pseudo-baroques… dans ce genre plastique et « totalisant », les exemples n'abondent pas en musique française.
[Autre cycle majeur chez lui, La Création du Monde, dans le goût des Clairs de lune d'Abel Decaux… mais j'en reparlerai plus tard également.]
¶ Schubert – Trio avec piano n°2 – Stern, Rose, Istomin 



Fableux d'énergie, et Istomin est vraiment intéressant cette fois-ci. Interprétation considérablement meilleure qu'il m'avait autrefois semblé, tout de bon une référence en réalité.
--
--
Comment ça marche ?
La cotation est complètement subjective et ne prend pas en compte la qualité mesurable de l'oeuvre, seulement le plaisir que j'ai à l'écouter (à ce moment précis). L'interprétation n'est pas prise en compte.
Une tartelette au citron (ou un putto d'incarnat selon les jours) est signe que ça m'a plu.
![]()
Une oeuvre agréable, qui n'appelle pas forcément la réécoute.
Exemple : Le trio avec piano de Rihm.
![]()
![]()
Une oeuvre intéressante, qui méritera d'être réécoutée de temps à autre.
Exemple : Les premiers trios de Beethoven.
![]()
![]()
![]()
Une très belle oeuvre, qui appelle des écoutes régulières.
Exemple : Les trios de Debussy et Ravel.
![]()
![]()
![]()
![]()
Un chef-d'oeuvre, une des oeuvres importantes de ma discothèque, à réécouter abondamment.
Exemple : Les trios de Théodore Dubois.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
L'une des quelques oeuvres qui me sont extrêmement chères.
Exemple : Les quatuors de Czerny.
Ainsi, à part la tartelette esseulée qui est un peu mitigée (oeuvre agréable mais oubliable, ça va bien si le temps ne nous est pas compté), la seule présence de portion citronnée indique que j'ai aimé. Le principe n'a donc rien à voir avec les étoiles « objectives » des magazines qui donnent ou pas la moyenne aux enregistrements.
Exceptionnellement, si je suis vraiment en colère, je peux aussi le signaler. Je distribue alors des tartelettes au citron meringué, qui sont à la vraie tarte au citron ce que les persécutions nazies sont à l'Éphèse classique.
![]()
Je n'ai pas aimé du tout, du tout. Ça ne me parle pas.
Exemple : L'oeuvre orchestrale d'Olga Neuwirth.
![]()
![]()
C'est insupportable, grotesque, scandaleux. Et surtout ça fait mal.
Exemple : L'oeuvre pour orgue de Philip Glass.
![]()
![]()
![]()
Je suis mort.
Commentaires
1. Le jeudi 26 mars 2015 à , par Chris
2. Le jeudi 26 mars 2015 à , par DavidLeMarrec
Ajouter un commentaire