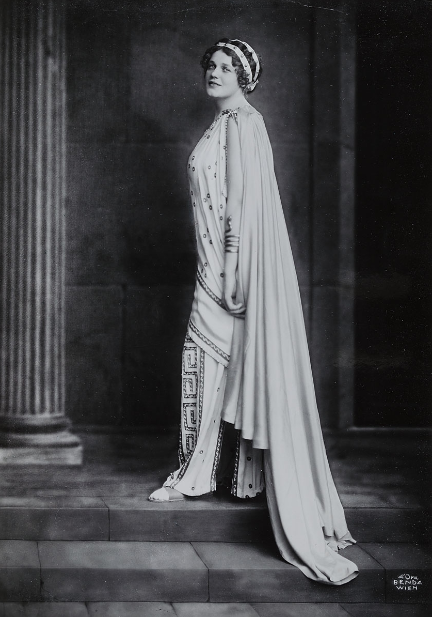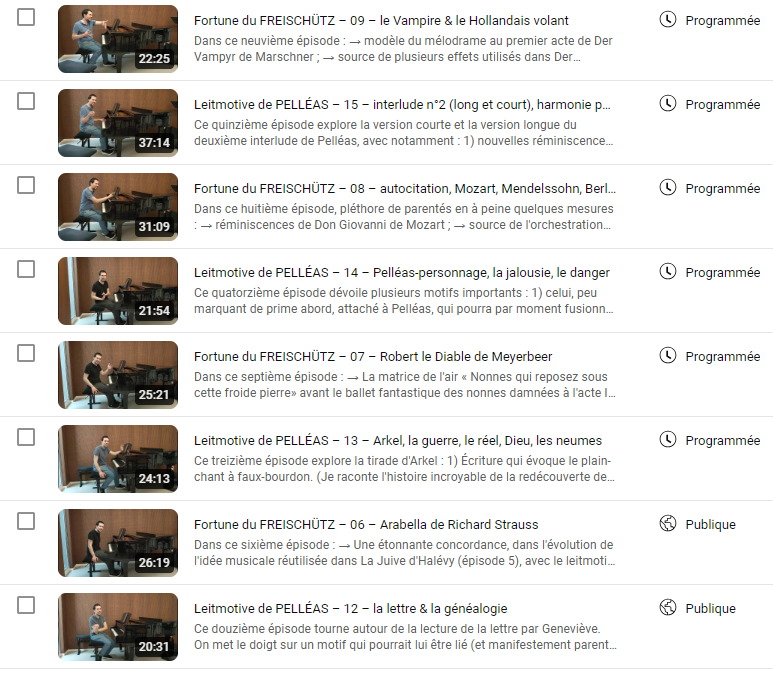 Aperçu des prochaines publications en format vidéo
Aperçu des prochaines publications en format vidéo.
A. Le concept
À présent que la série
Leitmotive de PELLÉAS est lancée en
vitesse de croisière (tout l'acte I est capté, ainsi que la première
scène de l'acte II, échelonnement de publication tous les samedis
jusqu'à fin juillet) et que la série
Fortune du FREISCHÜTZ est achevée (publication
automatique tous les mercredis, jusqu'en septembre), je ne reviendrai
probablement pas ici sur chaque nouvelle parution. Mais je voudrais en
dire un mot supplémentaire.
Sachez donc que cette série qui explore les
leitmotive dans
Pelléas
– un phénomène réel,
quoi qu'en die Pierrot le Fou –, et de même, celle
dédiée à l'influence de la Gorge du Loup, dans le
Freischütz de
Weber, sur toute la musique du XIXe siècle, sont issues de désirs de
notules contrariés par la lourdeur logistique de l'entreprise et la
charge considérable en temps à allouer.
Je me figure, dans l'imaginaire épique qui est le mien, qu'un certain
nombre de lecteurs fidèles se sentent apassablement trahis par ce
passage de l'écrit, plus structurant (et plus rapide à ingérer !), au
profit de la superficialité de la vidéo, accréditant toutes les
craintes de tiktokification de l'humanité.
Pourtant ce n'est pas un renoncement à la notule écrite – j'ai
conscience qu'elle est plus commode, et je suppose que les lecteurs
réguliers de CSS sont attachés à son format, à son
ton –, mais
bien la possibilité de faire vivre celles qui, trop ambitieuses, ne
pourraient jamais voir le jour.
En réalité, outre que ce format m'était réclamé depuis un certain temps
par quelques lecteurs ou amis, l'impact se révèle nul sur la production
de notules écrites : ce n'est pas le même quota temps qui est utilisé.
Et, surtout, ce travail que je souhaitais réaliser depuis longtemps
peut voir le jour à court terme, tout simplement impossible à réaliser
en notule, puisque je joue dans l'ordre l'intégralité de l'opéra, en
l'entrecoupant de commentaires et de références à d'autres œuvres. La
quantité de texte à écrire et de sons à incruster (passage complet,
sous-passage, détail, parentés…) n'est tout simplement pas
envisageable, sauf à en faire un temps plein sur plusieurs années.
S'il en existe un jour une déclinaison écrite, ce sera donc plutôt la
transcription du texte des vidéos sans les extraits afférents, en guise
de témoignage.
En revanche, je prévois bien, à la fin de l'exercice (un mois et demi
pour publier les 11 épisodes de la scène 1, je vous laisse mesurer le
temps qui nous sépare de l'achèvement du cycle), de produire quelques
notules autour des faits « motiviques » les plus marquants de
Pelléas
: quelques-unes des mutations ou des superpositions les plus parlantes
; ou bien certains thèmes que je n'aurais pas rencontrés dans les
livres mais que j'aurais identifiés, à travers plusieurs moments de
l'œuvre – le motif de la clarté me semble un client intéressant pour
cet exercice, mais il faut encore que je confronte mon intuition à
l'entièreté de la partition d'abord, et du corpus critique ensuite. Car
il est possible que je n'aie pas encore lu les pages où il est
identifié, ou bien qu'il soit attribué à une autre idée – ce qui
m'amènera à coup sûr à débattre des différentes hypothèses.
Bref, il faudra vraisemblablement attendre avant que tout ceci ne soit
publié sous forme écrite, et de façon très partielle. C'est pourquoi
j'invite les pelléassiens curieux, qui sont nombreux parmi les lecteurs
de ces pages, à aller jeter un œil
à la série.
Certes, c'est, pour des raisons évidentes de temps – j'abomine le
montage, aussi, très long et abrutissant –, produit de façon totalement
brute : capté sans interruption, cadrage fixe, vraiment juste une
communication filmée. Rien à voir avec les productions merveilleuses
qui sont devenues la norme sur YouTube, où des professionnels de la
musique jouent parfaitement filmés sous huit angles, avec des
incrustations d'images rigolotes, des écrans dans l'écran et un montage
extrêmement rythmé. Par ailleurs, dans les premiers épisodes, en
l'absence de matériel adéquat, la voix paraît captée de façon un peu
lointaine, il faut clairement pousser le potentiomètre par rapport aux
autres vidéos de la plate-forme. (Mais je passe quelques heures à
enregistrer ça, vous pouvez bien, si le contenu vous intéresse,
augmenter un peu le volume, ce n'est pas un drame. Simplement ça ne
s'adressera qu'à un petit contingent, aucun spectateur externe ne sera
attiré par la forme, clairement. Même si, croyez-le ou non, des non
mélomanes que je ne connais pas regardent et semble-t-il apprécient !
Leur intrépidité m'impressionne.)
Surtout, je pense que ce format, même sous sa forme rudimentaire
actuelle, conserve plusieurs atouts.
1) Il n'existait pas, à ma connaissance, de proposition vidéo un peu
précise et longue sur la
structure musicale de Pelléas.
Les ouvrages qui l'abordent le font, par une contrainte évidente de
place, de façon très ponctuelle et fragmentaire, en isolant quelques
exemples frappants pour illustrer leur propos : aucune étude sur toute
la longueur de l'œuvre, mesure après mesure, n'a été publiée, pour ce
que j'ai pu en voir. Par ailleurs, lorsque ces questions sont abordées,
c'est souvent de façon assez technique, sous-entendant une connaissance
préalable de la théorie musicale.
Mon projet était donc de proposer une approche aussi
exhaustive
que possible, qui commente l'intégralité de la partition et non
seulement des moments significatifs, afin de bien prendre la mesure de
la dimension structurante et de la récurrence des motifs ; et cela tout
en explicitant à chaque fois les événements dans un langage vulgarisé,
accessible même sans lire la musique. (C'est toujours un défi pour
l'harmonie, sujet autoréférentiel s'il en est, mais pas impossible en
expliquant la fonction « mécanique » ou expressive des couleurs et
attractions.)
J'ai ainsi tâché de tenir un double objectif qui, à mon sens, peut être
fécond : d'une part être aussi complet et minutieux que je le puis, en
relevant chaque occurrence que je peux rencontrer. Le format feuilleton
le permet bien, surtout que les titres et descriptions peuvent orienter
les curieux qui seraient intéressés par une parenté, un aspect en
particulier. D'autre part rendre la série accessible à tout mélomane
qui aurait simplement entendu l'œuvre,
sans connaissances préalables,
y compris solfégiques.
2) Le format vidéo permet
un déroulé très progressif et précis
de la pensée musicale : on peut reprendre plusieurs fois le même motif,
le faire tourner, le décomposer. Ce n'est pas infaisable du tout en
notule, mais la longueur extrême du découpage en fragments et de la
mise en forme limite mécaniquement l'explication, la reformulation.
Sous forme de notule, la série sur le
Freischütz aurait pris au
moins une centaine d'heures de travail (et je pense davantage), assez
fastidieuse de surcroît (planifier tous les extraits, les enregistrer,
faire de même avec les partitions à mettre en regard, tout organiser et
mettre en page...).
Le plus probable est que
j'y aurais finalement renoncé – près
d'un an après avoir conçu le projet, alors que j'avais relevé toutes
les références que je voulais mettre en évidence, je n'avais toujours
pas achevé la simple récolte d'extraits sonores, encore moins des
fragments de partitions, et rien de la rédaction. Dans le meilleur des
cas, vous auriez eu une notule de ce genre tous les deux ans, au lieu
d'avoir tout de suite, ici, deux séries ambitieuses intégralement
disponibles en l'espace de quelques mois.
3) Le fait de
jouer soi-même les extraits permet de ne pas
dépendre des prises de son (à l'orchestre, on n'entend pas toujours
bien les parties intermédiaires), de
posséder les droits des
extraits (la notule n'est pas dépendante d'une potentielle
réclamation), et surtout de pouvoir
détailler des éléments en
les isolant (telle mélodie cachée dans l'ensemble, comme le thème de la
forêt lointaine dans
Pelléas, souvent indiscernable
lorsqu'il se mêle à d'autres accords). Ce peut être utile pour rendre
accessible
l'explication harmonique, par exemple : si on ne le
sort pas de son contexte immédiat et touffu, seuls ceux qui savent déjà
pourront comprendre.
Par ailleurs, je trouve l'aspect « conversation autour d'un piano »
plus convivial qu'une simple « conférence », surtout avec ce format
rudimentaire en plan fixe. C'est un peu d'animation. (Et je trouve très
sympathique, comme pour la série
Musique en Ukraine, le côté artisanal de tout
faire : recherche, textes, exécution musicale, captation, montage.
L'impression de dorloter mon lectorat / spectatorat.)
B. Réception
Je suis impressionné de constater des
statistiques
confidentielles mais régulières, avec un petit noyau de passionnés qui
suivent tout. C'est plus que je n'en espérais – je comptais simplement
le déposer là, si jamais quelqu'un était intéressé, moi ça m'amuse à
produire et j'avais, pour
Pelléas, de toute façon prévu d'en
explorer la structure pour mon usage personnel avec ou sans notule ! –,
quelques dizaines pour chaque vidéo, et des retours, des commentaires
positifs, même quelques purulents qui attendent chaque nouvel épisode.
Et j'imagine que les statistiques gonfleront un peu au fil des mois,
puisque j'ai beaucoup publié (et peu annoncé) ; tout le monde ne peut
pas suivre le rythme, et tout le monde ne regardera pas tous les
épisodes.
J'ai aussi essayé, comme produit d'appel, les
shorts.
L'idée était de profiter de l'algorithme de YouTube (je ne me suis pas
épuisé à dupliquer sur d'autres plates-formes, l'objectif n'est pas de
faire
des vues, et j'imagine que ce sera plutôt regardé par une fraction
de ceux qui ont déjà l'habitude de lire le site) pour attirer quelques
curieux supplémentaires. Ce ne sont que des fragments d'une minute,
très faciles à produire (il suffit de sélectionner le passage dans la
vidéo d'origine et hop, le
short est créé), pas du tout montés,
donc pas réellement des raisonnements complets, juste des instantanés
(que je prends très peu de temps à sélectionner, donc un peu
arbitraires).
Quelle ne fut pas ma surprise en constatant les chiffres hallucinants
de leur visionnage : souvent plus de 1000 ou 1500, et même l'un d'eux
(pas spécialement le plus spectaculaire ou intéressant) à plus de 6000
spectateurs. Absurde.
J'imagine que l'algorithme refourgue ça aux gens qui regardent de la
musique pour piano, ça doit entrer dans une case où ils manquent
d'offre… Ça n'a d'ailleurs pas vraiment d'effet sur la chaîne (vues,
abonnements sur les autres vidéos), mais c'est assez déconcertant, un
peu comme les fausses musiques ou les chansons interprétées par des
avatars qui submergent les plates-formes de musique et de vidéo – je
doute que ça touche vraiment son public, même s'il y a en effet des
likes et des réactions positives
(que je ne m'explique pas trop).
En somme, il existe un public, même si moins vaste (pour ceux
réellement intéressés) que pour les notules, et cela me permet d'opérer
un travail de documentation parallèle à ce qui est fait à l'écrit sur
le site, avec un effort de production et une
chronophagicité
bien moindres. La possibilité de communiquer sans effort sur des sujets
que je tiens par-devers moi depuis des années, impressionné par
l'énergie nécessaire pour sa présentation et sa rédaction, rend même la
facilité de ce nouveau format un peu grisante !
C. Productions futures
À présent que la série
Freischütz est achevée, avec quoi faire
alterner la série
Pelléas ?
Pour situer : l'idée est plutôt de ne pas refaire des notules
existantes – moins stimulant pour moi, et vu que les vidéos font
beaucoup moins de lectures que les notules, pas sûr que ce soit une
contribution essentielle –, et de privilégier les sujets où la
plus-value de jouer des extraits en direct est la plus évidente. Donc
pas de commentaires discographiques, par exemple. (Pour ce format,
j'aimerais plutôt le faire avec des amis, ce pourrait être sympathique,
je pose ça là, n'hésitez pas à me signaler si vous êtes tentés, par
exemple les dernières trouvailles discographiques, nouveautés ou non,
ou conseiller des découvertes par thème…)
Je m'interroge.
¶
La suite des leitmotive ? Je ne voudrais pas faire que cela
sur la chaîne, mais il y a encore quelques beaux candidats. J'aurais
beaucoup aimé faire
Arabella de Richard Strauss, peut-être
l'exemple le plus vertigineux que je connaisse en
la matière ; mais je crains de tomber exactement dans un creux entre
deux formats : peu de monde connaît déjà suffisamment l'œuvre pour
disposer d'un public minimal, et ce n'est pas non plus une découverte
d'œuvre qui pourrait attirer un autre type de curieux.
Tosca de Puccini paraît un candidat plus
fructueux : tous les amateurs d'opéra le connaissent, et on l'écoute
rarement en soulignant cet angle (pourtant il y a là aussi
des motifs partout, même si les concaténations et
mutations y sont assez peu spectaculaires par rapport à nos précédents
exemples francogermaniques). C'est par ailleurs très agréable à jouer
et il y a de jolies choses à dire.
Dernière possibilité,
L'Aigle de Jean Nouguès, un inédit qui
n'a pas vocation dans une telle série à être joué en entier, mais dont
je pourrais détailler des extraits significatifs :
variations &
fugato sur la Chanson de l'Oignon, empilement de chants
révolutionnaires, consulaires & impériaux qui constituent,
retravaillés, l'essentiel de la matière musicale de l'opéra ! – La
Carmagnole, Ah ça ira, Nous n'irons plus au bois, Il était un petit
homme tout habillé de gris, Veillons au salut de l'Empire, Marche
consulaire de Marengo, Le Chant du Départ, La Marseillaise… J'en ai
déjà capté deux épisodes, je trouve cette musique vraiment incroyable ;
mais je ne suis pas certain que ce type de travail de détail sur un
inédit puisse réellement toucher son public. Je suis curieux des
retours, je publierai probablement ça avant la fin de la série
Freischütz,
afin de recueillir des retours et des statistiques. Dans ce même
esprit, il y a
La Glaneuse
de Félix Fourdrain, un
drame naturaliste particulièrement intense et inspiré, mais pour
profiter des motifs, il faudrait tout jouer, et on retomberait un peu
dans l'esprit des « déchiffrages filmés », dont il reste un peu
difficile de s'emparer, je trouve – j'adore faire ça, mais je ne pense
pas que ce soit ce qui apporte le plus aux visionneurs.
¶
Une autre grande série thématique ? Par exemple la suite de
la
série ukrainienne. (Mais ce sera davantage
enregistrer des pièces de musique avec du contexte et moins du
commentaire de détail.) J'ai quelques bijoux inédits de
Bortniansky
et d'
Akimenko
sous le coude, par exemple. Et je serais ravi de parler de
Mosolov,
Roslavets, Ornstein…
Ou bien une série sur
les chants
de la Révolution et leur usage musical, sans doute pas mal à
chercher et à montrer, et accessible à un vaste public ! À
étendre peut-être à l'exploration du
style révolutionnaire.
Problème : beaucoup d'œuvres ne sont pas aisément disponibles en
partition par mes réseaux habituels. Pourquoi pas sous forme assez
courte : je donne un peu de contexte sur le compositeur (et
éventuellement les enjeux de son attribution nationale), je joue une
pièce, je souligne quelques-unes de ses caractéristiques intéressantes.
¶ Des
inédits décortiqués, quelque chose d'équidistant entre
mes déchiffrages filmés et l'approche minutieuse de
Pelléas :
vraiment donner la becquée au public pour pouvoir s'approprier
une œuvre inconnue. C'est que j'ai été
bouleversé par
Le vieil Aigle de Raoul Gunsbourg à chaque lecture,
combinaison d'un livret simple mais bouleversant, et d'une musique
intelligente qui va droit au but et touche juste à chaque fois. Mais
idéalement, il me faudrait le concours, sinon de chanteurs, de
récitants. (Et bosser quelques passages périlleux, ça se lit à vue sans
effort et sans chausse-trappe la plupart du temps, mais il y a des
marines assez virtuoses à des moments critiques qu'on ne peut pas
affaiblir sans diminuer l'œuvre elle-même.)
Vercingétorix de Félix Fourdrain pourrait aussi intéresser
un public assez vaste, j'avais commencé à en diffuser le déchiffrage
avec des commentaires (1,2), parmi les premières vidéo de déchiffrage
de la chaîne. Et cela dépasse la musique (
leitmotive également,
couleurs harmoniques, etc.), puisque cela entre évidemment en résonance
avec nos interrogations actuelles sur les évolutions et l'usage du
roman
national.
Plus simple à réaliser, car plus court (et déjà un peu travaillé), une
version vidéo et commentée de la
Symphonie
de la Tour Eiffel d'Adolphe David, mon étrange
trouvaille d'il y a deux ans.
¶ Ou encore (et cela adviendra sûrement à un moment ou un autre),
des
épisodes isolés, sur des remarques précises. Là tout de suite, je
pense à des choses aussi disparates que des trouvailles dans des
inédits ou des détails d'architubes. D'une part,
représentation d'une troublante
justesse des viols de guerre à la fin de l'acte II d'Ivan le Terrible de Raoul
Gunsbourg – qui fut médecin de guerre du côté russe
contre les Turcs, et même un
contributeur actif à la victoire de Nikopol.
D'autre part, les détails qui répondent à
la question Pourquoi
Mozart est-il aussi génial ?,
les
mutation du motif pointé
initial dans le mouvement lent de la
Quatrième Symphonie de Beethoven
(avec un solo de timbale à peu près totalement inédit, je crois, hors
concertos et roulements),
l'usage
des modulations pour varier les éclairages et les émotions
dans Die Winterreise de Schubert…
Donc différents degrés de découverte un peu inédite ou au contraire de
vulgarisation.
Bien sûr, s'il y a des avis et des souhaits dans cette liste ou hors
liste, je prends note ! Vu le faible nombre de personnes concernées,
deux ou trois demandes convergentes peuvent valoir commande. Pour
l'heure, la principale suggestion convergente, de plusieurs regardeurs,
portait sur un
décorticage de Wozzeck de Berg sur le modèle de
Pelléas
– mais j'ai poliment décliné pour l'instant, cette musique m'affecte
tellement violemment que si je mets le nez dedans au quotidien, cela va
littéralement
ruiner ma vie.
D. Le contenu
Cette notule a été longue à paraître parce que je ne souhaitais pas me
contenter d'une autopromotion satisfaite, l'idée est tout de même de
fournir un peu de contenu informatif.
Par conséquent, à présent qu'on a réalisé le petit tour d'horizon du
principe (et des prochains thèmes), comme je ne voudrais pas avoir
l'air de dépouiller le site en renvoyant simplement aux contenus vidéo,
je vous propose ici une petite
table
des matières. Ainsi vous pourrez retrouver, même sans regarder
les vidéos, les contenus des investigations et les moments où chercher
dans la partition. (C'est tout de même plus facile en regardant,
évidemment.)
Dans les deux séries, ce sont des vidéos de 20 à 40 minutes : dans
l'idée d'être assez long pour pouvoir développer le propos, mais assez
bref pour rendre l'ingestion en une seule fois indolore.
Série Leitmotive de Pelléas
Publication :
Tous les samedis.
Présentation :
« Série consacrée à la structure en
leitmotive – très dense, davantage encore que dans le
Ring selon les scènes ! – de
Pelléas & Mélisande de Debussy.
»
Et cela va à l'encontre de ce que l'on entend le plus souvent sur
Debussy (coucou
Pierrot), peut-être pour avoir pris
trop au sérieux les propres déclarations du compositeur.
La
playlist leitmotive
pour retrouver toutes les vidéos.
Les
notules autour de l'œuvre – les dernières abordent
précisément
cette question.
Épisodes :
0. Le
pilote : 1h45 d'investigations motiviques dans le grand duo
de l'acte III de
Die
Walküre de Wagner.
1. « Allemonde ou la forêt lointaine ?
». Dans ce premier épisode, apparition d'un premier motif
(Allemonde ? la forêt ? les temps lointains et mystérieux
?). Opposition (stylistique, mais aussi modale) au motif de Golaud.
2. « Golaud et les destructions de la
gamme par tons ». Dans ce deuxième épisode, apparition du motif
de Golaud. Ses composantes. La gamme par tons et ses conséquences
destructrices pour la tonalité.
3. « Motifs attachés à Mélisande ».
Dans ce troisième épisode, apparition du motif principal de Mélisande.
Mais ce n'est pas du tout celui qui la caractérise le plus souvent dans
cette première scène ! Plutôt ceux attachés au désir de Golaud
pour elle et au rejet de Mélisande envers lui (ou au passé de Mélisande
?).
4. « Entrée de Golaud (chasse,
première superposition…) ». Dans ce quatrième épisode, le rideau
est levé et Golaud prononce sa première réplique ! On observe
comment les deux premiers
leitmotive
de l'opéra (la forêt lointaine & Golaud) vont déjà se superposer.
5. « Comment délimiter les motifs ? »
Dans ce cinquième épisode, on se pose la question de la limite entre un
élément identique au motif (intervalle mélodique, rythme) et la
volontaire référence à ce motif par Debussy. Pas toujours facile.
Moment : fin de la première tirade de Golaud.
6. « Motifs du désir, du rejet, de la
couronne… et premières fusions ! » Dans ce sixième épisode, on
découvre le motif du désir de Golaud, celui du rejet de Mélisande,
celui de la couronne… et on observe déjà des mutations impressionnantes
où leurs caractéristiques respectives se mêlent.
Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « J'entends pleurer » à « Y
a-t-il longtemps que vous avez fui ? ».
7. « Le "vrai" motif Allemonde et...
Tosca ! ». Dans ce septième épisode, on explore le figuralisme
de la couronne, les mutations du motif de Mélisande, et on parle un peu
de
Boris Godounov et de
Tosca.
Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « Qu'est-ce qui brille ainsi au
fond de l'eau » à « Si, si, je les ferme la nuit ».
8. « Boris Godounov (et syncopes,
accompagnements, fusions...) ». Dans ce huitième épisode, on
observe la suite des fusions des motifs et des naissances de
nouveaux... et l'on explore la fameuse parenté avec
Boris Godounov de Moussorgski.
(Tout en annonçant celle entre le motif initial de la forêt et un
extrait mineur des
Huguenots
de Meyerbeer.)
Moment : acte I, scène (tableau) 1. De « Pourquoi avez-vous l'air si
étonnée » à « Je n'en sais rien, je suis perdu aussi ».
9. « Rivalités de sopranes, procès,
duel, Huguenots, portraits de Mélisande ». Un neuvième épisode
assez dense : on regarde la citation (involontaire) des
Huguenots en examinant les
hypothèses de cette parenté, on rappelle la genèse de
Pelléas (le blanc-seing de
Maeterlinck et le procès perdu, la compétition entre les sopranos
Germaine Leblanc et Mary Garden, la question de la diction, la
provocation en duel, l'assassinat de la chatte de Maeterlinck…), et on
se pose aussi la question des interprétations possibles du personnage
de Mélisande (fillette, victime, coquette, vouivre ?). Tout en
poursuivant notre avancée chronologique sur les motifs.
Moment : acte I scène 1 « La nuit sera très noire et très froide »,
puis début de l'interlude entre les scènes 1 & 2.
10. « Sommeil de Brünnhilde et
hallucinations de Boris Godounov ». Dans ce dixième épisode, on
regarde la version longue du premier interlude, et on observe les
réminiscences de fragments du sommeil de Brünnhilde et des
hallucinations de Boris Godounov.
Moment : acte I, interlude entre les scènes 1 & 2.
11. « Apparition de Parsifal ». Ce
onzième épisode est l'occasion d'explorer de près la fameuse référence
à la marche qui ouvre et innerve la première
musique de transformation de
Parsifal : contrairement à ce que
suggèrent beaucoup de résumés de cette affaire, cette cellule est déjà
présente dans la version courte de l'interlude entre les deux premières
scènes de
Pelléas !
Mais elle est plus développée, et encore plus proche, dans sa version
longue, ce qui explique les remarques soulignant qu'un Debussy pressé
écrit du Wagner – rappelez-vous, Albert Carré, directeur de
l'Opéra-Comique, commande l'allongement des interludes, trop brefs pour
la machinerie de scène, mais seulement au moment les répétitions,
quelques semaines avant la première (et Debussy lui répond en substance
qu'il ne peut pas écrit de musique au kilomètre). C'est pourquoi on
retrouve dans les (incroyables) interludes longs beaucoup de matière
issue des différentes scènes de l'opéra, parfois sans lien direct avec
les scènes entre lesquelles elle se trouve (il faut y prendre garde
lorsqu'on feut faire l'exégèse du sens des motifs !
Comparaison des deux interludes en fin d'épisode.
Moment : interlude long (version définitive après répétitions de 1902)
et interlude court (version d'origine avant répétitions) entre les
scènes 1 & 2.
12. « La lettre & la généalogie ».
Ce douzième épisode tourne autour de la lecture de la lettre par
Geneviève. On met le doigt sur un motif qui pourrait lui être lié (et
manifestement parent du motif du « monde lointain » qui ouvre l'opéra),
on réentend quelques suggestions évoquant la forêt du début ou
Mélisande ; mais domine surtout la sobriété, qui accentue cette
impression de hiératisme propre à ce Moyen Âge de fantaisie.
On pose aussi la question de la généalogie. Geneviève est-elle la mère
de Golaud & Pelléas ? Est-elle la fille d'Arkel ou issue de
l'alliance avec une famille extérieure ?
Moment : I,2. Lecture de la lettre.
13. « Arkel, la guerre, le réel, Dieu,
les neumes ». (Parution le samedi 5 juillet.) Ce treizième
épisode explore la tirade d'Arkel :
a) Écriture qui évoque le plain-chant à
faux-bourdon. Je raconte à cette occasion l'histoire incroyable de la
redécouverte des neumes grégoriens par Félix Danjou, et l'engouement
qui s'ensuivit, ainsi que les rivalités dans les églises. Cf.
cette notule.
b) Éléments de réalité (ici, la guerre) qui affleurent dans l'univers
éthéré de
Pelléas. Cf.
cette notule.
3) La place de Dieu dans
Pelléas.
Cf.
cette notule.
Moment : I,2. Tirade d'Arkel entre la lettre et la première entrée de
Pelléas.
14. « Pelléas-personnage, la jalousie,
le danger ». (Parution le samedi 12 juillet.) Ce quatorzième
épisode dévoile plusieurs motifs importants :
a) celui, peu marquant de prime abord,
attaché à Pelléas, qui pourra par moment fusionner avec d'autres
(Mélisande, évidemment !) ;
b) celui lié à la jalousie et aux tentations de violence de Golaud (ces
octaves ascendantes) ;
c) une couleur spécifique liée au danger (au destin ?) en plusieurs
endroits.
Moment : I,2. Entrée de Pelléas.
15. « Interlude n°2 (long et court),
harmonie parsifalienne, retour du désir ». (Parution le samedi
19 juillet.) Ce quinzième épisode explore la version courte et la
version longue du deuxième interlude de Pelléas, avec notamment :
a) nouvelles réminiscences
parsifaliennes (harmoniques notamment) ;
b) retour du motif du désir, intégré et retravaillé.
Moment : interlude entre les scènes I,2 (la lettre) et I,3 (le navire).
16. « Sombre ou clair ? ».
(Parution le samedi 26 juillet.) Ce seizième épisode se concentre sur
le contraste obscurité / lumière, et la nature de motifs
d'accompagnement, qui s'oppose à la réutilisation de motifs récurrents
:
a) formule simple et répétitive pendant
l'évocation des jardins « où ne pénètre jamais le soleil » ;
b) motif de Pelléas qui intervient au moment où il est question de la
clarté, avant même que le bruit de ses pas ne soit évoqué ;
c) poussée harmonique et illumination d'accords « purs » de trois sons
(procédé pour figurer la lumière ?).
Moment : début de la scène I,3, « Devant le château ».
17. « Les marins : Golaud ou la mer ?
». (Parution le samedi 2 août.) Ce dix-septième épisode
s'esbaudit de l'ambiguïté, dans toute la scène du navire qui sort du
port, du motif de Golaud – qui paraît aussi un motif de la mer :
a) omniprésence du motif de Golaud ;
désigne-t-il Golaud qui a conduit Mélisande en bateau depuis le pays
lointain de la première scène ? le voyage (pour cette même
raison) ? le danger en général (la mer déchaînée d'une part, la
colère de Golaud d'autre part, puisqu'on sait que Mélisande a aimé
Pelléas au premier regard) ? ou faut-il, comme certains érudits,
le considérer comme un motif à plusieurs sens, pouvant aussi bien
désigner Golaud que la mer (je ne suis pas convaincu, mais des gens
sérieux l'ont écrit) ;
b) contraste de formules ténébreuses (« il y a encore une brume sur la
mer »), avec ces accords dans le grave prodigues en quintes directes,
et des motifs lumineux (« le navire est dans la lumière », avec ses
triolets pépiants), qui ne constituent pas nécessairement des motifs
récurrents (à surveiller pour la suite) ;
3) superposition du choeur des martins, des motifs de Mélisande, de
Golaud, et de la formule d'accompagnement du début de la scène, tout
cela simultanément avec des répliques de personnages.
Moment : scène I,3, "Devant le
château", observation du port et choeur des marins hors-scène.
18. « II,1 : motifs aquatiques,
Pelléas qui affleure, Fiodor Godunov... ». (Parution le samedi
9 août.) Ce dix-huitième épisode suit l'apparition des premiers motifs
de l'acte II :
a) Pelléas, qui ouvre la scène à la
flûte solo et glisse ensuite en plusieurs instances ;
b) liquidités aquatiques sur plusieurs motifs (pas nécessairement
récurrents) ;
c) les accords d'Allemonde / d'Arkel / du destin, pour la « fontaine
miraculeuse » ;
d) le motif de l'eau silencieuse, avec ses acciaccatures, qui impose à
chaque fois une rupture harmonique très soudaine ;
e) une parenté étonnante entre le motif liquide de l'eau (les petites
volutes descendantes) et la scène où Fiodor, fils de Boris Godounov,
étudie la géographique (chez Moussorgski, donc).
Moment : scène II,1 « Une fontaine dans le parc », début.
19. « L'arbitraire de l'harmonie
coloriste, dialogues avec Ernest Guiraud ». (Parution le samedi
16 août.) Ce dix-neuvième épisode poursuit l'exploration du matériau du
premier tableau de l'acte II. On s'y attarde, autour du motif de l'eau
étale et silencieuse, sur le caractère coloriste plutôt que fonctionnel
d'une partie des enchaînements d'accords chez Debussy. (À travers
notamment ses conversations avec son maître Ernest Guiraud, le
compositeur des récitatifs de Carmen et des Contes d'Hoffmann,
dépositaire d'un langage plutôt conservateur – telles que notées par
Maurice Emmanuel, camarade et ami de Debussy.)
Moment : II,1 (suite).
20. « Souvenir de la rencontre,
l'anneau & les symboles ». (Parution le samedi 23 août.)
Ce vingtième épisode aborde la conversation sur la rencontre de
Mélisande avec son futur mari, sur un soubassement obstiné de fragments
du motif-de-Golaud. On y rencontre le motif de l'anneau, on se pose la
question sur son importance symbolique, encore plus évidente dans le
tableau suivant, où Golaud semble comprendre que, dans un drame
symboliste, l'objet a autant de valeur que la chose même – et que
perdre l'anneau, c'est perdre le lien, perdre son empire sur sa femme. [Un
forum entier est dédié à cette question.]
On s'intéresse aussi aux motifs aquatiques, pas forcément transversaux
dans l'opéra (donc pas toujours des
leitmotive),
qui parcourent toute la scène.
Moment : II,1. Le souvenir de la rencontre avec Golaud et la perte de
l'anneau.
Vous pouvez aussi aller lire les
notules autour de l'œuvre – les dernières abordent
précisément
cette question.
Je dois enregistrer demain les épisodes 21 (comparaison des interludes
entre II,1 et II,2, la version longue est vraiment plus généreuse et
étrange) et 22 (début de II,2, la blessure de Golaud). L'aventure se
poursuit !
--
Série Fortune du Freischütz
Publication :
Tous les mercredis.
Présentation :
« Le principe de cette série ? Explorer les influences
considérables
de la scène de la Gorge du Loup sur les compositeurs du XIXe siècle –
jusqu'à la fin du siècle et même jusqu'en Russie ! »
La série est désormais achevée, 16 épisodes qui seront diffusés jusqu'à
mi-septembre ; vous pouvez en retrouver la
playlist ici.
En jouant une poignée de fois, pour mon édification personnelle,
la scène de la Gorge du Loup – il y
a un an environ – j'ai été frappé par le nombre de
correspondances qui s'imposaient
dans mon esprit : Mendelssohn, Marschner et Wagner, en bonne logique,
mais aussi Schubert, Meyerbeer, Halévy, Berlioz et même Tchaïkovski
! C'est ainsi que m'est venu l'envie de faire remarquer la
densité de cette scène en matériau, à peu près inédit à l'époque de la
création, qui est ensuite devenu le langage commun à toute l'Europe
symphonique !
L'autocitation, aussi, à ce
degré, c'est peut-être une première ; et cela ouvre la voie ensuite aux
versions altérées de ce genre de répétitions – les
leitmotive. Les plus frappants
éléments précurseurs que je connaisse autrement se trouvent dans les
Huguenots, très ponctuellement (et
15 ans plus tard !).
Épisodes :
1. «
Trémolos, orchestration, chromatismes ». Dans ce premier
épisode :
→ La clausule joyeuse (mais plagale) du
tableau précédent.
→ Explication de la question du référentiel musical (« la tonalité pour
les nuls »).
→ L'usage dramatique du trémolo depuis Gluck.
→ Différences pratiques et esthétiques entre le trémolo de cordes et
celui au piano.
→ Les choix d'orchestration. L'histoire du trombone dans l'orchestre
classique (à l'Opéra).
→ Le principe du chromatisme.
Moment : fin du premier tableau de l'acte II et début de la Gorge du
Loup.
2. « Les portails de téléportation (ou quintes diminuées) ». Dans
ce deuxième épisode :
→ L'usage (préexistant mais très
développé dans le Freischütz) des accords de quinte diminuée. Je tâche
d'expliquer, sans avoir besoin de préalables solfégiques particuliers,
ce que cette astuce permet : couleur sombre, effet de tension,
téléportation possible dans beaucoup d'autres référentiels…
→ Les cris de chanteurs hors scène, avec rappel de l'histoire du chant
choral hors scène et de la transgression, ici spectaculaire, des
tessitures.
→ Dichotomie majeur / mineur.
Moment : Chœur hors scène qui parle du lait, de la lune et du sang sur
la toile d'araignée.
3. « Fantastique, paternités musicales & autres contraintes, opéra
allemand ». Ce troisième épisode pose quelques grandes
questions générales sur la musique :
→ Le fantastique à l'opéra. Influence
du Freischütz en Europe. (De
façon générale et très peu érudite.)
→ Comment déterminer la paternité musicale d'une invention sonore
? Les précautions à prendre.
→ Contraintes intrinsèques de la grammaire musicale : faute de référent
concret (la musique ne décrit rien), les possibilités de rupture sont
limitées sans perdre totalement le lien avec les émotions du public.
→ Rapide rappel de l'histoire de l'opéra allemand.
Moment : Chœur hors scène qui parle du lait de la lune et du sang sur
la toile d'araignée. (Je joue très peu de musique dans cet épisode.)
4. « Influences sur La Walkyrie & Dalibor (Smetana), le mélodrame musical ».
Dans ce quatrième épisode :
→ Le mélodrame à l'opéra : dispositif
musical de type voix parlée + accompagnement musical. Ses contraintes.
(Où je parle même du Théâtre de l'Odéon…)
→ Chœur de spectres qui sert de matrice au chœur du public au procès de
Dalibor, chez Smetana.
→ Accords de tension et ponctuations de timbales dont procèdent
manifestement l'Annonce de la mort (
Todverkündigung)
dans
Die Walküre de
l'horrible Richard Wagner.
Moment : Chœur hors scène qui parle du lait de la lune et du sang sur
la toile d'araignée. Invocation de Samiel (le chasseur maudit et
démoneau local) par le méchant Kaspar. Apparition de Samiel.
5. « Matrice de La Juive, de Don Carlos ; refontes de Castil-Blaze, Berlioz… ». Dans
ce cinquième épisode :
→ Le motif de l'invocation de Samiel
par Kaspar se retrouve comme intermède de l'air le plus célèbre de La Juive d'Halévy (14 ans plus
tard).
→ Apparition d'accompagnement / transition en accélération, comme on en
trouve dans « Toi qui sus le néant » / « Tu che le vanità » de Don Carlos de Verdi.
→ Succès européen du Freischütz, et notamment les adaptations
françaises – le Robin des Bois de Castil-Blaze, la version avec
récitatifs de Berlioz, ou encore Durdilly, le pote de Gounod.
Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur
Terre.
6. « Arabella de Richard Strauss ». Dans ce
sixième épisode :
→ Une étonnante concordance, dans
l'évolution de l'idée musicale réutilisée dans La Juive d'Halévy (épisode 5), avec
le leitmotiv le plus central dans Arabella
de Richard Strauss.
Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur
Terre.
7. « Robert le Diable de Meyerbeer ». (Parution
programmée le mercredi 9 juillet.) Dans ce septième épisode :
→ La matrice de l'air « Nonnes qui
reposez sous cette froide pierre» avant le ballet fantastique des
nonnes damnées à l'acte III de Robert
le Diable de Meyerbeer.
→ Les leitmotive, dont l'embryon apparaît chez Weber puis Meyerbeer.
Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur
Terre.
8. « Autocitation, Mozart,
Mendelssohn, Berlioz, Tchaïkovski ». (Parution programmée le
mercredi 16 juillet.) Dans ce huitième épisode, pléthore de parentés en
à peine quelques mesures :
→ réminiscences de Don Giovanni de Mozart ;
→ source de l'orchestration des bois chez Mendelssohn (A Midsummer Night's Dream) et
Tchaïkovski (Roméo & Juliette)
;
→ source de l'imaginaire de la cavalcade dans La Damnation de Faust de Berlioz ;
→ à nouveau Meyerbeer ;
→ autocitation et naissance du leitmotiv.
Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur
Terre.
9. « Le Vampire & le Hollandais
volant ». (Parution programmée le mercredi 23 juillet.) Dans ce
neuvième épisode :
→ modèle du mélodrame au premier acte
de Der Vampyr de Marschner ;
→ source de plusieurs effets utilisés dans Der fliegende Holländer de Wagner
;
→ usage du cor.
Moment : Kaspar invoque Samiel et renégocie la durée de son séjour sur
Terre.
10. « Autocitations & Vaisseau
fantôme ». (Parution programmée le mercredi 30 juillet.) Dans ce
dixième épisode :
→ autocitation du motif de la dérision de Kaspar et de celui de la
scène de dérision du village qui ouvre l'opéra ;
→ trémolos et harmonies comparables à Der fliegende Holländer de
Wagner.
Moment : Max arrive en haut de la cascade qui domine la Gorge du Loup,
et hésite à rejoindre Kaspar.
11. « Auf dem Wasser zu singen (!)
& autocitations ». (Parution programmée le mercredi 6 août.)
Dans ce onzième épisode :
→ parenté avec le lied superstar de
Schubert ;
→ autocitation de l'air de Max ;
→ effets de circulation du matériau thématique dans l'Ouverture.
Moment : Max voit une image d'Agathe prête à se jeter dans la cascade,
et se décide à descendre dans la Gorge.
12. « Oiseaux de nuit berlioziens
& chromatisme huguenot ». (Parution programmée le mercredi
13 août.) Dans ce douzième épisode :
→ chromatisme dramatique simple, avec
l'exemple du grand duo du IV des Huguenots de Meyerbeer (« JE T'AIME
») ;
→ retour du motif de Samiel (parent du Destin et de l'Annonce de la
mort dans La Walkyrie de
Wagner) ;
→ disposition d'accords, rythmes et orchestration de l'évocation des
oiseaux de nuits, très similaire à celle de Berlioz dans sa Course à
l'Abîme de la Damnation de Faust.
Moment : fonte des première et deuxième balles.
13. « La jeune Fille & la
Mort, le Winterreise et… Armide de LULLY ». (Parution programmée le
mercredi 20 août.) Dans ce treizième épisode :
→ à nouveau, parentés frappantes avec
Schubert (avec quelques années d'avance de Weber, et donc
potentiellement d'influence) : la variation-climax du thème &
variations du Quatuor n°14 de Schubert (sur le second thème du lied Der Tod und das Mädchen), mais
aussi le Winterreise (en
particulier « Die Post », et potentiellement « Erstarrung ») ;
→ un clin d'œil à la Passacaille d'Armide
de LULLY.
Moment : Fonte des troisième, quatrième et cinquième balles.
14. « Sources littéraires &
création "dans le noir" ». (Parution programmée le mercredi 27
août.) Dans ce quatorzième épisode :
→ sources littéraires du livret de
Friedrich Kind (Gespensterbuch &
Hoffmann) ;
→ état initial du livret (duo liminaire entre Agathe et l'Ermite) ;
→ vedettes présentes dans la salle (Heine, Hoffmann, Mendelssohn !) ;
→ évolution de la commande (de Dresde à Berlin) et opinion de Weber.
15. « Chasseurs damnés, Vaisseau
fantôme, références déformées de l'Ouverture ». (Parution
programmée le mercredi 3 septembre.) Dans ce quinzième épisode :
→ motif des chasseurs damnés,
inspiration manifeste de celui des marins spectraux du Vaisseau fantôme ; → autoréférences
(altérées) avec l'air de Max et l'Ouverture. Exploration des
différences.
Moment : Fonte de la septième balle et début de l'orage final.
16. « Orage final : follets Nonnes
damnées, feu de Wotan, cabalette Vampyr ». (Parution programmée
le 10ercredi 3 septembre.) Dans ce seizième (et dernier) épisode :
→ l'orage final, finalement très
original et peu copié (les parentés sont plus diffuses que
précédemment) ;
→ feux follets du début du ballet des Nonnes damnées dans Robert le Diable de Meyerbeer ;
→ apparitions de Loge & enchantement du feu de Wotan pour le
sommeil de Brünnhilde ;
→ cabalette d'Aubry dans Der Vampyr de
Marschner ;
→ conclusion générale sur l'impact de cette scène dans l'imaginaire
musical européen.
Moment : Orage final. Fin de la série.
--
« Série
révolutionnaire » : usage de chants révolutionnaires, consulaires &
impériaux comme leitmotive
Parmi toute la liste des sujets possibles, j'avais très envie de
proposer au moins des fragments (je doute que davantage que quelques
épisodes puisse trouver un public de plus de deux personnes) de
L'Aigle de Jean Nouguès, un opéra
à la gloire de Napoléon, avec un livret lourdement hagiographique, mais
une musique d'un esprit incroyable : l'essentiel de la matière musicale
repose sur l'usage, la concaténation, la superposition, la mutation de
chants traditionnels ou patriotiques. Ah ça ira, La Carmagnole, Le
Chant du Départ, La Marseillaise, Marche consulaire de Marengo,
Veillons au salut de l'empire, Nous n'irons plus au bois, Il était un
petit homme tout habillé de
gris… Et bien sûr, au sommet, cet interlude orchestral en forme de
variations sur
J'aime l'oignon frit
à l'huile !
Épisode 1 – l'interlude de l'Oignon,
avant le tableau de Marengo.
Épisode 2 – début de l'opéra et
premières superpositions (quelquefois la seconde moitié du chant
se superpose sur lui-même !).
Pour l'instant, deux épisodes captés, que je diffuserai sans doute très
prochainement, afin de disposer d'un premier retour en commentaires ou
en statistiques et de décider de la prochaine série au long cours.
Tiennent la corde pour l'instant : les
leitmotive de
Tosca, l'usage des chants
révolutionnaires, la série ukrainienne. Mais qui sait ?
--
À bientôt pour de nouvelles aventures (écrites) !














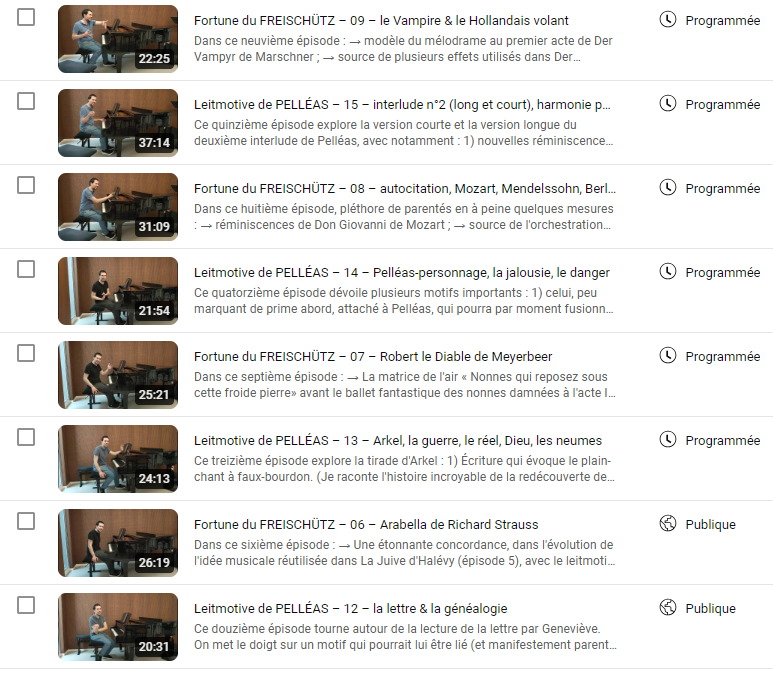






























































 Christie
Christie