André MARKOWICZ, 23 novembre 2006
Par DavidLeMarrec, vendredi 24 novembre 2006 à :: Littérature :: #445 :: rss
Assisté ce jeudi à la "table ronde" présidée par André Markowicz autour de la "lecture engagée que constitue la traduction".
L'occasion pour moi de recommander chaleureusement son travail.
1. La conférence.
La communication en question ne se voulait pas une démontration universitaire, mais plutôt un témoignage. Pas de thèse particulière, mais des considérations sur la traduction, sur sa pratique, sur ce qu'elle implique, met en jeu et, surtout, sur l'impérieux sens du détail.
André Markowicz, de langue maternelle russe, et est connu, par ici, pour avoir traduit en français tout le théâtre de Tchekov (en collaboration avec Françoise Morvan), tout Dostoïevski, tout le théâtre de Gogol, et à présent, entreprendre tout Shakespeare - sans compter l'incontournable Onéguine de Pouchkine. A ce qu'il en dit, il dispose de cinq ou six versions alternatives pour chaque intégrale, dont certaines publiées en doublon.
L'approche, dépourvue de plan, se faisait par digressions qu'il ne clôturait jamais, et s'achevait abruptement, sans conclusion ni retour sur les considérations antérieures. Un témoignage, simple, concret, vraiment pas une démonstration à thèse.
Mais un témoignage absolument confondant. D'abord par un vrai sens de conteur ; ensuite par un propos absolument passionnant.
2. Quelques axes du propos
Des choses tout à fait essentielles ont été abordées. Elles n'ont rien d'extraordinaire en soi, mais les réponses qui leur sont données par André Markowicz - et surtout leur manifestation concrète dans son travail - laissent plus qu'admiratif.
Quelques problèmes fondamentaux. Qu'est-ce qu'une traduction, quelle est sa visée ? Prenons un texte versifié, par exemple une pièce de Shakespeare.
Il n'est pas possible de la traduire en prose, on en perdrait toute la musicalité qui en fait la valeur. [Ces traductions, pour la plupart, sont en effet d'un commun terrible et ne conservent plus que la trame charmante des comédies. Toute la qualité de la langue disparaît.]
Il n'est pas possible de conserver le mètre original, le pentamètre iambique ici. Cette forme ne signifie rien aux oreilles françaises ! [En outre, je la crois assez difficile à mettre en place avec l'accentuation fixe française.] Aucun lien culturel ne peut être établi avec une telle forme pour les lecteurs.
Il n'est pas possible de le traduire en alexandrins, car le pentamètre iambique a été choisi par Shakespeare dans un esprit opposé à celui de l'alexandrin. C'est un vers heurté [souvent irrégulier chez lui, qui plus est], violent, découpé, tout le contraire d'un ronronnement à douze syllabes.
Il faut[1] donc versifier lorsqu'il y a versification sous peine de tomber dans la platitude, ne pas adopter le mètre original s'il n'a aucune signification dans la langue d'arrivée, et pour finir ne pas employer le mètre attendu dans la langue d'arrivée s'il n'est pas conforme à l'esprit du mètre original.
Le point fondamental est 'bien entendu' qu'il faut rendre au lecteur non pas un résultat le plus proche possible (André Markowicz récuse la notion morale de fidélité), non pas le plus beau possible, mais produire le même effet sur le lecteur que le texte original. Immense tâche, que, le plus souvent, il accomplit sans la moindre contorsion du sens...
La conférence prend toute sa valeur dans les exemples très précis qui émaillent son discours, sur le détail de la langue des auteurs et de la technique de rendu.
- Les mille façons de demander le sel à sa mère, en russe.
- La solution pour exprimer dans la phrase "le train est arrivé" l'attente du locuteur. Elle s'exprime par l'antéposition du train, en russe, mais en français. Avec la solution, en définitive "il est arrivé, ce train", qui présente tout de même une nuance familière à l'écrire absente du russe, mais qui offre une vraie porte de sortie. Et ce type d'interrogations sur chaque phrase.
- Les grandes démonstrations sur les vers de Shakespeare : le seul vers faux de Hamlet, les très nombreux vers faux (pentamètres à six accents) d' Othello, la signification du décalage, depuis le microscopique, dans la langue, entre Hamlet et Macbeth - qu'il interprète comme un Hamlet à front renversé, où le Verbe, au lieu d'être incarné au théâtre dans le théâtre comme la parole divine, trompe sans cesse[2].
On parvient à l'issue de cette conférence avec l'impression que ce propos improvisé aurait aussi bien pu être tout autre, mais on le pressent tout aussi passionnant.
3. Lectures recommandées
Notes
[1] André Markowicz a bien insisté sur le fait qu'il apporte un fonctionnement personnel et ne prétend en aucun cas le conseiller et encore moins l'imposer.
[2] On pourrait bien sûr en discuter à l'envi, puisque la parole est justement ce qui abuse Hamlet dans les propos choisis du spectre et saisit Claudius à tort ou à raison ; mais les raisons avancées sont étayées et fortes, et constituent une voie de lecture cohérente en elle-même.
J'ai jusqu'à présent fréquenté ses Dostoïevski avec beaucoup de satisfaction, mais ne m'étant jamais essayé au texte original, eu égard à mon russe, j'aurais du mal à attester de la réussite profonde de l'affaire. La série est unanimement fêtée, et échappe il est vrai à toute tentation de rationnaliser ou de romantiser le propos : une chose est sûre, la personnalité de l'écriture demeure durablement impressionnante.


En revanche, pour Eugène Onéguine, la réussite est incontestable - c'est par là qu'il faut commencer, si on doute de la légitimité de mon enthousiasme. Au prix de quelques modifications très minimes (en élargissant ou en précisant légèrement tel ou tel terme, mais rigoureusement exact sur le plan du sens), c'est une langue terriblement chantante, une oeuvre française qu'on lit avec émerveillement, une oeuvre qu'on se prend à lire à voix haute, pour ainsi dire à chanter.
Il existe des traductions plus proches, mais infiniment plus plates, voire absconses. Je me souviens que la traduction de Jean-Louis Backès, malgré tout mon entrain, m'était tombée des mains - opaque, terne, obscure, sans élan. Ici, la langue se déroule irrésistiblement, débordant de parfums, qu'on se prend à dévorer et à savourer tour à tour. Les octosyllabes, 'prompts comme la pensée', rebondissent joyeusement en épousant le mètre court de Pouchkine.
Cette traduction est tout bonnement un chef-d'oeuvre de la littérature française, en plus de constituer la plus satisfaisante version disponible du roman de Pouchkine.
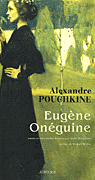
Je vous invite à lire le compte-rendu dithyrambique du Temps[1], ainsi que les premières pages de l'oeuvre.
Et à présent, Shakespeare, qui m'a servi d'exemple au début de cette notule. Comment résoudre le problème ? André Markowicz choisit le décasyllabe, non pas pour imiter la durée du pentamètre, mais pour tirer quelque chose de l'irrégularité de ce vers français - qui tout en étant bien connu, refuse la symétrie de l'alexandrin. Je vous laisse le loisir de méditer à la difficulté d'écrire une traduction versifiée et fidèle, dans un vers de même longueur (voire plus court) que l'original.
Et pourtant, le résultat n'est peut-être pas aussi beau que du Shakespeare (qui reste diablement fortiche), mais il est tout de même fichtrement beau, un grand cadeau pour les francophones.
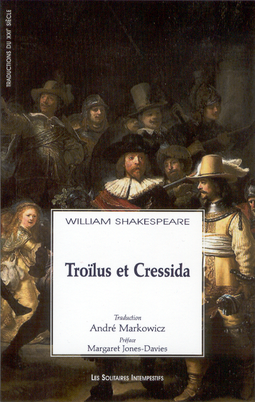
Pour finir, ses publications chez Babel (les plus nombreuses) sont à prix très avantageux eu égard au soin infini de la traduction.
Ce bout d'après-midi était véritablement une très grande aventure - l'une de ces rares fois où l'on a le sentiment de se trouver face à face avec la littérature, en train de discuter du détail du texte, de ses irrégularités, de ce que tout cela implique à l'échelle de l'oeuvre ou de l'auteur. En effet, qui peut connaître plus pleinement ces textes qu'un tel traducteur, qui semble habité de chaque phrase plusieurs fois remise en mots, pleinement conscient des implications de chaque choix sur le sens profond de l'objet qu'il sert ou dessert ?
Une aventure disponible à prix modique pour les absents, donc.
Et sur France Culture, cet entretien. Des choses fondamentales y sont dites, une grande leçon.
P.S. : Aujourd'hui, en revanche, entendu une démonstration sur le caractère misogyne de la Flûte Enchantée, censément une lecture inédite. Je suis sceptique sur le statut de découverte ultime de la chose, plutôt explicite - et qui mériterait d'être creusé de façon plus fine et non militante. Je pense par exemple à la question corollaire qui ne peut manquer de surgir : en quoi la représentation négative de la féminité y est-elle aussi une stylisation volontairement naïve du mal ? Mais le public qui majoritairement ne connaissait pas l'oeuvre s'est montré ravi, ce qui est déjà une victoire.
Par ailleurs, je pense moi aussi que le livret de la Flûte ne casse pas des briques, alors je m'abstiendrai de batailler.
J'ai aussi noté un petit trait amusant qui me laisse penser que la conférencière ne fréquentait que de façon discontinue l'opéra seria : le traitement colorature de la Reine de la Nuit serait subversif... La marque d'une enchanteresse (Armida dans Rinaldo) ou d'une souveraine impérieuse (Semele dans l' Europa Riconosciuta de Salieri), c'est possible - la folie étant déjà potentiellement une relecture romantique -, mais la subversion, vu la banalité de ce type de profil vocal, j'ai du mal à y croire. Il faut bien préciser, par honnêteté envers l'intervenant, que l'aspect musical a délibérément été laissé à l'écart, et je me suis bien entendu abstenu, venu le moment des questions, de toute remarque perfide et déplacée à ce sujet.
Notes
[1] Le _Temps_ écrit étrangement son patronyme comme un nom russe translitéré, alors que le polonais s'écrit déjà en alphabet latin. Je maintiens donc que, pour trouver ses oeuvres, l'orthographe 'Markowicz' est la bonne.
Commentaires
1. Le mercredi 5 mars 2008 à , par emmanuel :: site
2. Le mercredi 5 mars 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
Ajouter un commentaire