Non seulement Beethoven était sourd, mais en plus son métronome déraillait, et par-dessus le marché personne n'avait compris comment il fallait compter les temps
Par DavidLeMarrec, dimanche 16 août 2009 à :: Domaine symphonique :: #1332 :: rss
Voilà longtemps que j'entendais parler du travail de Maximianno Cobra, jeune chef franco-brésilien devenu célèbre pour avoir dirigé une intégrale des symphonies de Beethoven deux fois plus lente que la moyenne, et en s'appuyant sur des données musicologiques.
On peut en voir des vidéos en ligne, vidéos promotionnelles envoyées par le site qui est son bras commercial. Une occasion de faire le point, ou de découvrir...
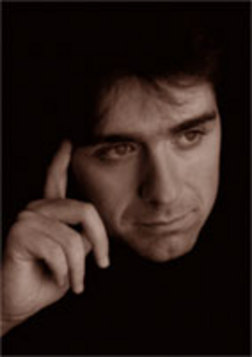
1. Les principes - 2. Vidéos - 3. L'avis des lutins (obtiendra-t-il le lutrin de noyer ?)
--
1. Les principes
Maximianno Cobra est parti d'une réflexion en profondeur sur la notion de tempi, une réflexion qui suscite l'attention, parce qu'elle entre largement en résonance avec ce que l'histoire de l'interprétation a prouvé à mainte reprise au cours du vingtième siècle.
Pour lui, il ne s'agit pas de reproduire, en interprétant, le même standard à l'infini. Chaque chef dira cela, bien entendu, mais on a vu comment la redécouverte de l'inégalité des notes écrites égales dans le baroque français ou les modifications d'instrumentarium, de modes de jeu, de tempo, voire de psychologie de l'exécution (répertoire moins vaste, improvisation...) ont pu changer radicalement la nature même de certaines musiques, littéralement révélées, en particulier dans le cadre du mouvement baroqueux (disons, dans la période de redécouverte massive, de 1969 à 1987).
Notre jeune chef s'attache en particulier à la notion de tempi, autour du métronome "de Maelzel" [1] auquel Beethoven avait fini par vouer un culte. Même en laissant de côté les aspects de l'irrégularité célèbre dudit métronome, il soulève plusieurs difficultés intéressantes. En particulier la relativité nécessaire de la notion de tempo : non seulement par rapport au caractère du morceau, mais aussi par rapport à la manière de décompter.
--
1) Pour ce qui est du caractère du morceau, c'est connu, et c'est bien pour cela qu'on n'indique pas toujours de valeur fixe en tête d'un mouvement. Et plus encore, alors qu'il n'est pas concevable de changer une note, une harmonie, un rythme [2], il est tout à fait loisible (et même recommandé), pour asseoir une interprétation, de modifier ces indications (dans une mesure raisonnable) pour concorder avec la vision que l'on a du morceau, et ainsi varier les plaisirs.
2) On sait par ailleurs que les indications de tempo de Beethoven sont dans certains cas, et malgré l'amélioration vertigineuse du niveau des orchestres, toujours injouables. On a parlé de surdité, du métronome détraqué de Winkel-Maelzel, mais l'affaire est tout simplement rendue crédible par le caractère visionnaire et intransigeant de ce compositeur en particulier : peut-on imaginer que sa Grande Fugue était correctement exécutable à son époque, et par des amateurs éclairés ? Clairement, il écrivait dans l'absolu, pour plus tard peut-être, voire pour jamais. De ce fait, on pouvait fort bien s'expliquer ces indications impossibles. [Et c'est ainsi que je me les explique toujours, au demeurant.]
3) En ce qui concerne le décompte, on sait bien qu'on ne le fait pas de même selon l'unité de base du morceau (blanche, noire, etc.) ; et c'est là où Maximianno Cobra trouve un nouveau biais, qui expliquerait la position de Beethoven, en tout cas pour certaines symphonies [3] : il aurait effectué un décompte métrique, c'est-à-dire que la valeur de base contiendrait un aller et retour et non pas un aller simple.
Il tâche de soutenir cette vue avec force références historiques et théoriques, plus ou moins convaincantes selon l'angle d'où on les observe.
Pour disposer d'un commentaire plus vaste de sa part, on peut se référer à ces pages : 1, 2.
--
2. Les vidéos
Il faudrait donc - et c'est ce qu'il fait - jouer les symphonies deux fois plus lentement. On est dubitatif, n'est-ce pas ? Oui, on vous voit d'ici, mauvais esprits que vous êtes.
Nous vous laissons découvrir [4], avec le moins de préjugés possibles, le résultat. Ensuite viendra notre propre sentiment.
Nous allons uniquement proposer la Neuvième Symphonie, qui est un lieu où la radicalité de sa proposition se sent très nettement.
Si toutefois vous refusez une fois l'écoute achevée d'écouter ces raisonneurs insupportables qui mégotent tiédassement avec le génie massif, vous pouvez directement envoyer des fleurs à Maximianno par ici.
--
Scherzo de la Neuvième Symphonie de Beethoven :
Final :
--
3. Notre sentiment
C'est bon vous avez tout fini, on peut y aller ?
Non ? On finit son assiette d'abord, on parle après. Retournez-y.
[...]
A l'écoute du scherzo, notre réaction est assez positive : on entend réellement les choses autrement, à ce tempo, toute la structure verticale de l'orchestre (la répartition des voix entre instruments) même avec un grand orchestre traditionnel, et très bien joué de sa part, avec de très beaux détachés qui rendent vraiment le propos dansant et viable. Assurément un très bon chef, qui sait bien où placer les respirations pour faire tenir une pièce difficile à soutenir.
Oui, difficile à soutenir... car son pari est en réalité impossible, et ce que nous pressentons dans le scherzo se manifeste avec éclat dans le final. Et nos objections sont lourdes. Non pas sur le droit d'interpréter comme ceci, mais sur la légitimité théorique revendiquée par le chef.
- Historiques :
- Comment expliquer que ces symphonies, qui restent largement sur le patron haydnien, puissent durer jusqu'à plus de deux heures ?
- Comment expliquer tout simplement qu'il soit le seul à écrire plus lent que tout le monde, et qu'aucun contemporain n'en ait fait mention ? Morton Feldman, tout le monde sait que c'est un peu distendu, c'est même en général ce qui vient en premier à l'idée, malgré toutes les qualités de sa musique...
- Contextuelles :
- Pour le premier mouvement de cette symphonie, tout l'effet d'accord est perdu, le tempo lent rend absolument méconnaissable l'imitation de l'accord de l'orchestre.
- Le tempo obtenu pour le deuxième ne correspond en rien à vivace... Ce serait plutôt moderatissimo assoluto.
- Pratiques :
- Difficilement tenable pour les vents (les chanteurs sont un peu moins dérangés, on peut respirer entre les mots, il n'y a pas les impératifs de tenues aussi longues et sur une double-trèsgrandesymphonie entière). Il a dû y avoir des syncopes non musicales pendant les répétitions...
- On perd le discours général : les détails les plus anecdotiques de la progression musicale sont exagérément allongés et les réitérations deviennent trop distantes (deux fois plus, comme il se doit...) pour être bien perçues à moins de se concentrer fermement.
- Les articulations sont trop lentes, si bien qu'on sent trop les coutures de la musique, les tricotages des second violons et des altos, certes fondamentaux (on s'aperçoit que c'est très bien fichu, incontestablement), mais qui doivent se percevoir dans le mouvement général, alors qu'ici on entend la moindre arpège répétée indolemment en boucle pendant de généreuses minutes...
Sans parler de la perte d'urgence de la composition, lentement décortiquée, et de la durée d'exécution pour le public.
Clairement, on n'y retrouve pas la démesure de Beethoven, son impérieux tintamarre, la générosité de ses contrastes... On dirait plutôt une symphonie de Bruckner bâtie sur un collage de Haydn. [En fait, on ose à peine le confesser, mais on pense pas mal à la Lobgesang de Mendelssohn...]
C'est donc une curiosité très intéressante, mais qui, pragmatiquement aussi bien que logiquement, ne tient pas la route. En revanche, le chef qui fait ainsi sa promo semble très agile intellectuellement et surtout très adroit dans son métier - pour parvenir à rendre de façon assez habitée ce pari totalement inconscient.
Notes
[1] Inventé en réalité par Dietrich Nikolaus Winkel.
[2] Sauf chez les chanteurs, mais c'est juste qu'ils sont mauvais en solfège et en prime vaguement cabotins...
[3] Il ne préconise pas la généralisation de ce postulat à tous les compositeurs de cette époque, et même pas à tout Beethoven. Sa Septième Symphonie, bien que plus lente que la moyenne, est d'ailleurs assez traditionnelle - peut-être eu égard à l'abîme qui sépare les désirs de Beethoven - vers lesquels il faut tendre - du réalisable ? De ce fait, la multiplication par deux des durées n'impliquerait pas un ralentissement si vertigineux par rapport à la norme.
[4] Merci à Emmanuel qui a permis aux lutins d'accéder à ces vidéos et ainsi de préparer cette notule.
Commentaires
1. Le dimanche 16 août 2009 à , par Didier da :: site
2. Le dimanche 16 août 2009 à , par DavidLeMarrec
3. Le dimanche 16 août 2009 à , par Morloch :: site
4. Le dimanche 16 août 2009 à , par DavidLeMarrec
5. Le vendredi 21 août 2009 à , par lou :: site
6. Le vendredi 21 août 2009 à , par DavidLeMarrec
7. Le lundi 23 août 2010 à , par Ebene
8. Le lundi 23 août 2010 à , par DavidLeMarrec
Ajouter un commentaire