Lorin MAAZEL - 1984, la modernité domestiquée - I, un livret morcelé
Par DavidLeMarrec, mercredi 5 novembre 2008 à :: Disques et représentations :: #1071 :: rss
C'est à la découverte d'une oeuvre assez fortement méprisée par sa réception critique que nous invitons ici... mais parue en DVD, ce qui est fort pratique pour le lecteur pratiquant des lutins.

Lorin Maazel, jeune chef admiré de tous [1], est devenu (routine des grandes formations aidant ?) un chef assez peu fêté malgré ses postes prestigieux (actuellement le New York Philharmonic), et il est vrai moins intéressant que les plus investis de ses collègues.
Malgré le travail remarquable (fait d'élan et de son) à la tête du plus bel orchestre new-yorkais - dans lequel on doit supposer, non sans raison, qu'il recueille les fruits de la période Bernstein -, on considère aujourd'hui dans les critiques Lorin Maazel comme un chef mineur, une fausse gloire.
Aussi, sa proposition d'un opéra, et sur un sujet aussi tendance et aussi écrasant, a été accueillie avec des sourires sarcastiques.
Non seulement il pouvait être suspect de vouloir employer son carnet d'adresses pour faire jouer son travail de compositeur du dimanche, mais de surcroît, comment un chef médiocre pouvait-il prétendre au titre de bon compositeur occasionnel ?
Tout respirait le prétexte sur un bon sujet pour satisfaire la fatuité de celui qui est joué.
A telle enseigne que Maazel rencontra un grand nombre de résistances, et dut payer sur sa cassette personnelle la production visuelle (toute la mise en scène de Robert Lepage, décors et projections vidéo compris).
Avec un certain succès aussi, ne pleurons pas plus que de mesure, puisqu'il put se faire jouer rien moins qu'à Covent Garden.

Le livret était confié à un couple étonnant : d'une part Thomas Meehan, auteur de textes pour Broadway (Annie ou The Producers par exemple), et J. D. McClatchy, responsable de la [Yale Review|, professeur de littérature anglaise, membre des Académies américaines des Arts & Sciences et Arts & Lettres, également poète.
Le choix opéré, étonnant mais en fin de compte convaincant, résidait dans le refus de réduire la trame d'un long roman à une intrigue simplifiée et schématique. Les librettistes font donc le choix délibéré de la juxtaposition de scènes largement séparées dans le temps, voire dépourvues de lien de nécessité logique entre elles.
Cela suppose pour suivre au mieux (du moins la première heure) de connaître assez précisément le roman, et cela gêne l'approfondissement des psychologies habituel à l'opéra : les motivations des personnages ne sont guère connues, et leur épaisseur est à peu près nulle.
Pourtant, ce caractère fantomatique des personnalités, qui fait échapper les actes individuels à l'analyse rationnelle des observateurs, prolonge très efficacement le propos du roman : nous assistons à la souffrance d'anonymes sans réelle consistance. Peu importe au fond qu'ils soient vertueux ou attachants (et ils ne sont ni l'un ni l'autre) : ce qui leur est infligé, nous fussent-ils opaques, nous est insupportable.
Une fois cette esthétique inhabituelle intégrée durant la première heure, on ne peut qu'être captivé par ce qui fait suite (une écoute continue est recommandée, de ce fait).
--
Notes
[1] Une période dont nous restent ses gravures des deux opéras de Ravel, des références assez unaniment saluées, où brille un esprit subtil et rieur.
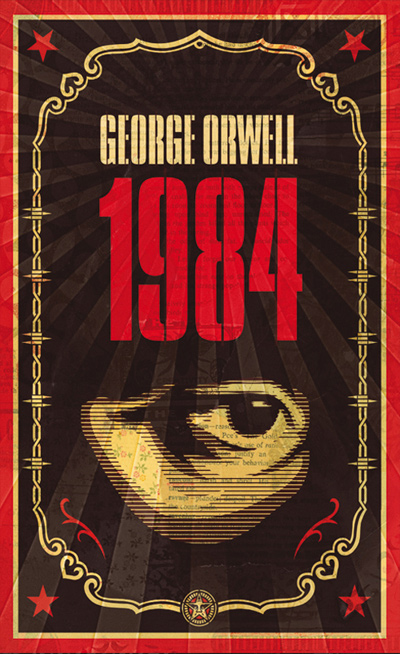
La disposition dramaturgique adopte beaucoup de principes qui ont à l'encontre de la tradition théâtrale mondiale - car on la trouve aussi dans des théâtres comme le Kunqu.
Tout d'abord l'absence d'exposition. Directement plongés dans une Cérémonie de la Haine, dans laquelle se trouvent les solistes, nous sommes d'emblée confrontés à la violence de cet univers, nullement à ses enjeux et à ses psychologies. Les enjeux s'éclairent au cours de la scène suivant, au Ministère de de la Vérité où travaille Winston Smith - où les célèbres devises du régime et les principes du newspeak sont rapidement exposés, sans être véritablement incarnés (l'anecdote de l'innocent instantanément détruit reste très brève pour être investie émotivement).
Impossible de comprendre durant la première heure les motivations de Smith. Pourquoi doute-t-il ? Que cherche-t-il chez l'Antiquaire ? En quoi est-il différent des autres, pourquoi s'intéresse-t-on vraiment à lui ?
Sans doute plus parlant pour qui a déjà lu l'ouvrage d'origine, les scènes isolées laissent ainsi glisser un regard extérieur sur des personnages pris comme au hasard, peu épais et peu attachants. Mais brossent de façon plus globale et implacable un environnement que rien ne semble pouvoir fissurer.
Ce choix est peut-être une maladresse de librettistes trop baignés du texte original, voulant dire trop au risque de se montrer obscurs ou décousus.
Mais le résultat est tout de même que, contrairement à ce qu'une focalisation sur les 'héros' aurait produit, le spectateur ne peut pas croire à la force d'une subjectivité banale pour changer le monde. Tout est perdu d'emblée : par la soumission ou par la bravade, il faut s'anéantir, et aucune des deux solutions n'épargne la souffrance.
Les personnages n'interviennent de façon insistante que très tard, et l'idylle débute étrangement, sans véritable justification autre que le désir subit de Julia - Smith empesé ne la suivant dans le crime que par faiblesse intriguée.
Aussi, l'acte I qui au lieu de s'arrêter après la première rencontre à l'église, mène jusqu'à la capture dans leur repère d'amour, dure-t-il près de deux heures, en un immense portrait décousu de ce monde trop régulier et terriblement cruel (la scène du lynchage par les enfants est particulièrement glaçante). Tandis que le second se concentre en quarante-cinq minutes sur la torture de Smith, d'une façon particulièrement efficace, intense et frappante. Comme si l'ensemble du premier acte était destiné à rendre crédible l'enfer du second.

Malgré ces bizarreries en fin de compte plutôt opérantes sur la durée de l'oeuvre, on saluera l'absence absolue, aussi bien dans le livret que dans la mise en scène, de dogmatisme tendant à prouver à quel point Orwell aurait raison, et plus encore le refus très net d'opérer le moindre rapport avec les régimes actuels. Il est assez facile d'y méditer soi-même, et tout parallèle aurait rétréci et ridiculisé l'oeuvre - d'autant qu'il n'aurait pu être, vu la nature allégorique du texte, qu'outrancier.
Un turban ou un masque de Brown aurait assurément à lui seul fait sombrer l'entreprise dans le pamphlet au petit bras, quelle que soit par ailleurs l'opinion des concepteurs du spectacle sur ces sociétés.

Il est vrai que la langue de l'oeuvre-source, quoique soignée, demeure assez banale ; et s'appuyer sur le contenu plutôt que sur la trame de l'oeuvre peut, en ce sens, se justifier. En considérant que ce sont les idées du littérateur, pour une fois, qui plus que son verbe auront assuré sa postérité. Pourquoi pas, même si, encore une fois, le manque de liens dans le premier acte peut dérouter longuement le spectateur candide.
Surtout, la chose peut se justifier pour pallier la principale difficulté rencontrée par Orwell dans sa narration. Certes, le narrateur demeure en dehors de son sujet, un peu indifférent comme il sied pour sentir l'atmosphère close, sans espoir provenant d'une entité extérieure - qui pourrait à tout le moins émettre un jugement moral salvateur. Mais il est aussi dès les premières pages un commentateur omniscient, guidant rapidement pas à pas son lecteur dans la découverte de ce monde nouveau. De ce fait, on perd de l'impact que cette société énigmatique pourrait produire sur le lecteur, découvrant peu à peu son inconcevable horreur.
Le livret de Meehan et McClatchy résout donc cela en laissant, pour le coup, le spectateur livré à lui-même. Evidemment, cela n'est pas sans poser quelques complications, le temps théâtral - et singulièrement du théâtre lyrique - ne permettant pas une découverte patiente comme dans le flux continu d'un roman.
C'est une autre hypothèse pour expliquer cette structure étrange, qui est peut-être à attribuer tout simplement à la difficulté de condenser une oeuvre longue en un livret un tant soit peu subtil.
--
La suite bientôt.
Commentaires
1. Le samedi 8 novembre 2008 à , par Morloch
2. Le samedi 8 novembre 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
3. Le samedi 8 novembre 2008 à , par Papageno :: site
4. Le samedi 8 novembre 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
5. Le dimanche 9 novembre 2008 à , par DavidLeMarrec :: site
6. Le samedi 27 décembre 2014 à , par Chris
7. Le dimanche 28 décembre 2014 à , par DavidLeMarrec
Ajouter un commentaire