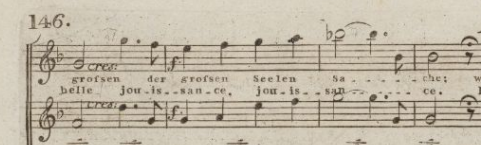mercredi 20 mai 2015
[Carnet d'écoutes n°77] – Ibert, d'Indy, Bartók, Haydn : Le Chevalier errant, Chansons et Danses, Duos, Crincrins…
Quelques échos autour d'écoutes récentes… et quelques insolites de diverses natures.
--
A. Œuvres
Ibert – Le Chevalier errant, Les Amours de Jupiter
Timpani vient de publier deux ballets de Jacques Ibert… Comme d'habitude, la qualité est au rendez-vous. Avec l'Orchestre National de Lorraine bien sûr (peut-être mon orchestre chouchou en France…), dont Mercier tire des sonorités d'une variété de couleur (et d'une sûreté technique) rares pour un orchestre français. Et aussi, ce qui était moins évident, avec les œuvres, en particulier Le Chevalier errant.
Les Amours de Jupiter sont commandées pour un ballet de Roland Petit en 1945 (création en 1946), au début de l'existence du Ballet des Champs-Élysées ; autour de cinq entrées (Enlèvement d'Europe, Léda, Danaé, Ganymède, Retour à Junon) se déploie la veine légère d'Ibert et du temps, mâtinée d'influences de café-jazz et de velléités néo-classiques. Belle partition bien faite, dans le registre du style le plus léger d'Ibert.
Le Chevalier errant est tout autre et fascine davantage. Issu d'une commande d'Ida Rubinstein (à l'origine également d'Orphée de Roger-Ducasse sur son propre argument, du Boléro de Ravel, d'Amphion de Valéry-Honegger, de Perséphone de Gide-Stravinski, de Jeanne d'Arc au bûcher de Claudel-Honegger et d) après le grands succès de son premier ballet Diane de Poitiers (1934), il demande de grands moyens, un peu à la façon de Jeanne d'Honegger : deux récitants, chœur, grand orchestre.
L'œuvre est achevée en 1936, mais dès la fin de 1935, Ibert en prépare une réduction pour le concert (une suite composée de l'essentiel des quatre tableaux, mais sans chœurs ni récitants, retranchant le tiers de la durée).
Le langage est étonnant pour Ibert, vraiment dense, assez moderne, certes lumineux pas du tout empreint de sa légèreté habituelle : de la véritable musique ambitieuse, ce qui n'a pas si souvent été son cas – en tout cas rarement sans citations folkloriques (L'Aiglon), arguments parodiques (Persée & Andromède), habillages primesautiers… C'est pourquoi ce disque est indispensable.

Quatre tableaux se succèdent :
- les inévitables Moulins, où Dulcinée apparaît bizarrement (dans la version définitive de 1950, elle y exécute carrément des Variations) ;
- les Galères, autre moment de bravoure très proche du roman (Quejana libère des prisonniers qui, se révélant étrangement mauvais sujets, massacrent leurs anciens maîtres sans que le héros puisse rien y faire) ;
- l'Âge d'or, qui prend au pied de la lettre les rêves d'Arcadie du héros, d'une façon qui n'est pas décrite dans le roman, mais qui en prolonge les allusions (enfin, les danses paysanes ne sont pas exactement ce qu'il entendait exalter…) ;
- enfin les Comédiens, qui n'a plus aucun rapport avec l'original : Don Quichotte part sauver une jeune fille prisonnière d'un géant (en réalité, ce n'est qu'une pièce jouée par des acteurs itinérants) mais, frappé par celui-ci, il tombe mort. Apothéose et transfiguration.
Cette dernière partie n'a non seulement aucun rapport avec le récit de la mort de Don Quichotte (épuisé, pris de fièvre en rentrant chez lui) ni avec son ton (sévère sur les erreurs de jugement du personnage – alors qu'ici, on a une nouvelle version du final du Roi Arthus de Chausson ou de Prométhée triomphant de Hahn, ainsi que de beaucoup d'autres œuvres du temps : Tristan, Parsifal, Die Frau ohne Schattent, Fervaal, Sigurd empruntent aussi cette voie)… mais de surcroît pas le moindre rapport non plus avec l'épisode consacré aux comédiens (chapitre 11 de la seconde partie), où le spectacle fait simplement peur à Rossinante : Don Quichotte tombe et les comédiens se moquent de lui.
La modernité des Moulins et les beaux archaïsmes triomphants de l'Âge d'or méritent vraiment le détour.
À cela, il faut ajouter les qualités déjà mentionnées de l'Orchestre National de Lorraine dirigé par Jacques Mercier avec une exactitude remarquable, se parant de couleurs étonnantes qui évoquent souvent les alliages de Petrouchka, avec une qualité de finition rare chez les orchestres français, et non sans enthousiasme.
À découvrir.
--
Béla Bartók – 44 Duos pour violons (BB. 104 ; Sz. 98)
Bien qu'écoutant finalement peu souvent Bartók – ce folklorisme méchant ne doit pas agir très puissamment sur mes impulsions d'écoute –, j'aime passionnément revenir à ses duos pour violons. Étrange dispositif, à la fois marqué par le folklore et d'une écriture très raffinée, assez abstraite finalement ; très différent des couleurs le plus souvent violentes, tourmentées et bigarrées de la plupart de ses œuvres… Dans ces duos au contraire, le contrepoint coule tranquillement, avec une certaine homogénéité entre les (courtes – pas une n'atteint les trois minutes, et la plupart sont comprises entre 45 secondes et 2 minutes) pièces ; cela n'exclut nullement les audaces imprévisibles, impensables dans un véritable folklore, mais l'effet n'est pas du tout celui d'une ostentation dramatique ou musicale. Bien que ce soit une source d'inspiration évidente pour Kurtág, ces Bartók-là peuvent au contraire aussi bien soutenir l'attention en concert qu'être placés en musique de fond.





Comme on les entend très rarement en vrai (pourtant, ça ne coûte pas cher !), même dans des récitals d'élèves de tous niveaux, il faut bien se repaître de disques. Et là, les versions pèchent souvent par une certaine mollesse, comme si la veine dialoguée (plus que dansante) n'était pas vraiment prise au sérieux – les hongrois aiment à dire qu'eux seuls peuvent comprendre les articulations de la musique de Bartók, liées à la langue et à la musique traditionnelle : c'est exagéré, mais il est vrai pourtant que beaucoup passent à côté de sa logique, en y exaltant seulement les aspects les plus académiques (fussent-ils des audaces).
Il en existe tout de même quelques intégrales, et pas mal d'anthologies (pas un nombre si vertigineux que cela, j'en ai repéré, après un rapide survol, une vingtaine), qu'on peut répartir en trois groupes :
¶ Les lyriques internationaux : Angela & Jennifer Chun (Harmonia Mundi), Frank Kim & S.G. Lee (Violin Foundation), Jan Talich & Agnès Pyka (Indé-Sens) et plus étonnant Péter Csaba & Wilmos Szabadi (Hungaroton) interprètent en privilégiant la mélodie et en gommant les appuis de danse.
¶ Les folkloristes : Wanda Wilkomirska & Mihály Szűcs (Hungaroton), Sándor Végh & Alberto Lysy (Astrée-Auvidis, puis Naïve), Barbabás Kelemen & Katalin Kokas (Budapest Music Center [sic]) accentuent la raucité, jouent de façon très détachée, accentuent les thèmes simples, comme des chansons et danses.
¶ Les lyriques fokloristes : Alberto Lysy & Sophia Reuter (Dinemec Classics), Régis Pasquier & Gérard Poulet (Arion), György Pauk & Kazuki Sawa (Naxos), conservent le legato, mais font tout de même sentir les thèmes capiteux et les échos de danse.
La première option n'a pas grand intérêt à mon avis (je troue par exemple tiède le résultat obtenu par Talich-Pyka ou les sœurs Chun, et Kim-Lee, qui bénéficient d'une prise de son proches dans un tout petit espace, sont même fragiles sur la justesse). La deuxième est parfois un peu extrême, surtout chez Wilkomirska-Szűcs, qui exagèrent leur phrasé scolaire (on dirait du Bach de débutant)… mais le grain, le refus du legato, l'exaltation des thèmes les plus pauvres créent vraiment une atmosphère « authentique » saisissante ; dans ce genre, la lecture plus tempérée de Végh-Lysy me paraît un excellent choix, quand même stimulant par sa radicalité, mais ne renonçant pas pour autant à la beauté et au goût. L'équilibre parfait est peut-être atteint par Kelemen-Kokas, avec ses superbes sons droits qui ne refusent en rien le chant – à mon sens le plus bel enregistrement en matière de son.
Sinon, on s'en doute, j'ai beaucoup de tendresse pour la troisième voie qui me convainc le plus – en particulier Pasquier-Poulet, plus lyrique et beaucoup moins typé oriental que les deux autres, mais qui rend très bien la poésie de ces pages. Lysy-Reuter et Pauk-Sawa sont excellents, beaucoup plus équilibrés dans leur rapport folklore/lyrisme, mais l'intensité constante de leur jeu et de leur timbre est un peu lassante sur la durée pour moi.
Les duos pour violons de Luciano Berio ne sont ni plus ni moins que le prolongement de ceux de Bartók, une fréquentation indispensable si vous aimez ce cycle.
--
Indy grand format
Le sixième volume de l'anthologie orchestrale de Vincent d'Indy vient de paraître chez Chandos. Il confirme le résultat hétérogène du projet : Vincent d'Indy est un grand compositeur, mais ses sommets se manifestent plutôt dans la musique scénique (Fervaal, L'Étranger, La Légende de saint Christophe…) ou dans la musique de chambre (Sonate avec violon, Trio avec clarinette, Suite dans le style ancien, Suite Op.91, Chansons et Danses, Quintette avec piano…). La plupart des poèmes symphoniques étaient déjà documentés (certes, de façon éparse) par le disque, et ne méritaient pas forcément la multiplication des versions, d'autant ce n'est pas ici la lecture la plus ardente qui soit. Ce sont surtout les Symphonies qui valent le détour (si, j'ai beaucoup aimé le celtisme archaïsant de Saugefleurie, un peu dans la veine de L'An Mil de Pierné), et l'intérêt, outre de tout regrouper, est qu'on peut entendre l'une de leurs rares versions – il n'existe que Bringuier (avec l'Orchestre de Bretagne) pour la Première, Monteux (San Francisco) et Plasson (Toulouse) pour la très-franckiste Deuxième – et, j'ai l'impression, la seule de la Troisième.

J'ai boudé Wallenstein qui m'ennuie assez ferme, mais j'ai écouté le reste du disque, en particulier les Chansons & Danses, un bijou de l'archaïsme roboratif. Mais la version pour grand orchestre leur fait perdre beaucoup de leur saveur, liée aux timbres crus et aux bondissements de l'effectif pour septuor à vent (flûte, hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, cor) – les cordes lissent tout cela.
À ce paramètre (respectable, ce doit être la première captation de la version pour orchestre, alors qu'il en existe au moins trois versions pour septuor : CBC, Klavier, Timpani) s'ajoutent les caractéristiques de l'interprétation elle-même : j'aime beaucoup le Symphonique d'Islande d'ordinaire, mais ses qualités ne sont pas forcément mises en valeur dans cette musique, et la direction assez indolente de Rumon Gamba, ajoutée à la prise de son en-cathédrale de Chandos, ne rend pas exactement justice au caractère de cette page (là où elle ne fait que limiter l'intérêt d'autres pièces plus traditionnelles et moins sensibles à ce traitement).
Pour entendre la version originale, les solistes du Philharmonique de Luxembourg font merveille chez Timpani, au sein d'un programme dans le même goût, notamment les deux Suites rétro. Beaux couplages également (mais ne se limitant pas à d'Indy) chez CBC et Klavier.
--
B. Interprétations
Haydn planant
Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Carnet d'écoutes - Intendance a suscité :
11 roulades :: sans ricochet :: 2222 indiscrets